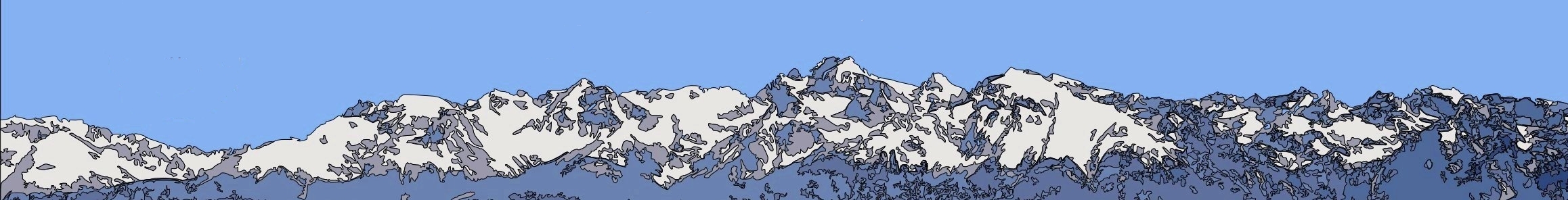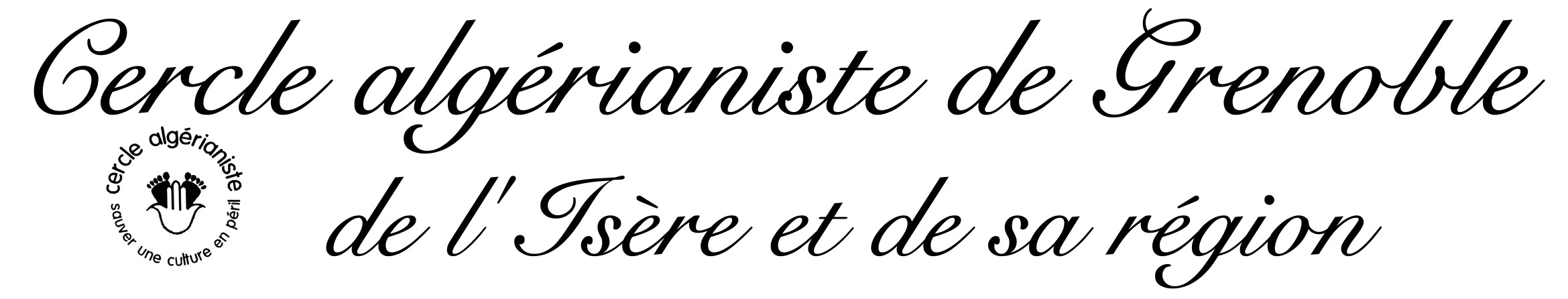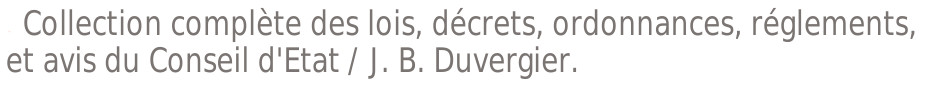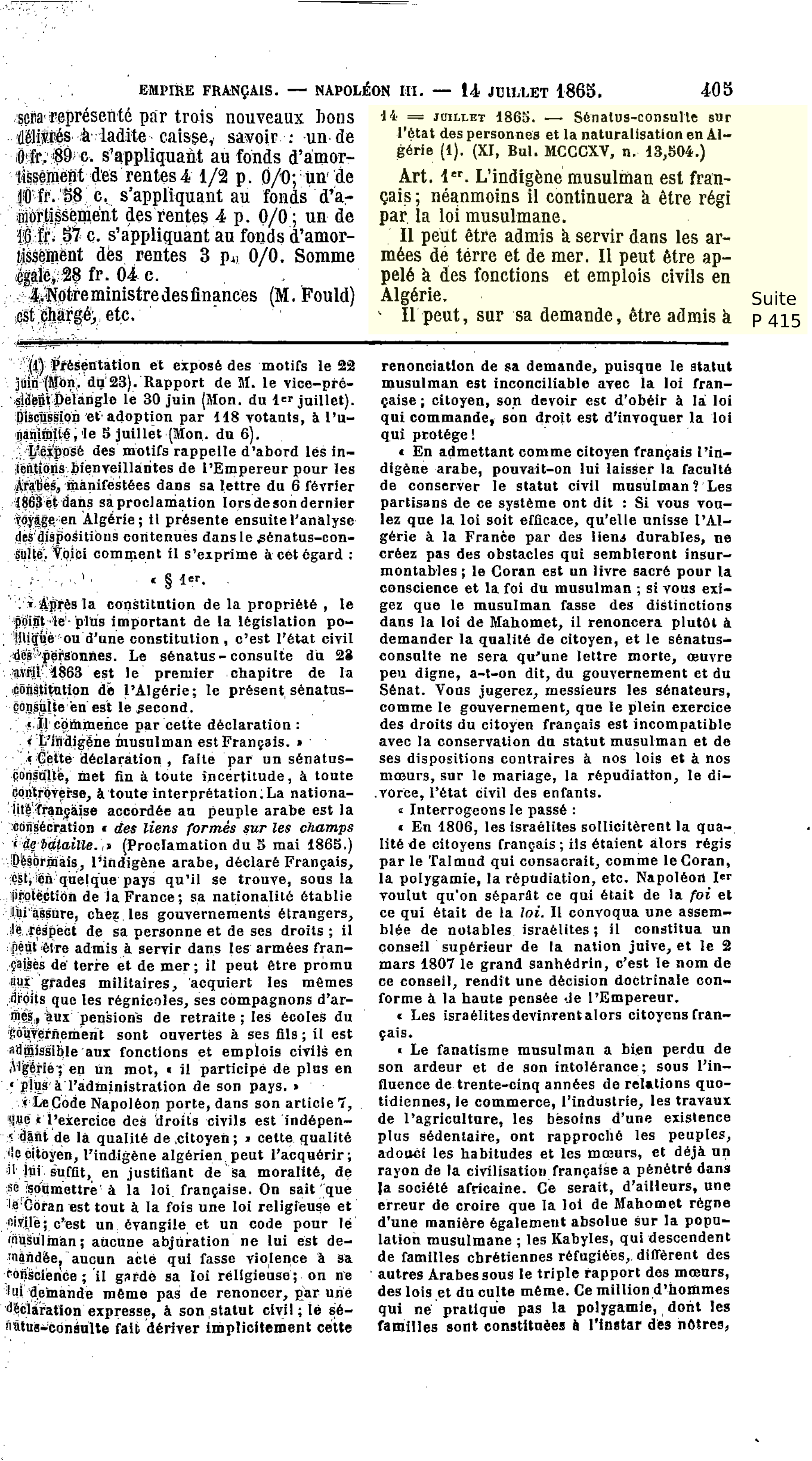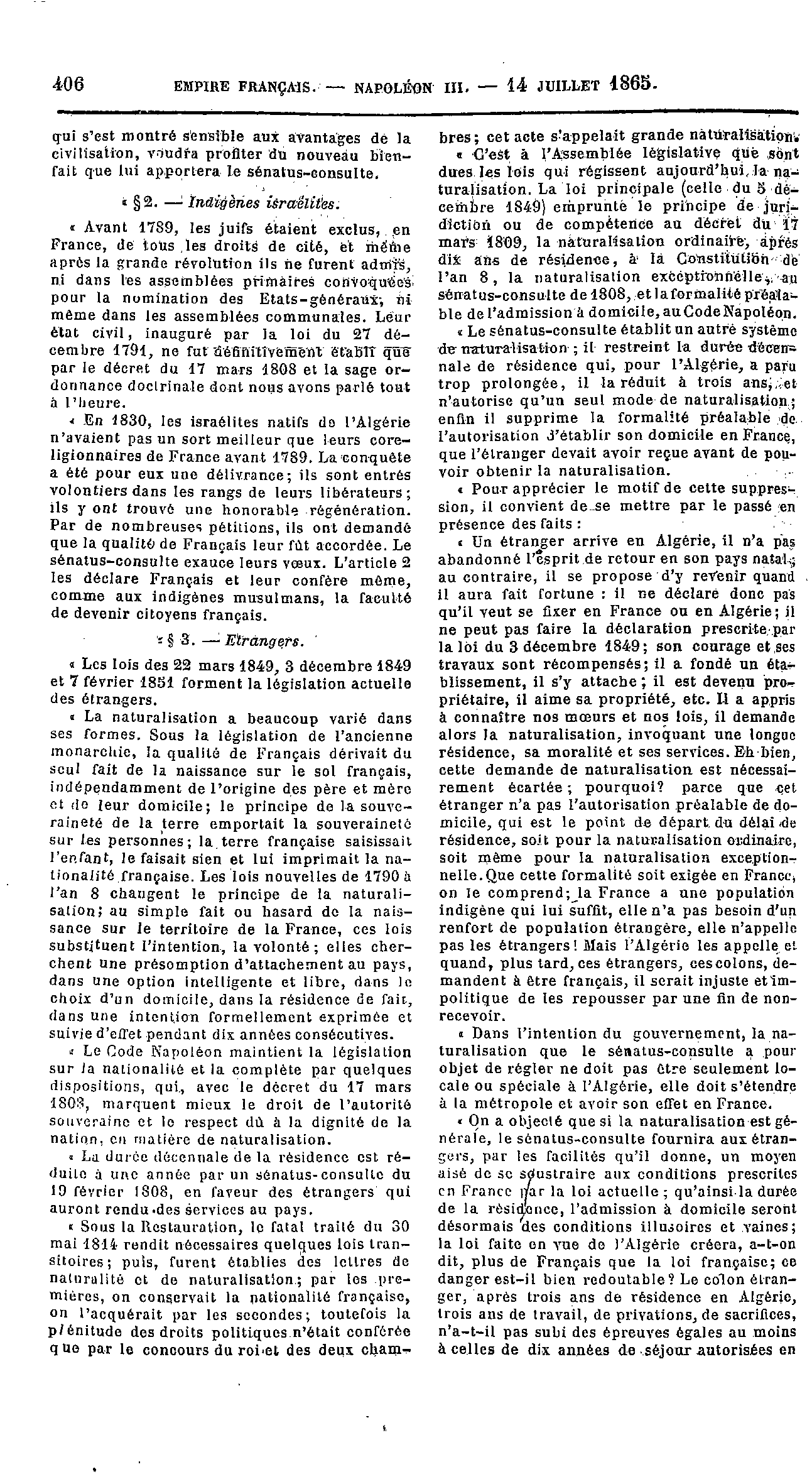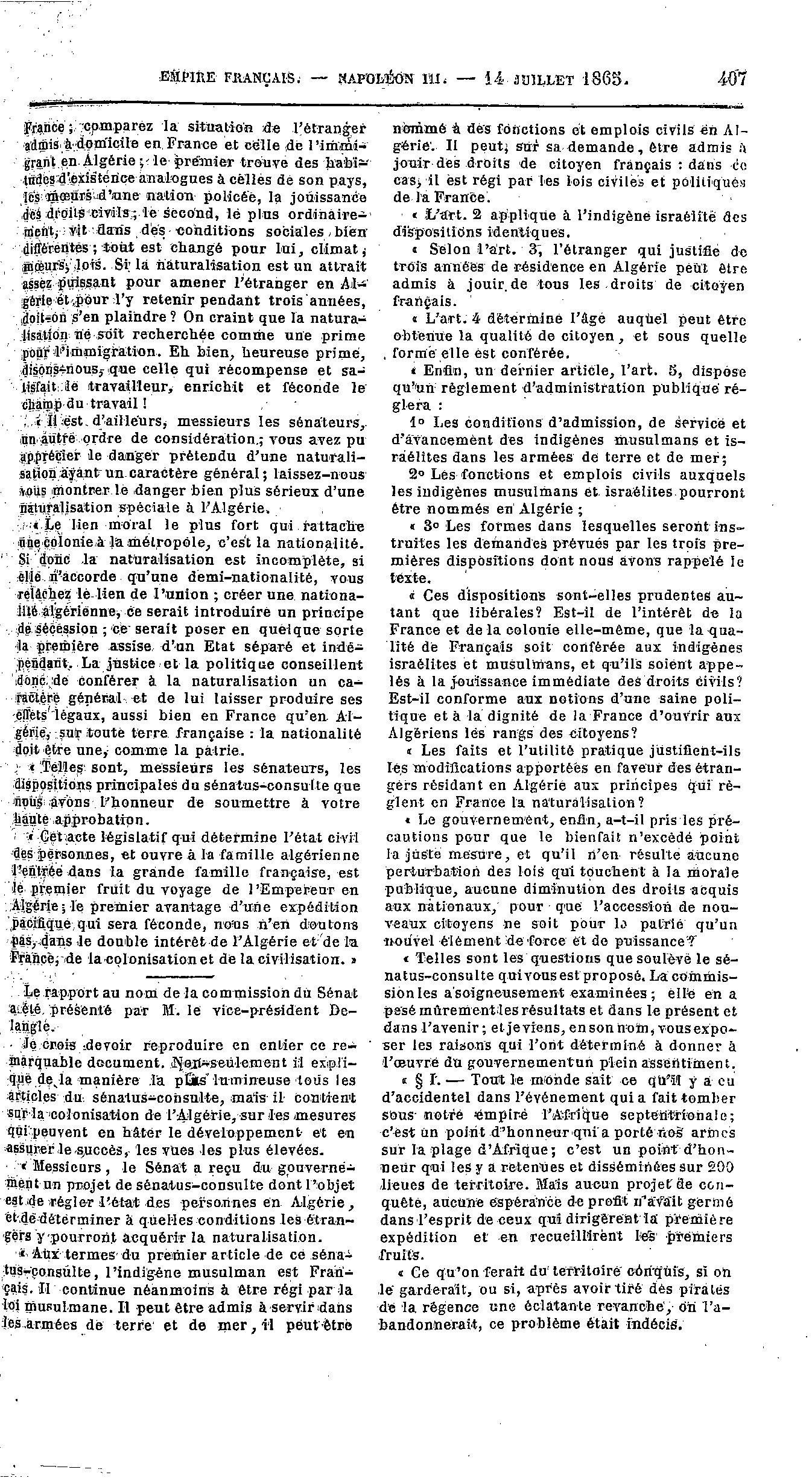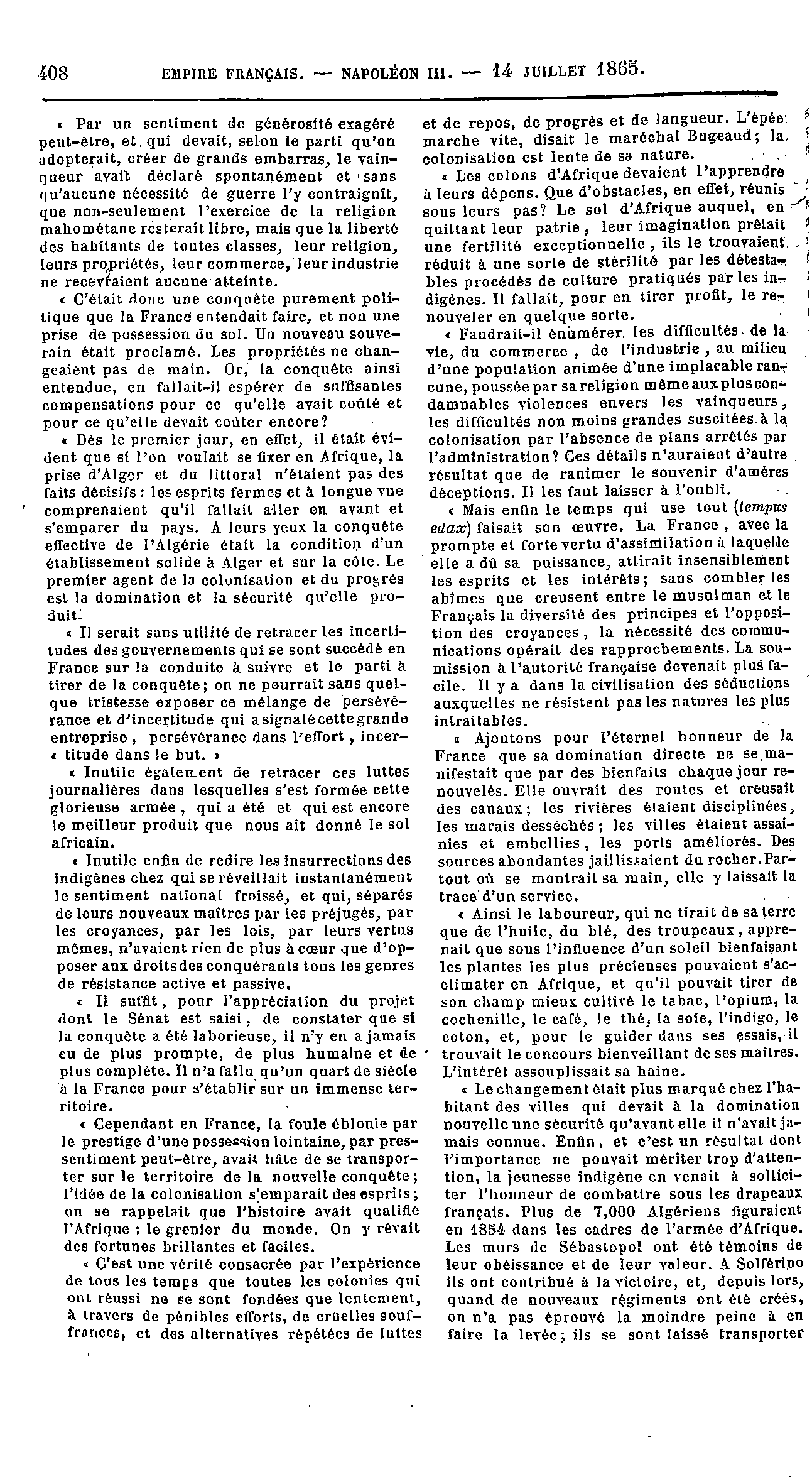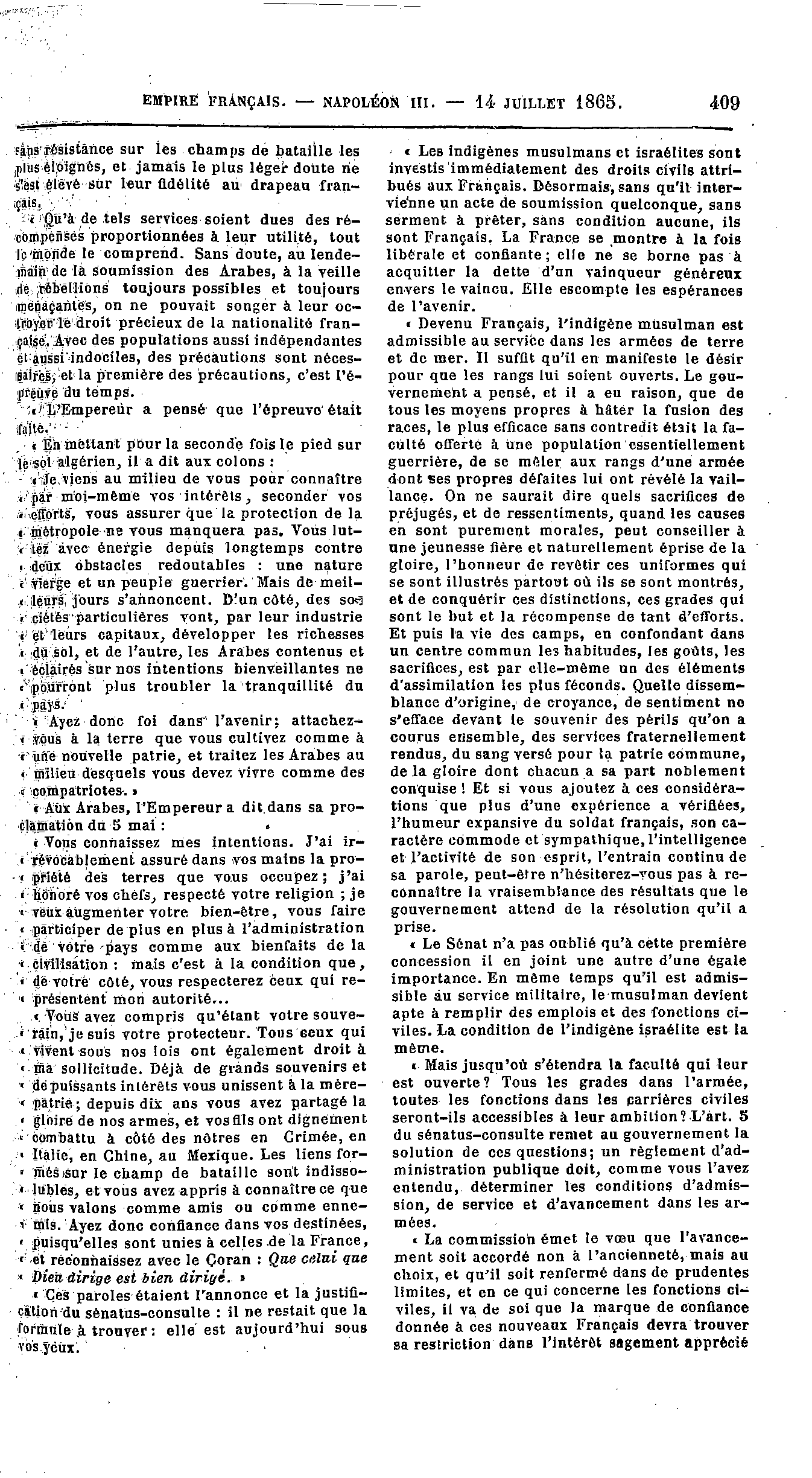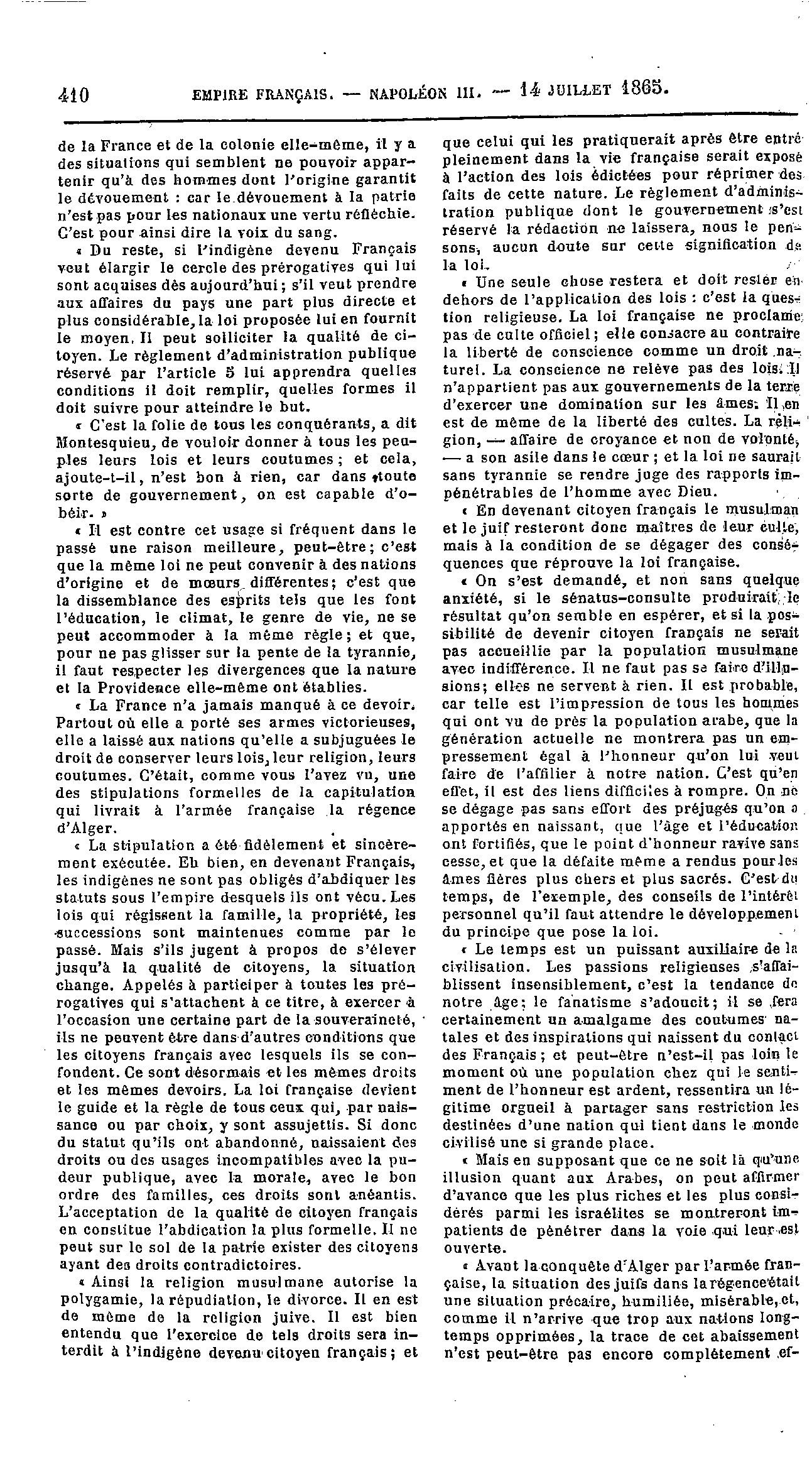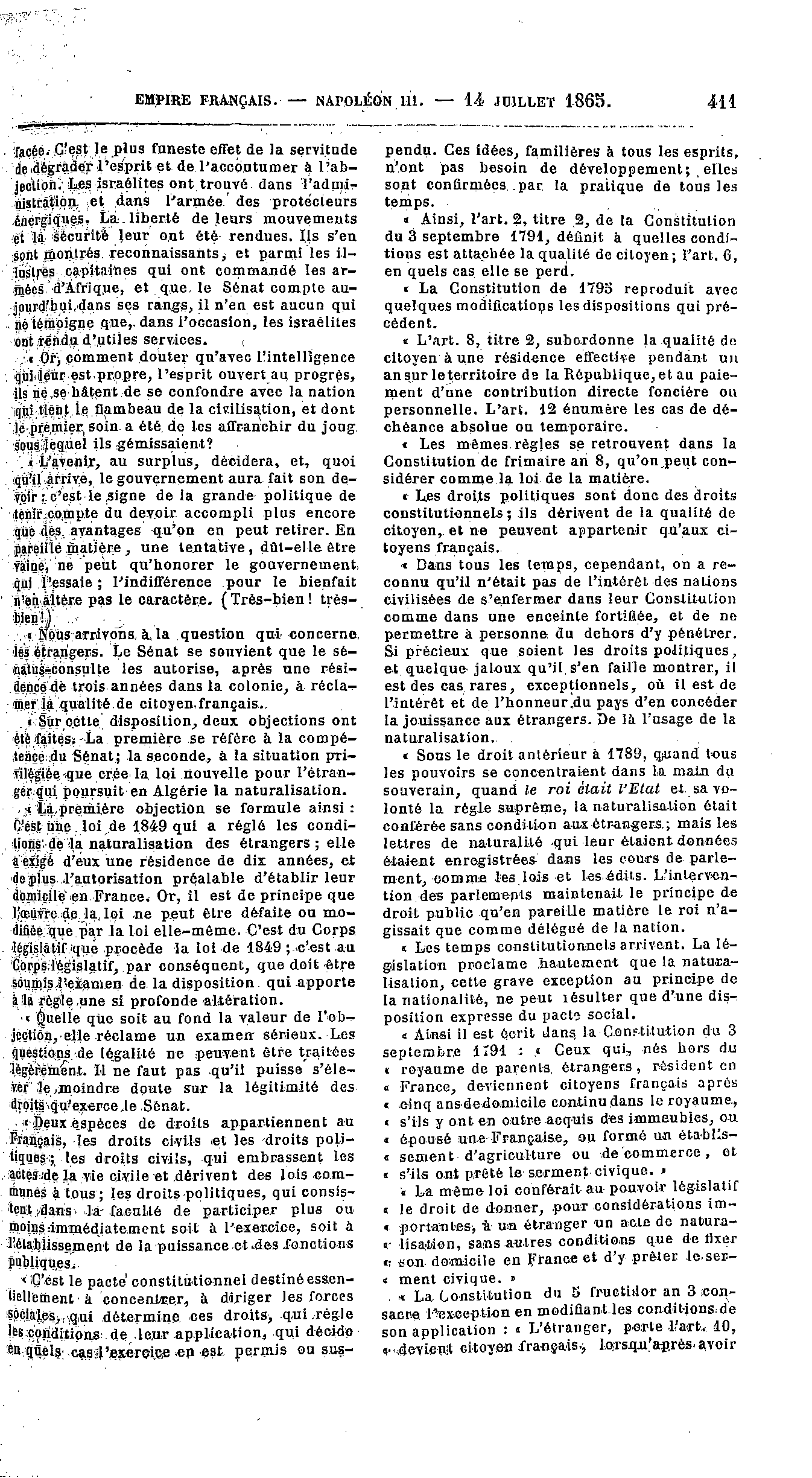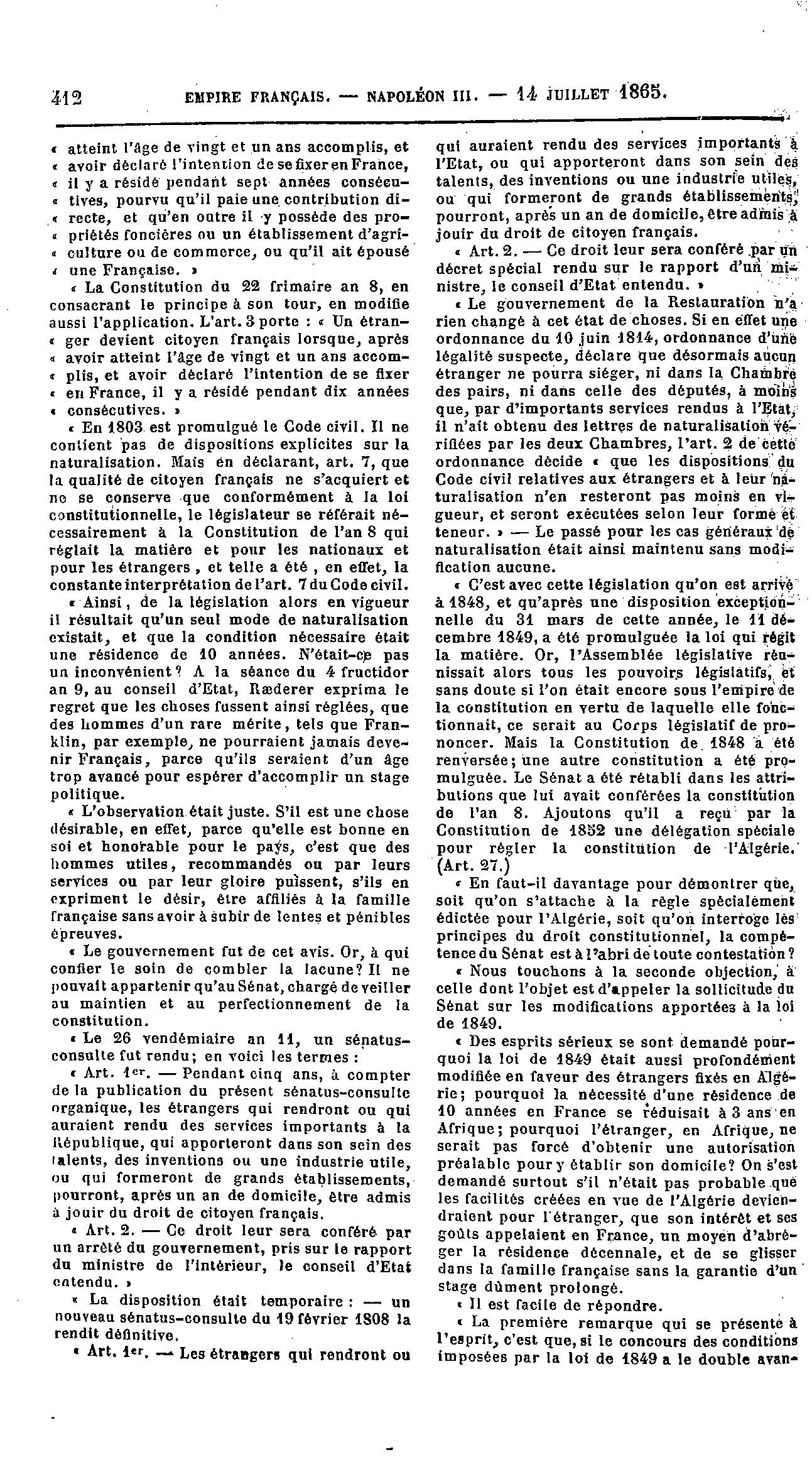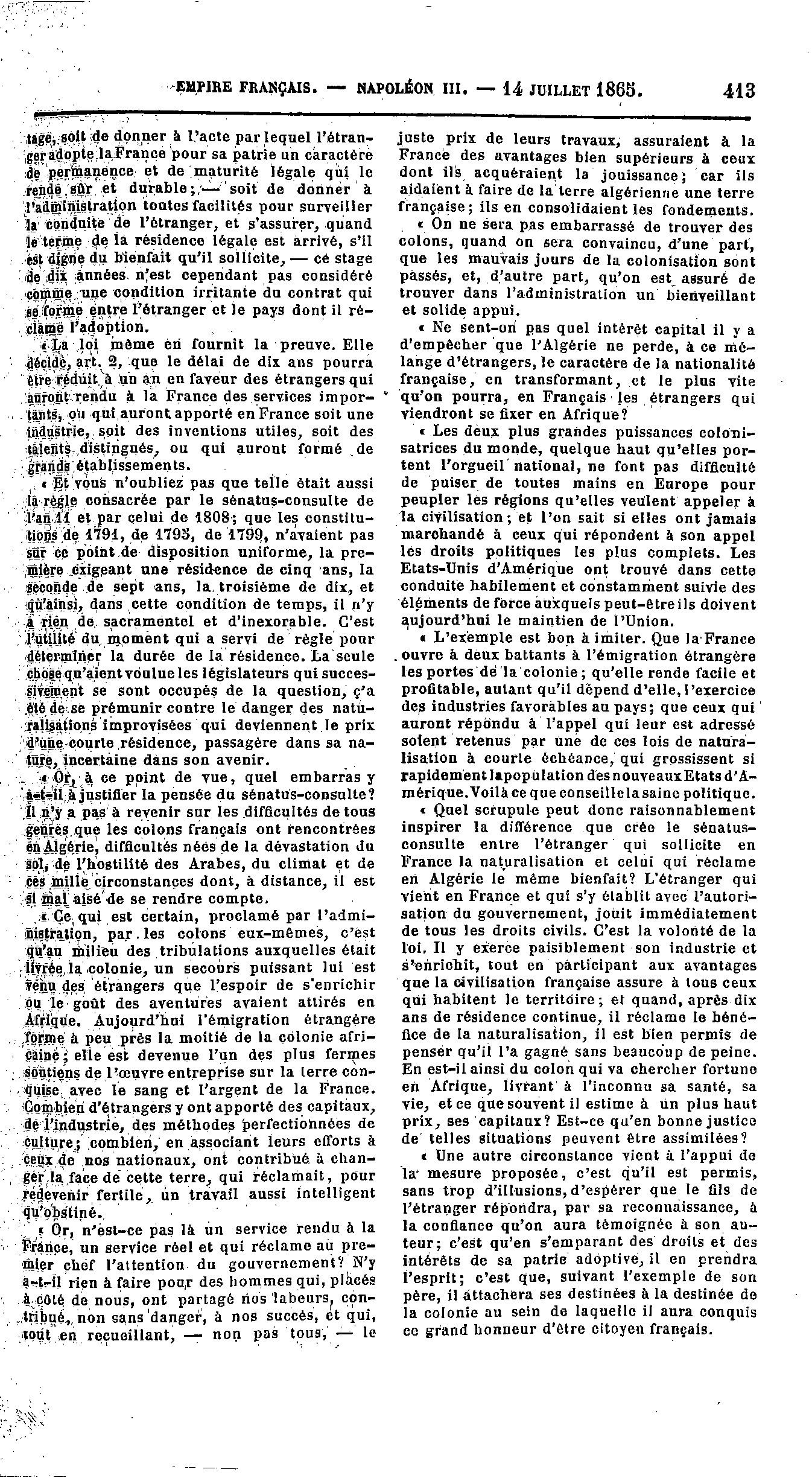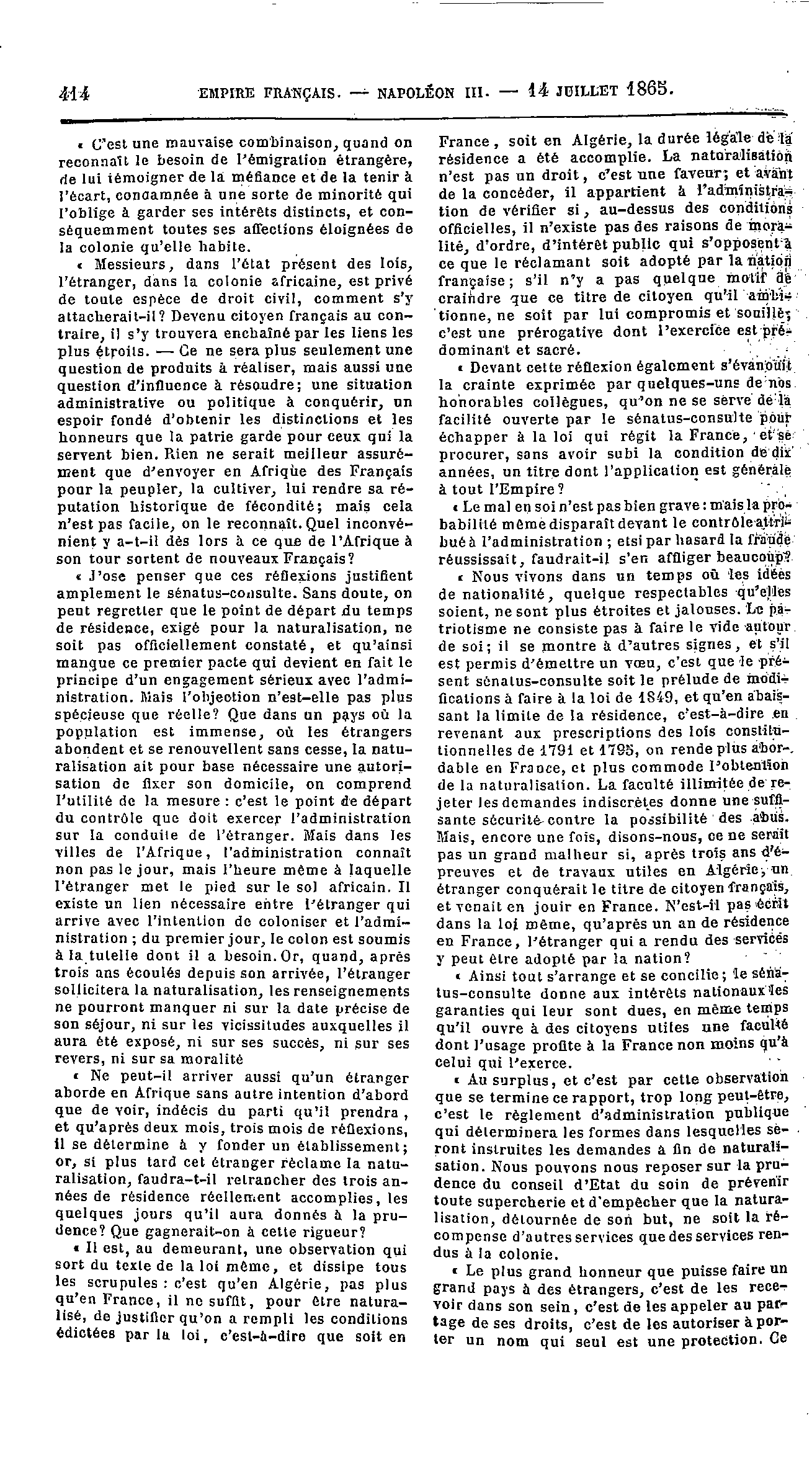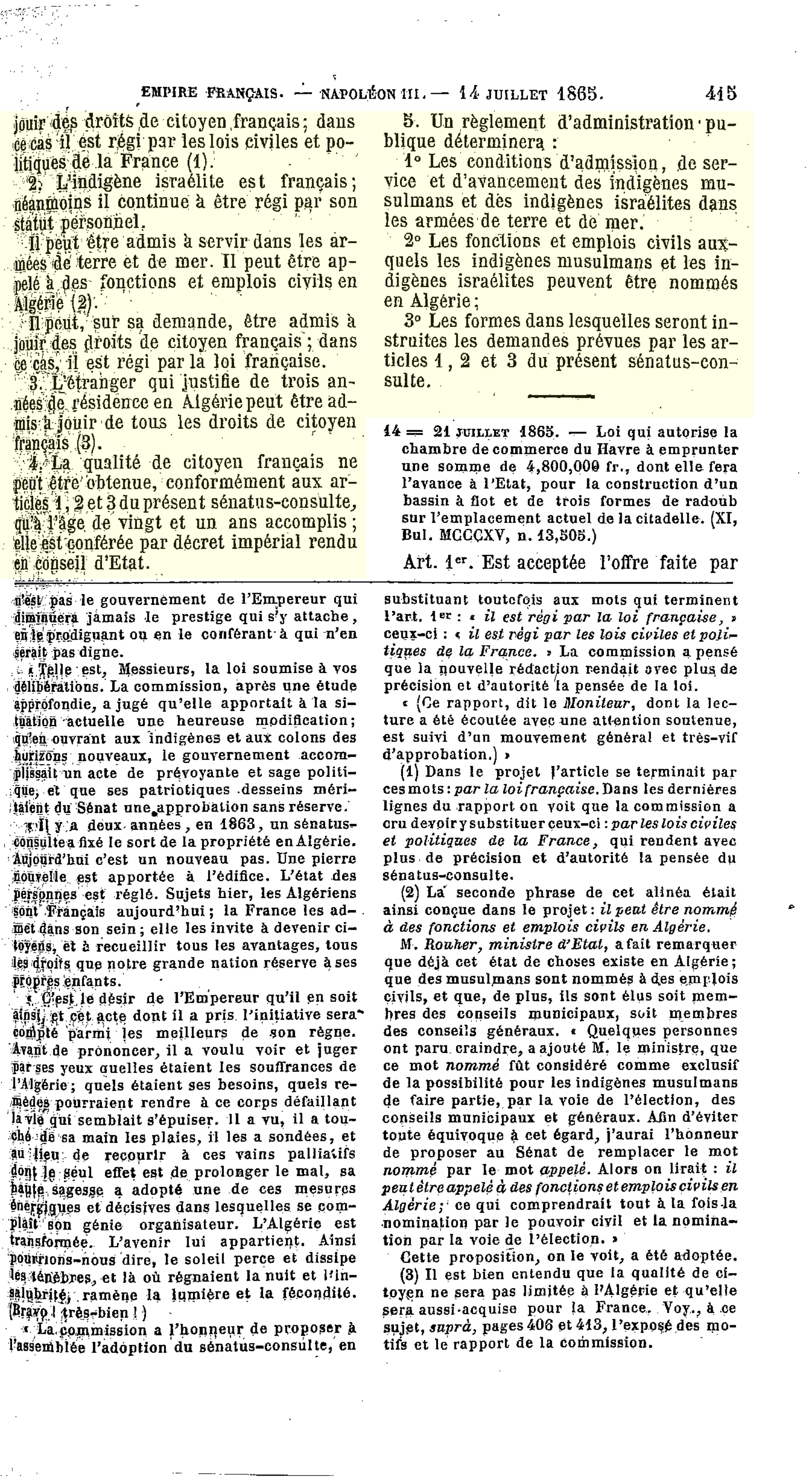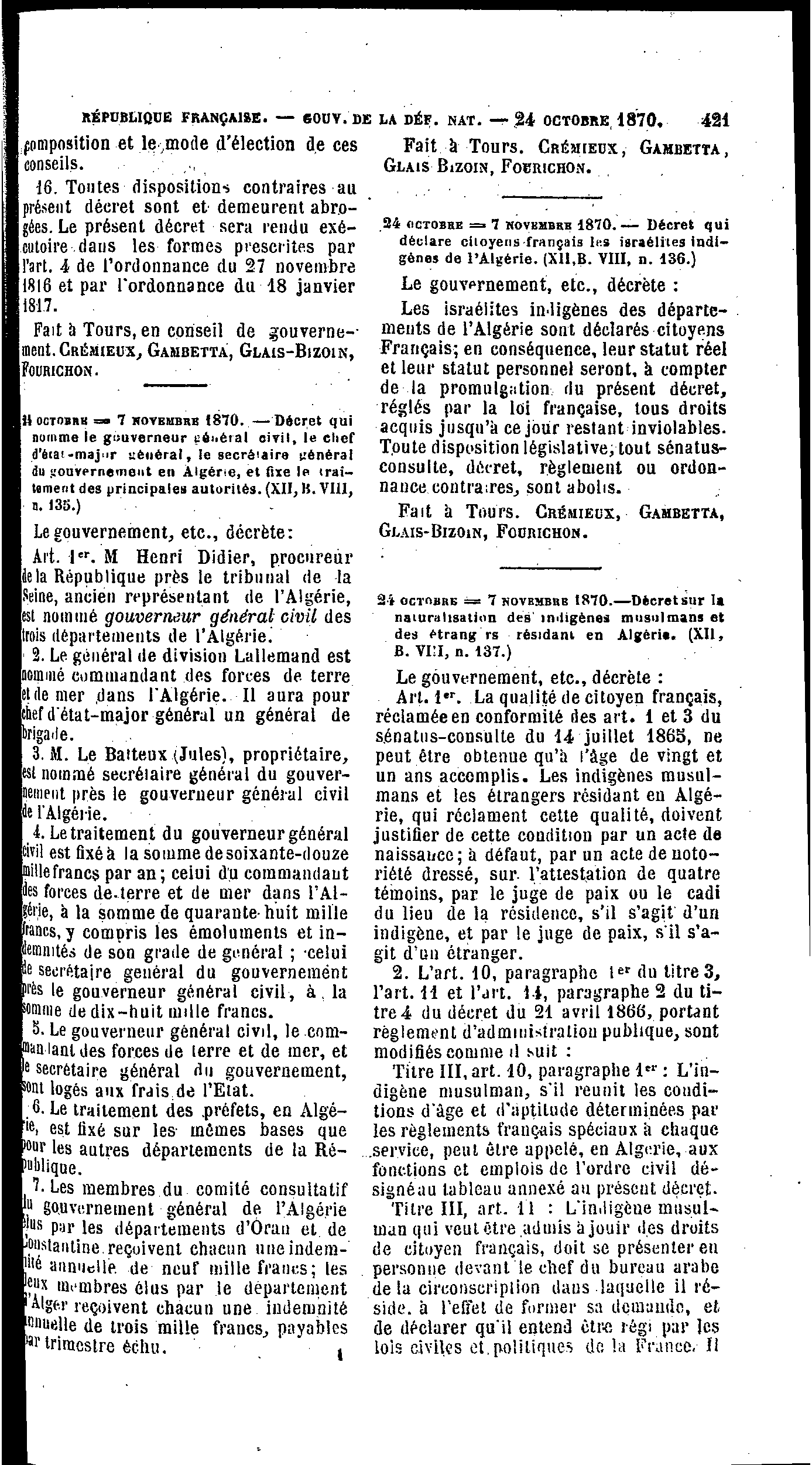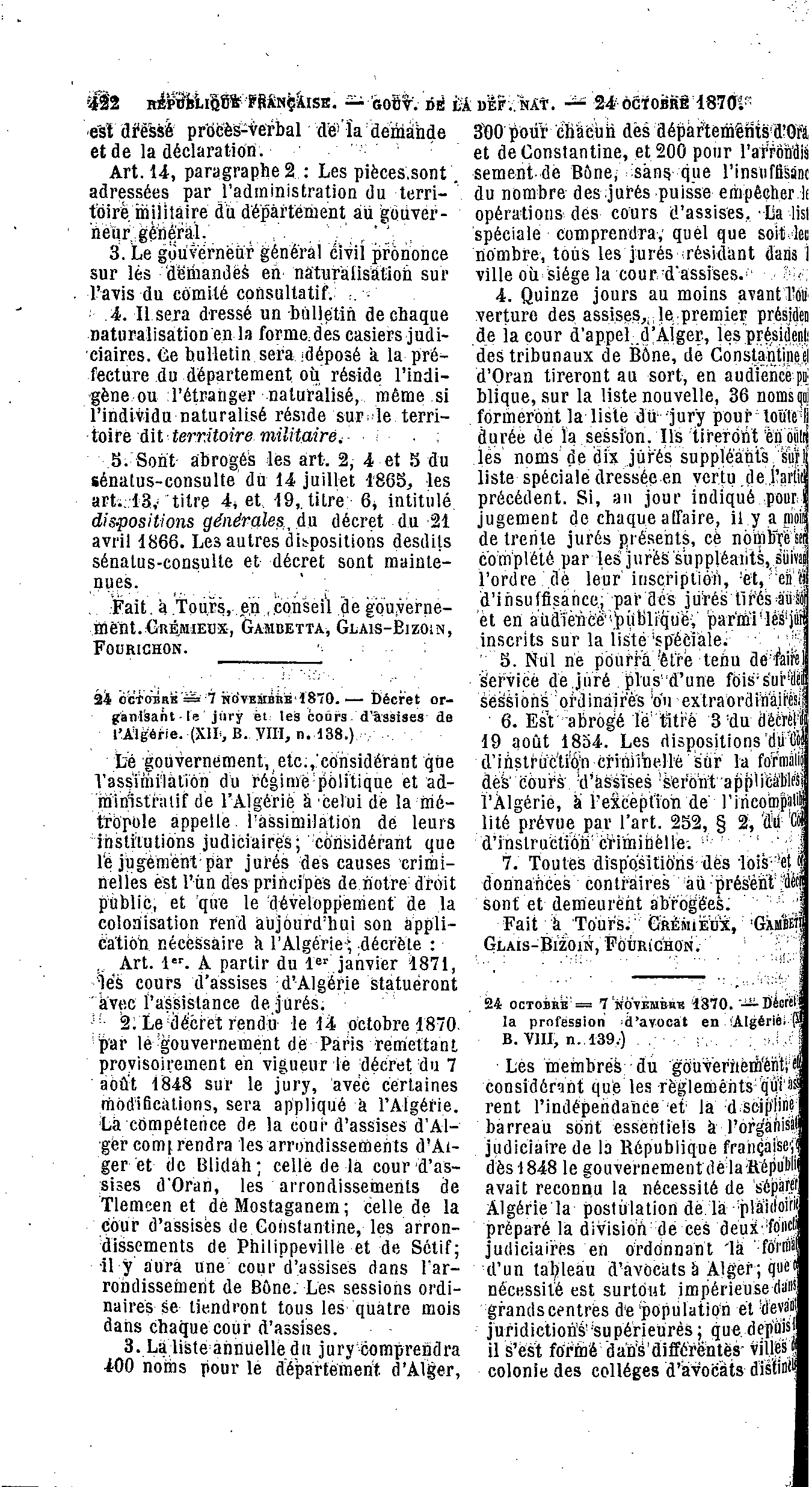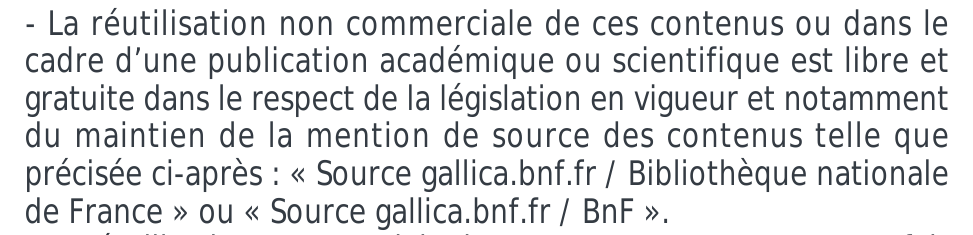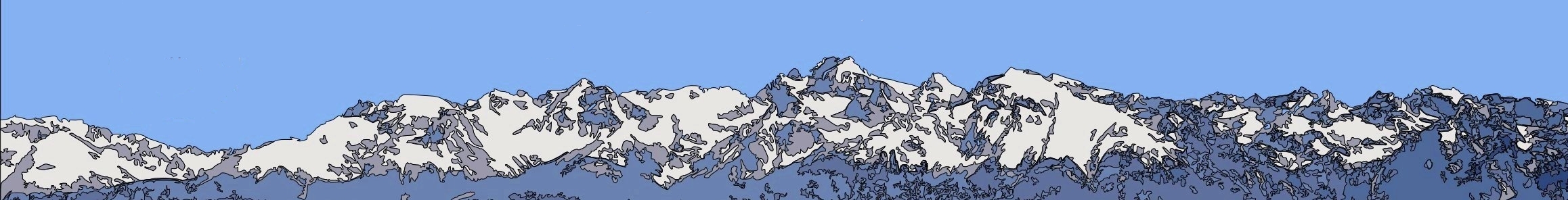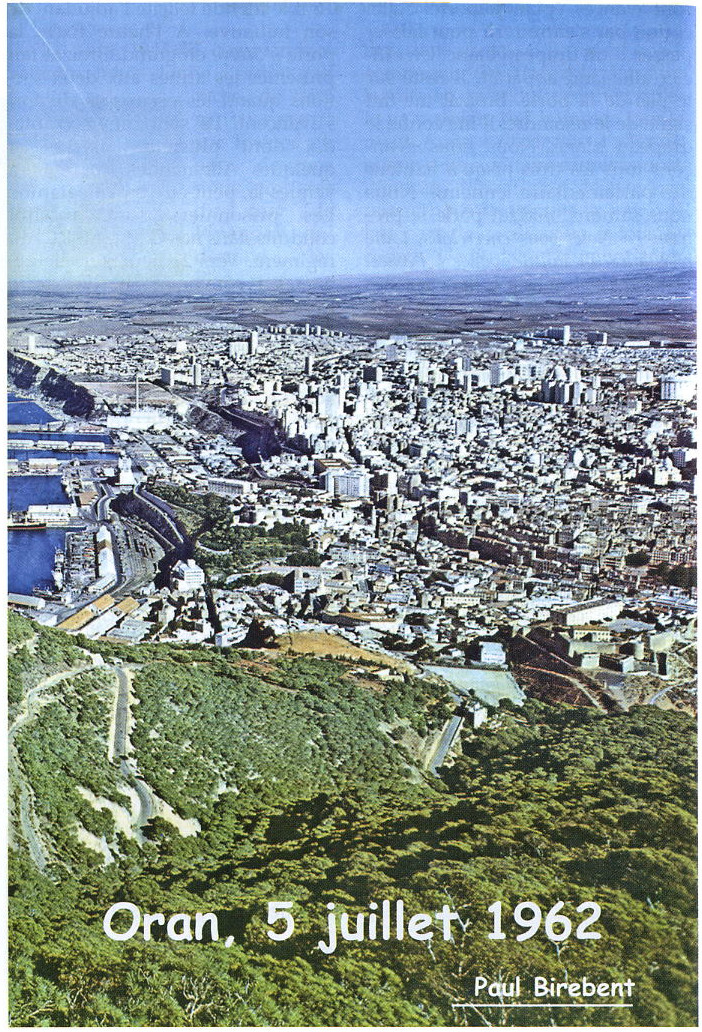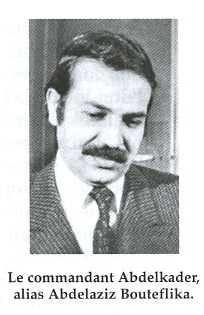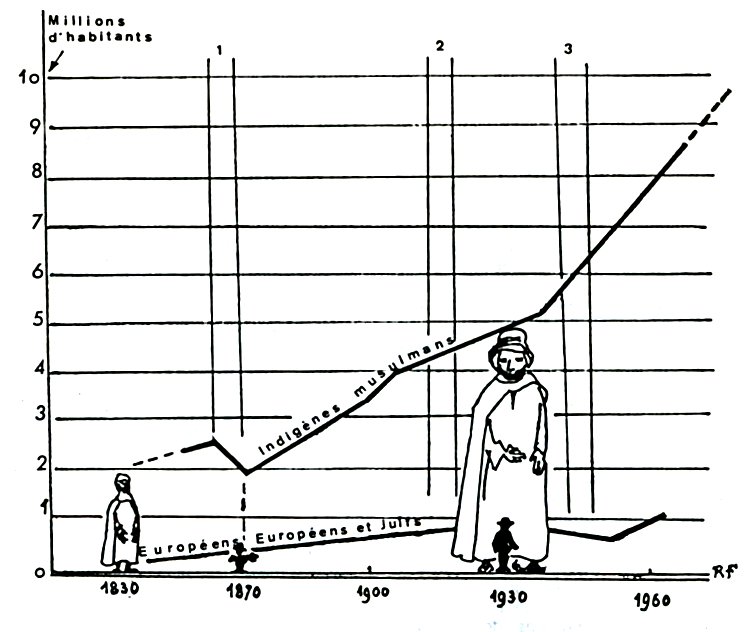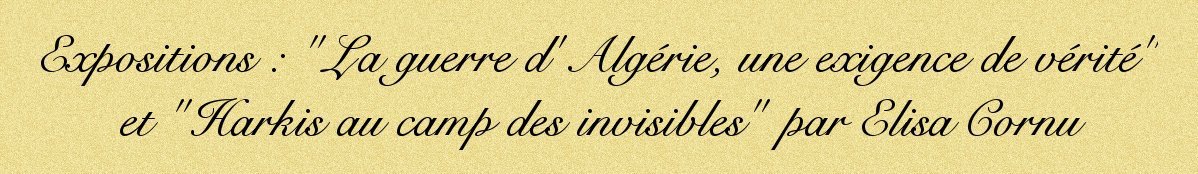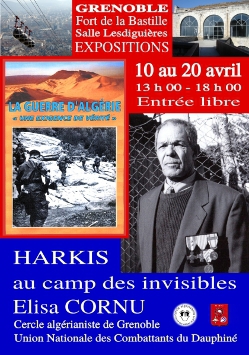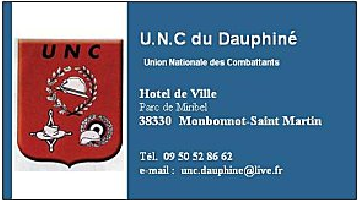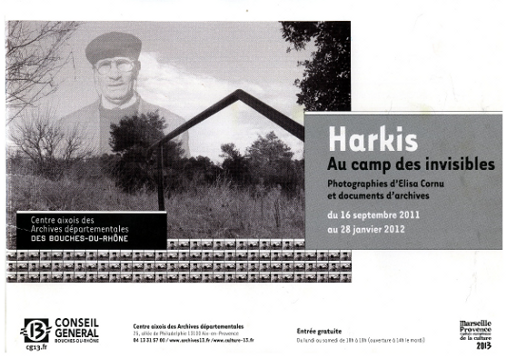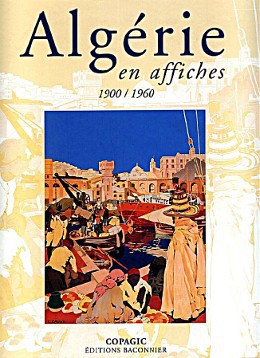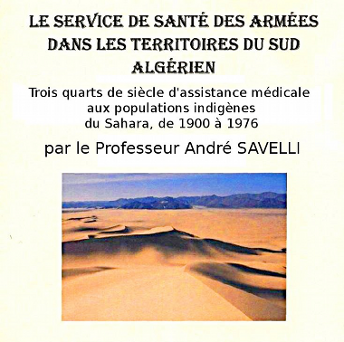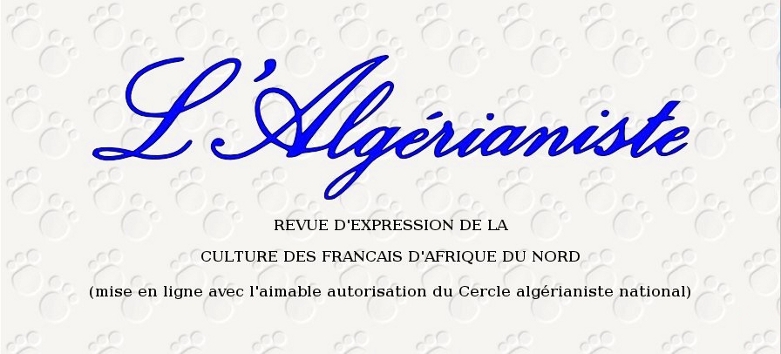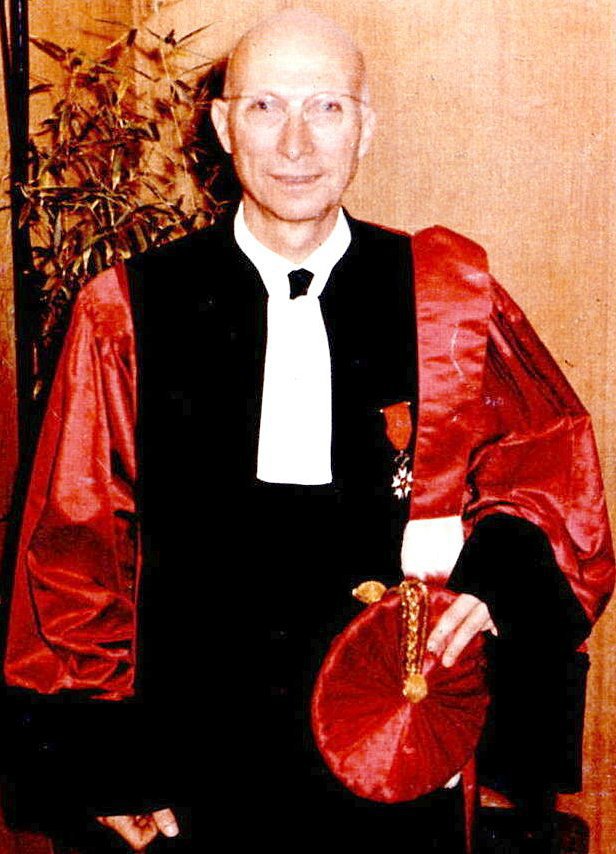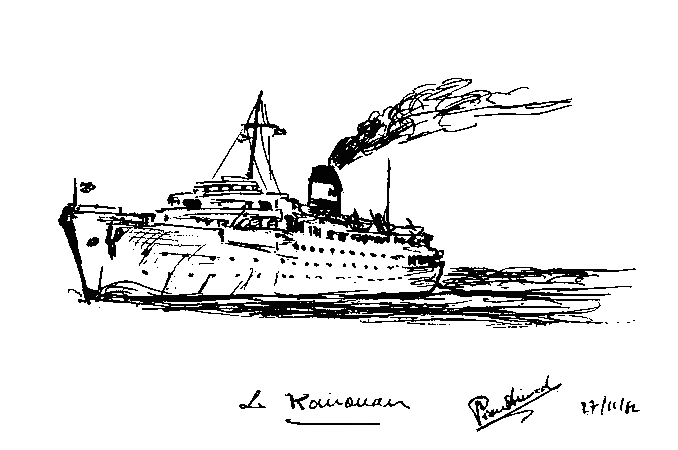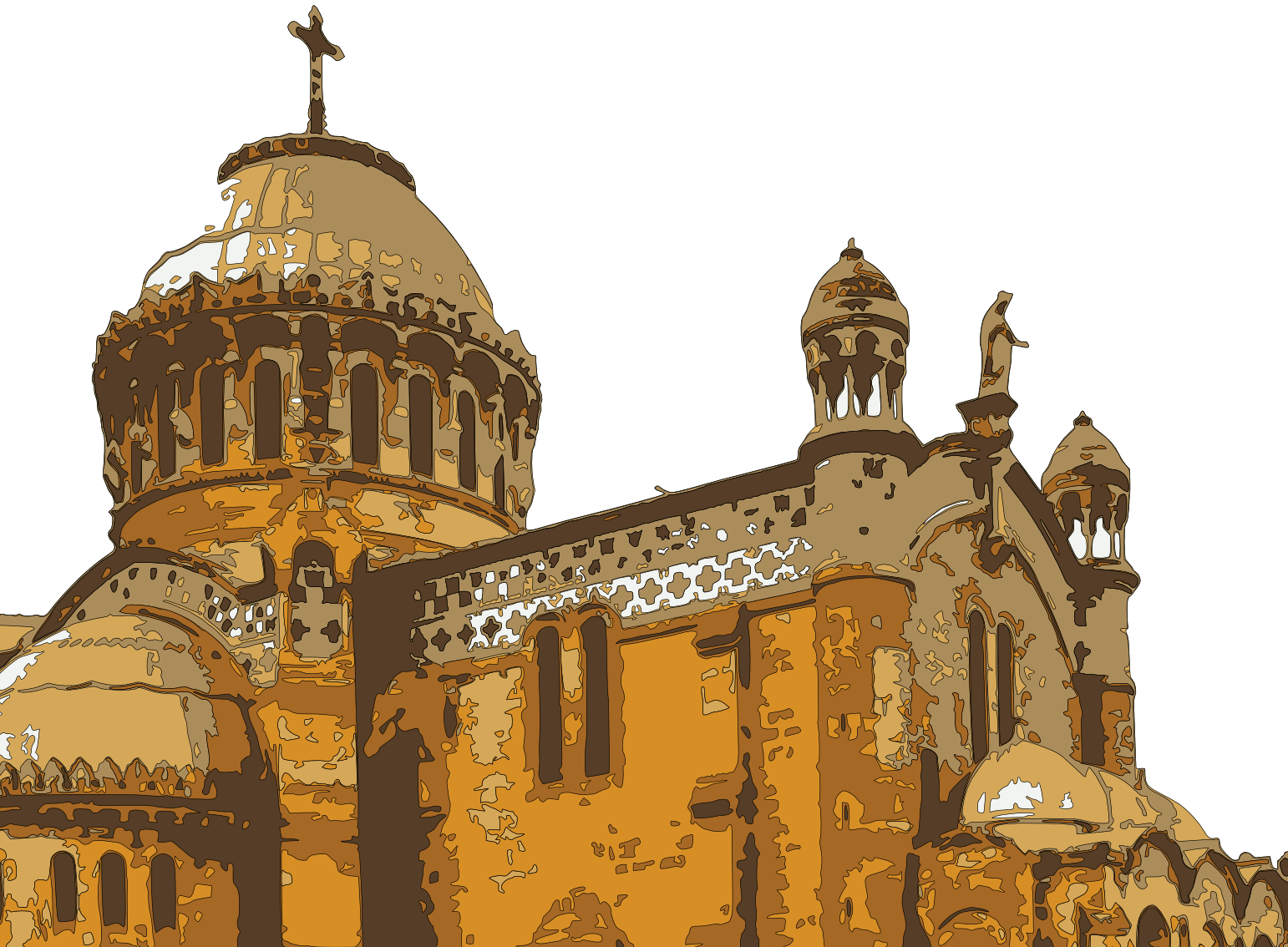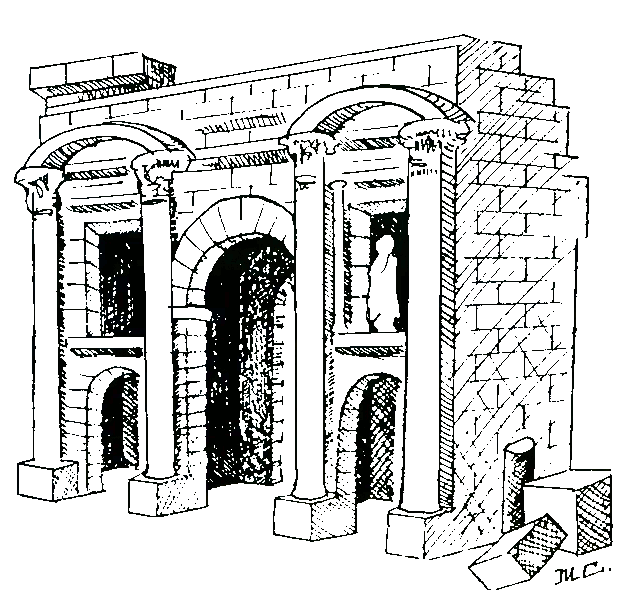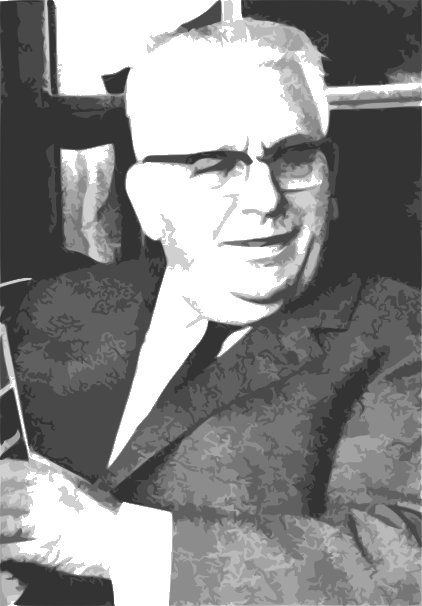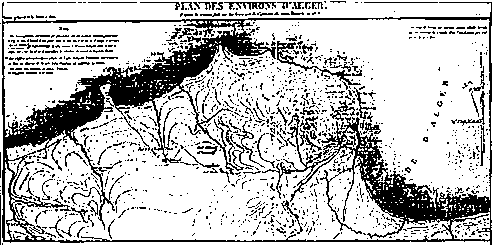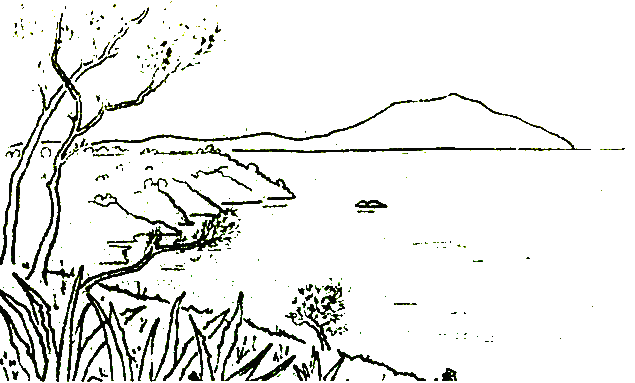Crier la vérité !
par Pierre GOINARD
NOUS qui restons des témoins du passé de
la France en Algérie ne pouvons tolérer plus longtemps
les stupéfiantes contre-vérités, les honteux silences
qui se perpétuent, dont on ne mesure pas assez les
malfaisances présentes.
Arme d'un fanatisme idéologique dont,
durant la guerre d'Algérie, nous avons été les
victimes sans défense, ou seulement transfert de
responsabilités gênantes sur une innocente communauté,
la désinformation dont la puissance a été décuplée par
les moyens de communication modernes, à une époque
malheureusement pour nous décisive, a pénétré les
esprits au point que, sans soulever aucune
réprobation, le cheikh Abbas, recteur algérien de la
Grande Mosquée de Paris, y recevant Jules Roy lors de
la fête de l'Aïd en 1986, a pu faire l'éloge de son
invité en ces termes : Un homme de sa qualité
lavait de tout : de la faim (1), de l'ignorance,
du mépris et du saccage commis par la colonisation...
Il était un de ces biens que les pires des maux
portent malgré tout en eux. (Compte rendu in Algérie
Information, mai 1986.)
Quelle tristesse de constater cette
intoxication non seulement chez de jeunes musulmans
transplantés ou non, mais, pire encore, chez des
Français d'Algérie qui ont quitté depuis leur enfance
leur terre natale, ou des militaires y ayant ardemment
défendu la présence française !
Même parmi nous, les plus fidèles à leur
chère province ne pêchent-ils pas par ignorance ?
Bien des fois des lecteurs de mon ouvrage m'ont avoué
: « Nous ne savions pas... »
Quant à un passé plus lointain il n'est
pas facile de se replacer dans le contexte et les
mentalités d'un temps révolu. Combien perfides les
citations isolées qu'un choix partisan va picorer dans
les archives : nous en avons eu des exemples dans
une émission télévisée récente intitulée « Droit
de réponse »... par antiphrase.
«EN PARTANT NOUS N'AVONS RIEN
LAISSE...»
Ainsi divague Alain Vircondelet, ayant
quitté à neuf ans Alger sa ville natale (2). Tout
d'abord a-t-il jamais su que nous avons laissé une
entité géographique réalisée pour la première fois
dans l'histoire par nos ancêtres et qui leur doit
jusqu'à son nom ? La Berbérie n'était en rien une
nation, mais une mosaïque de tribus constamment en
guerre entre elles. Ce sont souvent leurs divisions
qui, par un appel aux troupes françaises, ont entraîné
celles-ci plus avant.
Abd El-Kader lui même, auquel nous
avions concédé un véritable protectorat sur l'Ouest
algérien, lorsque ses ambitions s'étendirent vers
l'Est, se heurta aux Kabyles et, vers le Sud, à la
puissante confrérie Tidjaniya ; impossible à cet
homme, si exceptionnel cependant, de parvenir à
unifier ces provinces disparates en un royaume.
Moins encore eût-il pu y ajouter
l'énorme part du Sahara, étrangère au Maghreb, en
empiétant largement sur l'hinterland de la Tunisie et
surtout du Maroc. Nul autre que le « colonialisme »
n'a délimité artificiellement sur le Sahara une
superficie de 2.381.000 km2, décuplant celle de la
Berbérie, faisant de l'Algérie actuelle le dixième
pays du monde par l'étendue et l'un des plus richement
pourvus de trésors cachés sous les déserts.
On oublie aussi l'état dans lequel ont
été trouvés les pays barbaresques en 1830. Les
environs d'EI Djezaïr, le petit paradis rencontré près
de Bougie par Saint-Arnaud, cité à l'émission de
M. Polac, n'étaient que des îlots très
sporadiques. Sur cet étroit territoire entre mer et
désert, l'eau du ciel reste à la limite des cultures
vivrières dans sa moitié occidentale. Partout si
capricieuse, que le sol était ravagé tantôt par des
inondations, tantôt par de longues sécheresses.
Grenier de Rome, ce territoire le fut
très partiellement et, depuis lors, l'avaient dévasté
les guerres intestines et les invasions de l'ouest et
de l'est, en particulier les Bédouins refoulés
d'Egypte au XIe siècle « détruisant tout sur
leur passage, les forêts, les campagnes et les
villes. Tout pays possédé par les Arabes est
ruiné », écrivait au XIVème siècle
Ibn-Khaldoun, le grand historien tunisien et,
pour finir, trois siècles d'occupation turque.
En même temps que la France « rendait
sa liberté aux mers », elle délivrait à El
Djezaïr les Maures brimés, les juifs humiliés,
surimposés, exposés à être brûlés vifs, les captifs
chrétiens — otages de l'époque — en esclavage, dans le
bled les populations soumises à de lourdes charges
sans contrepartie et, si elles s'y dérobaient, à de
monstrueuses razzias. Seuls résistaient des Berbères
dans leurs montagnes dissidentes, fiers de leur
indépendance tribale.
Cette paix française, une fois chèrement
acquise, après cent trente-deux années d'efforts
acharnés, des militaires d'abord, puis des civils,
nous avons laissé en toute gratuité — oui, Monsieur
Vircondelet — de grandes belles villes et 700
villages, des logements privés pour un million de
personnes, souvent tout meublés, 54 000
kilomètres de routes, 4500 de voies ferrées, 23 ports
dont 3 parmi les français les plus actifs,
23 aéroports (celui d'Alger était le deuxième de
France), des barrages irriguant 200 000 hectares,
une agriculture moderne, quatrième productrice
viticole au monde, première exportatrice des
mandarines et clémentines, des industries,
agro-alimentaire, bâtiment, engrais chimiques, tabac,
papier, etc., une production électrique d'autant plus
méritoire qu'elle avait paradoxalement, pour un tiers,
une origine hydraulique, un réseau d'équipements
sportifs et hôteliers de niveau européen...
L'Algérie était devenue premier client
et premier fournisseur de la France.
Or, pendant très longtemps, les
autochtones étaient demeurés en dehors des travaux des
pionniers dans les villes et les campagnes.
A une mise en valeur aussi
exceptionnelle allaient s'ajouter les forages du
Sahara, auxquels leur participation fut minoritaire et
subalterne, 1 milliard de tonnes de réserves de
pétrole, 3.500 milliards de mètres cubes de gaz,
assurant jusqu'au XXIe siècle la vie et la richesse
des Algériens. Au moment où la France pouvait être
dédommagée enfin de ce que lui avait coûté l'Algérie,
elle en a fait abandon.
Ce trésor, nous l'avons aussi laissé,
Monsieur Vircondelet.
Sans parler de tout ce que nous avons
donné de nous-mêmes, sans distinction de personnes, à
ce pays qui était aussi le nôtre, où nous n'avons pas
laissé que des biens matériels.
UN GÉNOCIDE ?
C'est le terme ridicule et odieux qu'a
prononcé, à l'émission déjà citée et « pesant
ses mots » Daniel Leconte, né à Oran en
1949 d'où il est parti pour Paris en 1957, répétant ce
qu'il avait écrit quelques années auparavant (3).
Nulle guerre n'est humanitaire. La
suppression cruelle d'un réduit de résistance ou la
tactique de la terre brûlée (souvent le fait de tribus
antagonistes parmi lesquelles nos alliées), si atroces
qu'elles fussent, ne sont-elles pas sans commune
mesure avec les horreurs et les massacres des conflits
modernes ?
Mais génocide signifie, que je sache,
extermination délibérée de toute une population, comme
celle des aborigènes en Amérique (hormis quelques
réserves) ou en Australie. On pourra exhiber, datant
de cette époque, des propos outranciers de cette
espèce, mais sont-ils passés dans les faits ? Là est
l'essentiel.
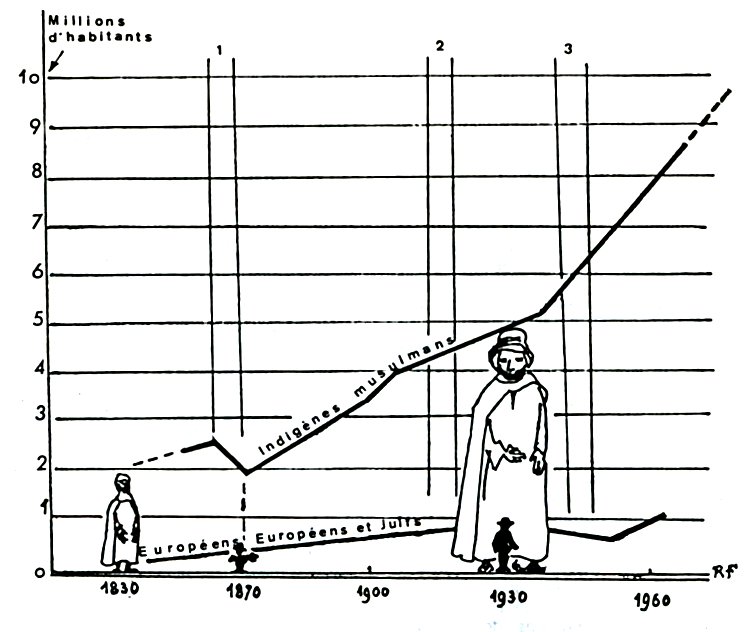
Accroissement des
populations indigène et européenne d'Algérie
1
: Grande famine 1866-1868. - 2 : Première Guerre
mondiale. - 3 : Seconde Guerre mondiale.
Or, loin d'avoir disparu, la population
musulmane autochtone a quadruplé entre1872 et 1954,
passant de 2 125 000 à 8 400 000 ;
cet accroisssement démographique a précédé de
plusieurs générations celui du Tiers-Monde, dont on
situe le début seulement autour de 1945.
Certes, la suppression des guérillas
locales et des famines y a contribué, mais plus encore
les médecins qui se sont consacrés à préserver les
santés et les vies des « colonisés ».
Si brillantes au Moyen Age, les médecines arabe et
juive avaient disparu de la régence où n'existait
plus, en 1830, un seul hôpital.
Dès les premiers combats de Sidi-Ferruch
les chirurgiens militaires offrirent leurs soins aux
musulmans blessés. Par la suite, les 38 grands
hôpitaux militaires édifiés en quinze ans s'ouvrirent
aux autochtones. Se retirant peu à peu devant les
médecins civils, les militaires continuèrent à assumer
la santé publique des Territoires du sud et du Sahara.
Ils contribuèrent grandement à combattre le paludisme
grâce à la quinine instaurée par un des leurs,
Maillot, en 1834 à Bône et, plus tard, la découverte à
Constantine, par Laveran, de son agent pathogène,
l'hématozoaire.
Les indigènes ont bénéficié à égalité,
sans apartheid, de toute l'organisation médicale
française : centre hospitalo-universitaire
d'Alger, l'un des premiers de France, 30 000 lits
d'hôpitaux en 1959 (programmés 48 000 pour 1964),
Institut Pasteur d'Alger dirigé par les célèbres
frères Sergent (nés dans le Constantinois) et un corps
médical peut-être unique au monde, les « médecins
de colonisation ».
Loin de tout et de tous parmi des
populations d'abord réticentes, puis confiantes et
d'une touchante reconnaissance, secondés plus tard par
de remarquables infirmiers indigènes puis des « infirmières-visiteuses
coloniales » européennes, disposant à la
fin de 76 hôpitaux auxiliaires de 34 lits
dans leurs 273 circonscriptions couvrant les 9/10
du pays, ils avaient à soigner près des deux tiers de
la population.
Ainsi les épidémies avaient peu à peu
disparu ainsi que des maladies comme la variole, la
mortalité infantile régressé, les accouchements
dramatiques étaient secourus. Et quand, a partir de
1940, se répandit une terrible endémie tuberculeuse
qui menaça réellement les autochtones d'un génocide,
elle fut jugulée en quelques années grâce à une
coûteuse organisation hospitalière et médicamenteuse,
dans l'effort de tous.
On ne saurait insister assez sur
l'altruisme désintéressé avec lequel se sont dépensés
sans compter les soignants, non sans lourds
sacrifices. Des centaines de religieuses, dont les
premières débarquant peu après 1830, avaient donné
l'exemple de l'abnégation ; dans l'intérieur du
pays plusieurs hôpitaux pour les indigènes avaient été
fondés par le cardinal Lavigerie. A tous les échelons
les équipes franco-indigènes constituaient des unités
modèles.
Seule ombre au tableau : le petit
nombre de médecins musulmans. Ce n'était pas faute
d'incitations et d'encouragements : dès 1833 le
célèbre médecin militaire Baudens avait ouvert pour
les Maures et les juifs des cours à l'hôpital installé
dans les jardins du dey. A la différence de ceux-ci,
qui devinrent proportionnellement plus nombreux dans
la profession que les Européens de souche, les
musulmans s'avéraient plus attirés par d'autres
carrières libérales, mais surtout pâtissaient d'un
décalage dû à la résistance prolongée des familles,
sur laquelle nous reviendrons, à rencontre de
l'enseignement français.
Aujourd'hui :
« Du temps des Français (propos
d'un employé d'hôpital en Kabylie à l'étudiant
stagiaire anglais) c'était un hôpital et un vrai...
Ah ! c'était le bon temps ! » (lan
Young), Scènes de la vie privée de l'Islam,
Alain Moreau, édit. 1979.
« On dit souvent qu'il faut
soigner d'abord nos hôpitaux, ensuite les malades
qu'ils accueillent... Il y a même des médecins et
des professeurs qui ont tout bonnement estimé ne
plus pouvoir exercer leur métier dans les centres
hospitaliers comme celui de Mustapha-Pacha, tant les
conditions d'hygiène y sont devenues
intolérables. » (L'hôpital, ce grand
malade, Algérie-Actualité, 28 octobre 1986.)
LES COLONS ENRICHIS PAR LA SPOLIATION
DES TERRES ET L'EXPLOITATION DES INDIGENES ?
« Fortunes impures... » (J.
Chaban-Delmas); « Le colonat avait dépossédé
la paysannerie algérienne de ses terres »
(livre d'histoire de terminale, Nathan édit.); « Les
gros colons qui ont fait suer le burnous... Le gros
colonat profiteur, l'ennemi plus encore que le
F.L.N. n'est-il pas, en majeure partie, responsable
de bien des maux ? » (Pierre
Montagnon, officier, défenseur acharné de l'Algérie
française), La Guerre d'Algérie. Pygmalion
édit., 1984.
Pour en finir avec cette tenace légende,
il est nécessaire de bien savoir qu'en 1830 les
structures foncières du pays, ainsi que le travail de
la terre, étaient très différents de l'Europe, et
d'entrer dans des précisions un peu arides, si
schématiques soient-elles.
Le pouvoir occupant et des notables
turcs détenaient un fonds considérable, cependant des
seigneurs autochtones possédaient de vastes domaines,
confiés généralement à des métayers au cinquième
(khammès). Par ailleurs, des legs religieux
constituaient les biens dits «habous»,
inaliénables.
Et des surfaces étendues restaient en
friche.
Après 1830 les terres turques furent
dévolues aux Domaines. Il s'écoula peu d'années pour
que les biens habous le soient aussi. Avec, en
compensation, prise en charge par l'Etat des dépenses
du culte : locaux et personnel de
442 mosquées au début de notre siècle, auxquelles
s'étaient ajoutées 20 nouvellement construites.
Selon l'usage du temps, furent
confisquées des terres de tribus rebelles coupables
d'exactions réitérées en Mitidja, et surtout après la
grande révolte de 1871 en Kabylie. Une partie sera par
la suite rétrocédée ou rachetée.
Au total plus de 2 millions
d'hectares revinrent aux Domaines.
A mentionner également des remembrements
cadastraux autour des centres de colonisation, qui
n'allèrent pas sans des réductions de superficie,
compensées par des aménagements d'hydraulique ou de
voies d'accès.
En revanche, à la fin du Second Empire,
furent déclarées légalement propriétaires les tribus
ayant jouissance traditionnelle de terres. Plus près
de nous, des surfaces cultivables nouvelles
s'ajoutaient grâce à la restauration des sols en pente
(100 000 hectares en 1954, 1 million
escompté en quinze ans), et par les forages sahariens,
comme à Ouargla.
Sur les terres en sa possession l'Etat
vendit ou, selon les époques, céda gratuitement des
concessions aux colons français, très exiguës d'abord
puis des surfaces plus importantes, ainsi que, surtout
au Second Empire, et le plus souvent à des sociétés
capitalistes, de très vastes étendues moyennant de
lourdes charges pour le bénéficiaire, telle la
construction du chemin de fer de l'alfa.
Par ailleurs des colons achetaient de
gré à gré, mais freinés jusqu'en 1871 par l'autorité
militaire ne les y autorisant qu'en territoire civil,
lequel représentait alors le vingtième du pays. C'est
après l'avènement de la République que, en voulant
appliquer la règle française « nul n'est
tenu de rester dans l'indivision », la « loi
Warnier » porta le plus grave préjudice à
la propriété familiale indigène, dont un quart passa
en d'autres mains, pas toujours européennes. Emus par
les conséquences désastreuses pour les autochtones, ce
furent les colons eux-mêmes qui obtinrent, au bout de
quelques années, l'abrogation de cette loi.
Répétons, d'autre part, que l'éthique
musulmane se trouvait très éloignée des mentalités et
des méthodes du cultivateur européen chez ces
populations plus pastorales que sédentaires,
paisiblement abandonnées à la volonté divine :
aucun souci d'améliorer le rendement, les façons de
culture ancestrales, un réel mépris pour le travail de
la terre, confié si possible aux femmes ou à des
khammès en quasi-servage.
Deux phases de la colonisation sont à
distinguer : d'abord celle des pionniers aux
souffrances indicibles, à l'effrayante mortalité, aux
ruines sans nombre, dans les plaines marécageuses de
la Mitidja ou de Bône, les maquis sahéliens de
palmiers nains et de lentisques, les étendues arides
d'Oranie. Ce ne sont pas les autochtones qui ont
drainé, défriché, irrigué, planté, mais l'armée puis
des concessionnaires français, souvent impréparés à de
telles tâches, de rudes travailleurs espagnols,
italiens et aussi des allemands et d'autres européens
«émigrés de la misère». Par leur labeur héroïque les
terres les plus abandonnées devinrent les plus
fécondes.
Seconde phase : celle des cultures
plus rémunératrices et raffinées requérant une
main-d'œuvre abondante, la vigne puis les agrumes, les
primeurs, assurant une certaine prospérité dont ont
bénéficié les indigènes, se décidant à proposer leurs
bras. Il fallut leur en apprendre les techniques et si
leurs salaires n'ont pu atteindre d'emblée ceux des
ouvriers européens, ils ont permis à de très
nombreuses familles de vivre : un million et demi
pour le seul vignoble, lequel employait dix fois plus
de travailleurs que les céréales. Plutôt que de
vilipender des colons prétendument enrichis en
affamant les indigènes, il est plus juste de renverser
la proposition : peu nombreux à faire fortune,
ils ont assuré l'existence de beaucoup.
Au surplus, nombre d'entre eux y
ajoutaient, en faveur de leurs ouvriers, des
réalisations sociales peu habituelles à l'époque chez
les propriétaires terriens d'Europe. Mais voici ce que
rapportent d'une visite à l'ancien domaine d'Henri
Borgeaud (1 200 hectares anciennement défrichés
par les Trappistes), présenté comme type du gros
colonat, les jeunes « Beurs » se
rendant en Algérie pour un volontariat civil de
quelques semaines : « Borgeaud, un
colon qui avait établi un empire; les gars qui
travaillaient là étaient comme des esclaves ;
il avait sa propre monnaie. » (Dr Nacer
Kettane, fondateur-directeur de Radio-Beur, Le
sourire de Brahim, Denoël édit., 1985).
Probablement s'agissait-il de jetons
donnant accès à la cantine scolaire ou à quelque autre
réalisation ? Mais le Dr Nacer Kettane a
l'honnêteté d'évoquer le sort d'ouvriers insatisfaits
dans une coopérative agricole nouvelle... Lentement
les rendements des céréales s'amendaient ; les
surfaces des autochtones étaient passées d'un million
d'hectares en 1850 à deux millions et demi en 1954 et
de nouveaux pionniers européens étendaient le blé à
des zones plus aléatoires comme le Sersou.
L'agriculture algérienne devenait très
scientifique grâce à un institut agricole à
Maison-Carrée en liaison avec l'Institut Pasteur, deux
écoles régionales, sept écoles pratiques, qui
réuniront en 1960 2 600 élèves dont 1 800
musulmans, alors que ceux-ci les avaient longtemps
boudées.
En 1954 les Européens possédaient
2 750 000 hectares dont 600 000 de
cultures dites riches, les indigènes 10 millions
dont 4 250 000 arables. Parmi ces derniers,
plus nombreux étaient les propriétaires de plus de
cent hectares (8496) que les Européens (6587) et
8 000 Européens possédaient moins de
10 hectares...
Loin d'être spoliée l'agriculture
indigène avait bénéficié de multiples encouragements.
Mais toutes les tentatives de colonisation par les
fellahs eux-mêmes s'étaient autrefois soldées par des
échecs. Cependant, depuis 1880, les « sociétés
de prévoyance » avaient peu à peu modifié
l'esprit des cultivateurs. Coopératives et mutuelles,
par lesquelles avait été transformée la situation des
colons européens, les accueillaient eux aussi de plus
en plus nombreux. A partir de 1936, une politique de
paysanat fut mise en œuvre; dix ans plus tard des
secteurs d'amélioration rurale assumaient le
reclassement, la mécanisation de petits possédants
qu'encadraient des conseillers techniques formés au
séminaire de Rovigo, 150 en 1959, 1050 prévus en 1962.
Ce n'étaient pas moins de 2 millions d'hectares
qui entamaient leur transformation : une véritable
réforme agraire.
Dans les dernières décennies les colons
commençaient à céder la place aux indigènes, surtout
dans le Constantinois et les vallées kabyles. Dès 1937
les achats de ceux-ci l'emportaient sur ceux des
Européens : de 100 000 hectares au cours de 1954.
Progressivement ils s'élevaient de degré en degré dans
les domaines aux fonctions auxquelles les Européens
les avaient initiés. Aujourd'hui, l'Algérie doit
acheter trois fois plus de céréales qu'elle n'en
produit, bien que deux tiers du vignoble aient été
arrachés.
« Comment se fait-il que le
colon français ait été capable de tirer
40 quintaux d'une parcelle de terre alors que
toi tu n'en tires que 10 ? Serais-tu un quart
d'homme ? », AlShaab,
8 juin 1956.
NUIT COLONIALE, GRISAILLE
INTELLECTUELLE !
«La France n'a su ni voulu imposer
l'enseignement obligatoire», P. Montagnon, op.
cit. « Avant 1962 seulement 2 % des
enfants musulmans apprenaient le français. »,
Pierre Branche, le Figaro, 15 octobre
1986.
Dans la Berbérie de 1830, seul existait
un enseignement religieux, uniquement pour les
garçons, en de nombreuses écoles coraniques,
approfondi par quelques-uns dans des médersas ou des
confréries (zaouias). En 1847, le duc d'Aumale, alors
gouverneur, demanda vainement aux « tolbas »
d'élargir leur enseignement à des connaissances
profanes. Des écoles arabes-françaises furent alors
ouvertes avec un certain succès : Coran le matin,
et, l'après-midi, des matières de base en français.
Dans le même temps, des initiatives de
dames françaises, puis de religieuses, s'efforcèrent
d'attirer des fillettes musulmanes dans des ouvroirs,
glissant à la faveur de travaux artisanaux quelques
rudiments d'instruction, peu souhaités par les pères.
La IIIe République voulut, en ses visées
assimilatrices, uniformiser l'enseignement des garçons
dans ses écoles primaires ; il y eut un recul des
familles redoutant un détournement de leur éthique
traditionnelle. Par contre, en Kabylie, des Jésuites,
auxquels succédèrent des Pères Blancs et des Sœurs
Blanches du cardinal Lavigerie, fondèrent avec succès
des écoles adaptées. Elles inspirèrent les « écoles
ministérielles » instaurées elles aussi en
Kabylie, par Jules Ferry en 1881.
Alors commença une geste, comparable à
celle des médecins de colonisation. A partir de 1891,
à l'Ecole normale d'instituteurs de Bouzaréa, une « section
spéciale » prépara à l'enseignement des
enfants indigènes : en 1937 1 200
sectionnaires avaient été ainsi formés. Dans le même
temps, des élèves-instituteurs kabyles étaient
fraternellement admis, suivant la filière normale —
près de 1 000 déjà en 1937.
Ces enseignants du bled accomplirent
leur tâche avec une abnégation de missionnaires, dans
de très rudes conditions matérielles et morales, ayant
à convaincre des parents longtemps hostiles. Peu à peu
ils devinrent tout à la fois, selon les termes d'un
recteur, « instituteurs, infirmiers,
agriculteurs, écrivains publics, guides et
conseillers d'une population qui les a vénérés comme
des saints ». Leur plus belle récompense
était la reconnaissance de leurs écoliers, à nombre
desquels ils insuffleront leur propre vocation.
Après une longue incubation, sans doute
aussi à la faveur de la guerre de 1914-1918, durant
laquelle soldats et ouvriers partis dans la métropole
s'étaient familiarisés avec une civilisation
farouchement récusée jusque-là, un retournement se
faisait sentir. Il devint une ruée, des garçons et,
avec un retard de quelques années des filles
elles-mêmes. Dès lors s'engagea une course poursuite
entre la marée démographique et la construction
d'écoles, le recrutement d'enseignants. En 1960,
39,2 % des enfants musulmans étaient scolarisés
(et non pas 2 %, Monsieur Branche, qui n'avez
retenu que la décimale) sur les mêmes bancs que les
petits Européens; non sans évidemment de grandes
inégalités régionales : à Alger, Oran, près des
trois quarts; dans l'intérieur du pays entre 40 et
15 %. Qu'on se représente les difficultés dans
des douars reculés ou chez les grands nomades du
Sud : il y eut même des écoles sous tentes !
La guerre d'Algérie, malgré la
destruction de nombreux locaux, n'avait pas ralenti
cette expansion, en partie grâce aux militaires des
S.A.S. et aussi à des innovations originales comme les
centres éducatifs. Ainsi Akbou, en pleine Kabylie,
comptait 50 % d'enfants scolarisés en 1961.
Désormais les filles aspiraient, non plus seulement à
un enseignement ménager ou artisanal, mais à une
formation professionnelle ou intellectuelle
moderne ; une section féminine d'adaptation de
l'enseignement fut mise sur pied dès 1949.
Pour les garçons était créé un
enseignement technique ; il ne leur inspira guère
d'attrait, considérant que l'instruction devait les
mener à des carrières plus intellectuelles. Mais le
long refus avait retardé de près de cent ans, si l'on
compare à leurs contemporains israélites, leur
ascension massive à l'enseignement secondaire et
supérieur. Cependant le décalage allait se rattraper :
effectivement le nombre des étudiants musulmans tripla
en 1943 et 1955.
Complétant les possibilités offertes,
les trois médersas créées en 1850 s'étaient ouvertes à
une scolarisation partiellement française, pour
aboutir en 1951 à leur transformation en lycées
franco-musulmans, un établissement y étant ajouté pour
les filles.
Leur accession à toutes les carrières
est illustrée par un palmarès des originaires de
Laghouat établi en 1950 : un avocat parisien, un
interne des hôpitaux de Paris, cinq professeurs de
lycée, deux professeurs de médersa, un directeur de
médersa en Mauritanie, seize instituteurs, un
imprimeur-éditeur à Alger, quinze officiers dont trois
supérieurs, trois interprètes au Maroc. Au moins aussi
féconde avait été la Kabylie. Parmi vingt-huit
ingénieurs, l'un des deux polytechniciens, Salah
Bouakouir atteignit le sommet de la hiérarchie
administrative, directeur du Commerce, de l'Energie et
de l'Industrie en 1954, secrétaire général adjoint
pour les Affaires économiques en 1960.
Parallèlement, l'Algérie a suscité un
véritable bouillonnement intellectuel et artistique.
Comme l'avait prédit Ernest Renan, « l'exploration
scientifique de l'Algérie sera l'un des titres de
gloire de la France au XIXe siècle ».
Chacun de ses chapitres s'orne de noms devenus
célèbres : géographes et géologues, préhistoriens
et historiens, archéologues romains et berbères (pas
moins de douze musées d'archéologie à travers
l'Algérie !), ethnologues, islamologues,
arabisants, berbérisants... Le Gouvernement général
donnait l'exemple, publiant au fil des années :
Exploration scientifique de l'Algérie,
40 volumes. Collection du Centenaire,
37 volumes, Documents algériens,
300 plaquettes.
Douze sociétés savantes œuvraient de
concert avec la Revue africaine qui publia durant cent
six ans 500 pages annuelles. L'Université
d'Alger, seconde de France, ajoutait aux chaires
habituelles des enseignements et treize instituts
concernant l'Algérie, l'Islam, le Sahara. Des
musulmans lui apportaient leur concours, les
Bencheneb, les Ben Sedirah, les Soualah, etc.
Et la Bibliothèque nationale, transférée
en 1959 de son délicieux et inconfortable palais
mauresque en un édifice admirable à tous égards, au
centre de la capitale algérienne, alimentait par
bibliobus 310 bibliothèques disséminées dans le
pays.
Une presse très développée, des maisons
d'édition fort actives (Jourdan, plus tard Baconnier,
entre autres), des conservatoires à Alger, Oran,
Constantine, faisaient une place aux musiques locales,
une société férue de musique, visitée par les plus
grands artistes, une architecture néo-mauresque aux
intéressantes réalisations, constituaient un ensemble
peu commun.
La beauté des paysages, la qualité de la
lumière, l'originalité, la variété des types humains
avaient inspiré de nombreux peintres, à commencer par
l'école « Orientaliste ». Aidés
par des mécènes locaux, trois importants musées des
Beaux-Arts, chacun dans les principales villes,
étaient complétés à Alger par une école des Beaux-Arts
et par une « Villa Abd el Tif » recevant
pour des séjours de deux ans deux boursiers peintres
ou sculpteurs.
Dans l'épanouissement littéraire, à côté
des « algérianistes », et de ceux
qui cultivaient la langue nouvelle du petit peuple
européen, deux noms restent célèbres : notre prix
Nobel, Albert Camus, d'ascendance modeste, et Paul
Robert, fils de colon qui, avant d'entreprendre
l'œuvre immense de son dictionnaire, avait écrit une
thèse sur la culture...des agrumes.
Grisaille intellectuelle ? Aucune
autre province française n'a engendré un pareil
siècle.
Témoignages nostalgiques
d'aujourd'hui :
« Effectivement il existait une
littérature très importante et très riche. Il y
avait une très grande animation. Le niveau était
très élevé. Alger était une grande capitale
intellectuelle. Des Algériens collaboraient. »
(Laadi Flici, El Moujahid, 26 juin 1985).
« Alger n'est qu'un gros
village sans particularités, sans âme, sans
identité. » (Meziane Ourad, Algérie-Actualité,
13-19 mai 1986.)
UNE ETHNIE ANNIHILEE ?
« Une bête immonde, du nom de
colonialisme, était venue annihiler leur
personnalité, leur identité, leur langue.» (Dr
Nacer Kettane, op. cit.)
Récusant évidemment « bête
immonde » et aussi le terme
« colonialisme» totalement inadéquat à
l'Algérie, dont on a pu nier qu'elle fût une colonie,
à tout le moins différente de toute autre, « unique
en son genre » selon l'expression de
l'historien anglais Alistair Horne, nous allons tout
de même réfuter les trois assertions qui précèdent.
Annihiler leur personnalité ? Si
l'on entend par là les efforts accomplis pour donner à
des populations demeurées dans un état médiéval,
accablées par des siècles d'une occupation turque
stérilisante, accès a la civilisation occidentale et
en faire peu à peu nos égaux : peut-être... Mais
n'aurions-nous rien fait dans ce sens, de quels
reproches encore pires serions-nous abreuvés par ceux
qui, à l'inverse, estiment que ce ne fut pas
assez !
Certes notre civilisation, telle qu'elle
a évolué, n'est pas en tous points bénéfique. Mais
même sans notre présence durant plus d'un siècle, la
Berbérie aurait-elle pu demeurer à l'abri du désir
d'occidentalisation qui a gagné toute une partie du
monde islamique ?
Les musulmans d'Algérie n'en avaient
point pâti quant à leur personnalité. La société
d'autrefois s'était modifiée par l'amenuisement des
hiérarchies féodales et le développement d'une classe
moyenne vivant dignement à l'européenne, ayant acquis
à notre exemple le goût du travail, la prévoyance du
lendemain, le sens des responsabilités.
Leur fidélité religieuse n'en était pas
affectée pour autant. A l'abri de toute pression, les
chrétiens, freinés d'ailleurs par la neutralité
officielle, ayant rapidement renoncé à un prosélytisme
actif, l'Islam maghrébin avait conservé toute sa
spécificité. S'il a été combattu, ce fut par une autre
fraction de l'Islam, le mouvement réformiste ayant
pris origine, dans le début du siècle, au
Proche-Orient, non exempt de connotations politiques.
Alors que rien dans l'Algérie « colonisée »
ne pouvait influencer fâcheusement la personnalité
autochtone, par contre il n'en fut pas de même dans la
métropole, lorsque l'émigration devint nécessaire pour
aider à vivre une population dont la prolificité
excédait les possibilités nourricières du pays. Mais
que devrait-on dire actuellement où les immigrés y
accourent sans raison impérieuse ? La
décolonisation ne les a-t-elle pas dotés des richesses
sahariennes, grâce auxquelles ils pourraient vivre
chez eux à leur aise ? A ne considérer que le
souci très légitime de garder leur identité, ne
serait-il pas préférable qu'ils demeurent dans leur
cadre naturel ?
Car l'on peut comprendre le profond
malaise, encore aggravé par la désinformation sur ce
que fut l'Algérie française, éprouvé par cette
génération dont fait partie Nacer Kettane, tiraillée
malgré tout entre la patrie de ses aïeux et la forme
de civilisation à laquelle elle a goûté.
Annihiler leur identité ?
Certainement pas une identité nationale, bien au
contraire suscitée par l'œuvre unificatrice des
Français, qui aussi l'ont confortée en exhumant et
mettant en valeur tout un patrimoine oublié,
indifférent à ses héritiers : prospectant les vestiges
romains, berbères et musulmans, explorant le brillant
passé d'anciennes capitales, Tahert, Kalaa, Bougie,
Tlemcen, collectant des manuscrits anciens,
reconstituant la trame historiques de siècles obscurs
et proposant ces découvertes à la connaissance de
tous, étudiant les particularités religieuses,
confréries, culte des saints, ainsi que les traditions
berbères d'une antiquité préhellénique, recueillant ce
qui persistait du fonds oral et encourageant leurs
adaptations théâtrales, s'intéressant aux poèmes, aux
chants, aux musiques arabes et berbères en
sauvegardant leur intégrité dans les conservatoires,
tout en les diffusant sur les ondes...
Les musées exposaient des pièces
anciennes, tapis, tissages, broderies, dentelles,
ébénisterie, poterie. Ces arts mineurs, si menacés de
nos jours, avaient fait l'objet de patientes
investigations, les tapis en particulier sur les lieux
de production (Tlemcen, Guergour, Mzab), et un service
de l'artisanat, compétent et rigoureux, veillait à la
conservation des pures traditions. Il n'est pas
jusqu'à l'enluminure qui n'ait été portée à un haut
niveau et enseignée. Osant enfreindre les interdits
religieux, quelques peintres musulmans commençaient à
révéler leurs talents. Il ne semble pas qu'ils aient,
a l'époque, perturbé des défenseurs inconditionnels de
l'identité.
Annihiler leur langue ? Ce n'est
pas dans notre Algérie que leur langue a été menacée,
mais en France, chez les émigrés installés avec leurs
familles. La seconde génération emploie moins
volontiers l'arabe ou le berbère que le français, si
même elle ne les ignore.
Au temps de la colonisation
l'enseignement en français n'avait en rien nui aux
langues locales qui continuaient à être couramment
parlées, un peu moins le berbère : ayant perdu
depuis des siècles son écriture, il n'avait pu être
retenu comme langue administrative, alors qu'un tiers
de berbérophones peuplait le pays.
L'arabe, enseigné en option dans le
secondaire, pouvait être approfondi dans les medersas
et, ainsi que le berbère, à la Faculté, en sa
littérature et ses dialectes, auprès de maîtres de
grande notoriété. De tout temps des Européens furent
de fins arabisants, traducteurs arabes.
Radio-Alger diffusait régulièrement des
émissions en arabe et en berbère et une presse en
langue arabe n'avait cessé de paraître. Des musulmans
d'Algérie parmi les plus éminents ont écrit leurs
œuvres en arabe. Un exemple significatif est celui du
cheikh Benalioua, dont les textes d'un niveau
spirituel et intellectuel exceptionnel ont connu un
rayonnement dans une élite occidentale, bien que très
partiellement traduits encore en français et en
anglais.
Une cohorte de romanciers, souvent des
instituteurs, fit une brillante entrée dans la
littérature francophone, le français leur apparaissant
un meilleur mode d'expression et de diffusion; ils
n'éprouvaient certainement pas, du moins la plupart,
le sentiment de se dépersonnaliser en n'usant point de
leur langue maternelle (souvent le berbère).
Le bilinguisme vers lequel tendait
l'Algérie n'apportait-il pas un enrichissement sans
nullement porter atteinte à l'identité ? Les
Algériens d'aujourd'hui l'ont compris, qui n'ont pas
éliminé le français de leur enseignement : la
presse la plus importante continue à être rédigée dans
notre langue ; et l'on est frappé par l'élégance
et le raffinement du style des rédacteurs, que
pourraient leur envier bien de leurs confrères
métropolitains. Cette francophonie solidement
implantée reste l'un des vestiges les plus tangibles
de notre temps révolu.
Nous nous sommes limités à cinq
contre-vérités parmi les plus grossières et les plus
répandues. Il en est bien d'autres : en
particulier les relations existant naguère entre les
ethnies ne cessent d'être dénaturées par l'audiovisuel
et l'imprimé.
Exemples : le film « La
dernière image » réintitulé par Marie Elbe
« La dernière caricature », ou encore, dans
l'émission plusieurs fois citée, les termes, repris
avec tant d'insistance, de D. Leconte (« rebut
de la Méditerranée... colonie-dépotoir »)
et de A. Vircondelet (« lie du peuple
français, résidu de différents pays du bassin
méditerranéen ») ont amalgamé, parmi les
premiers arrivants, les parasites passagers des armées
en campagne et des pays neufs avec les pionniers
héroïques, semblant oublier que leur pauvreté n'était
nullement synonyme de lie. Combien les téléspectateurs
auront gardé l'impression que nous étions la
descendance de méprisables aventuriers alors que nous
nous honorons d'avoir pour ancêtres, outre les
défricheurs d'avant-garde, les autres colonisateurs,
honnêtes et courageux ouvriers, artisans, commerçants,
fonctionnaires et militaires se fixant dans le pays —
mille par an pendant de nombreuses décennies —,
déportés politiques de 1848 et 1851 — peu cependant
restèrent —, beaucoup de riverains de la Méditerranée
occidentale, français et étrangers, d'autres aussi de
province, plus éloignées, comme les Alsaciens-Lorrains
en 1871, et de Suisse, d'outre-Rhin, toutes ces
populations d'origines si diverses qu'une ou deux
générations avaient fondues en une communauté
européenne unie.
Entre elle et les communautés
autochtones, contrairement à ce que l'on s'efforce
d'accréditer, une symbiose exceptionnelle était en
bonne voie de réalisation, les Français remplissant un
rôle d'encadrement dont l'Algérie ne saurait se passer
de sitôt, tout en respectant des fidélités à des modes
de vie traditionnels.
Sur une telle cohabitation, la
controverse, hélas ! n'a plus d'objet ;
retenons seulement le plus convaincant autant
qu'émouvant des témoignages : l'accueil
unanimement chaleureux, fraternel, réservé à ceux
qu'on appelle « Pieds-Noirs » par
les Algériens d'aujourd'hui. Voici quelques années le
pèlerinage des anciens d'Oranie à la basilique de
Santa Cruz en fut un éclatant épisode irrécusable.
Il y a là de quoi surprendre, et
peut-être faire réfléchir ceux qui n'ont pas eu le
privilège de vivre dans l'Algérie d'alors, difficile
en soi à se représenter telle qu'elle fut, et plus
encore à travers son image entièrement faussée par la
désinformation malveillante qui continue de sévir.
Pierre
GOINARD.
________________
(1) C'est nous qui soulignons
(2) Alger l'Amour Presses de la Renaissance
1982
(3) Les Pieds-Noirs, Le Seuil, Edit. 1980.
|