
Retour à la première partie Retour à l'accueil
LA VICTOIRE OUBLIÉE (II)

La colonne monte au feu, le chef, le drapeau, les hommes. « Un seul but, la victoire ! » C'est le mot d'ordre qu'ils ont reçu et la devise qu'ils se sont donnée. Ils vont à leur destin d'un pas égal, égaux sous l'uniforme. La route s'annonce longue et périlleuse, il y aura assez de gloire pour tous. « La France a perdu une bataille... », l'Armée d'Afrique et les Alliés sont là. Fait d'armes unique dans son histoire, la mère patrie envahie par l'ennemi sera délivrée par son empire.
Le régime politique et administratif de l'Afrique du Nord, tel qu'il résultait des conventions d'armistice de juin 40, était à bien des égards moins contraignant que dans la mère patrie. Et, si la population eut à y souffrir de sévères privations, en raison des limites de la capacité agricole aggravées par l'intransigeance du blocus maritime britannique et l'exigence outrancière de l'« Afrika Korps » en matière de ravitaillement, les répressions policières et les persécutions raciales y furent sensiblement en retrait sur la métropole.
L'étatisme circonstanciel qui, à l'époque, avait placé les pouvoirs civil et militaire dans une même main, avait également permis, grâce à la compétence et aux qualités patriotiques de certains chefs, de garder intact le capital économique, stratégique et humain de ce vaste territoire. Mieux encore, à la barbe des commissions de contrôle germano-italiennes, ces mêmes chefs étaient-ils parvenus à accroître leur potentiel militaire et à demeurer en étroite intelligence avec les Etats-Unis. De sorte qu'à l'heure du débarquement allié, qui replaçait de facto l'Algérie et le Maroc en état de belligérance contre l'Axe, il suffisait de raccorder le pays et les hommes à l'événement, conformément à la loi et à la tradition républicaine, puis de les entraîner à nouveau dans le bon combat.
Ce fut l'affaire de quelques jours. Répondant au mot d'ordre du général Giraud « Un seul but, la victoire ! », l'Armée d'Afrique renaissante se mettait en marche sous des pluies torrentielles et bravait le feu d'un ennemi supérieurement équipé, ouvrant ainsi une première brèche dans ses défenses et se frayant un chemin vers la gloire dans le bourbier tunisien.
Hélas ! Le désintéressement politique de ce chef et l'abnégation de ses hommes ne désarmaient pas ceux dont la victoire n'était pas le seul but.
L'accession de l'amiral Darlan aux plus hautes responsabilités divisait l'opinion et créait un facteur de discorde. Alger, nouvelle capitale de la France au combat, était aussi la ville aux mille et un complots. Creuset de toutes les forces patriotiques, elle était également le marais de toutes les ambitions pour ceux qui s'étaient en quelque manière donné pour devise « Un seul but, le pouvoir ! »
Georges BOSC
********************************

DES MARÉCAGES DE LA POLITIQUE A LA BOUE DES TRANCHÉES
Vichy face au débarquement allié en Afrique du Nord
C'est dans la journée du 6 novembre 1942 que les Allemands, informés de la progression de l'immense convoi anglo-américain en Méditerranée, pressentirent l'imminence d'un débarquement sur la côte nord-africaine. La décision fut alors prise de renforcer la « Luftwaffe » dans le secteur méditerranéen et le soir du 6 novembre, à 22 heures 15, le général Bœhme, représentant l'O.K.W. (commandement suprême des forces armées allemandes) à la commission d'armistice de Wiesbaden, prévint l'un des délégués français, le colonel Vignal, du survol de la zone libre par une escadre aérienne de la « Luftwaffe » dans la journée du 7.
Le 8 novembre, vers 2 heures du matin, la nouvelle du débarquement éclatait à Vichy et se propageait rapidement, bientôt répercutée par les premières émissions de radio. Immédiatement avertie, la base de Toulon était mise en alerte ; le plan consistant à maintenir la flotte en situation de non-intervention, sauf cas de violation des clauses de l'armistice par l'Axe et sur ordre du maréchal. Le ministère de la guerre, à son tour, était prévenu à 3 heures. Dans l'heure suivante, l'ambassadeur des Etats-Unis faisait remettre une lettre du président Roosevelt à l'adresse du maréchal Pétain pour l'informer de l'envoi en Afrique du Nord d'une puissante armée américaine, afin de devancer une invasion allemande sur ce territoire et de préparer la libération de la France.
Sur le conseil de son médecin, le docteur Ménétrel, le vieil homme ne devait être réveillé qu'à 7 heures mais, entre-temps, un conseil réuni autour du président Laval élaborait un modèle de réponse stéréotypé exprimant surprise et indignation, selon la stricte application de la convention d'armistice. Il fallait qu'un tel texte pût être présenté aux Allemands. A son réveil, après avoir lu le message du président américain, le chef de l'Etat aurait prétendu, qu'il avait rêvé du débarquement. Il ne semblait manifester ni surprise ni mécontentement. Après quoi, ayant pris connaissance de la réponse proposée, il en approuvera les termes et la paraphera.
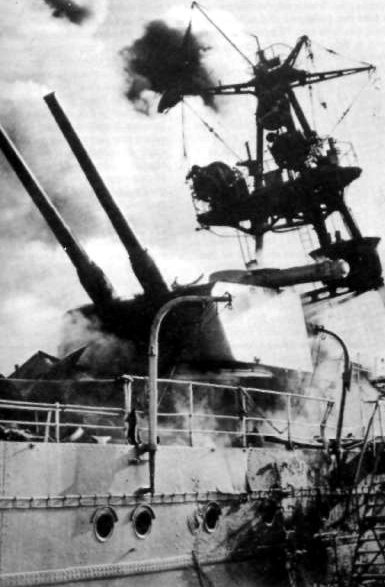
Toulon,
27 novembre 1942 « ...une centaine de
bâtiments
calcinés, chavirés, formant un
gigantesque amas de
tôles tordues... »
Immédiatement, un véritable feu croisé de télégrammes va s'échanger entre Darlan et Pétain. Leur décryptage donnera lieu à bien des controverses de la part des politiques et des historiens. Mais dès lors que l'Empire va entrer dans le bloc allié, que l'invasion de la zone sud devient une certitude et que la flotte, ultime concession arrachée à Rethondes, demeure quasi-intacte dans les eaux de Toulon, l'heure n'est plus à la ruse, ni au double langage, mais à la décision. Bien peu le comprendront ou seront muselés du fait de l'ennemi. Ainsi, tandis que le chef de l'Etat et le commandant suprême des forces armées persistent dans un dialogue stérile et un système suranné, l'Allemagne s'est ressaisie : en tout état de cause, elle a résolu de durcir sa position envers la France.
En conséquence, les nombreux conseils des ministres qui vont se succéder à Vichy ne feront qu'entériner les ultimatums de Berlin. Le 8 novembre au soir, ce sera l'acceptation d'une « aide » de la « Luftwaffe » sur la côte algérienne et la rupture des relations diplomatiques avec les Etats-Unis. L'autorisation pour l'Axe d'atterrir sur l'aérodrome de Tunis-EI-Aouina sera donnée le 9. Douloureux 11 novembre, la « Wehrmacht » envahit la zone libre sans rencontrer la moindre résistance et, le même jour, le général Weygand est arrêté, puis interné en Allemagne ; il sera bientôt suivi par de Lattre de Tassigny, emprisonné à Riom. Les Allemands entrent à Tunis le 12. Le 14, Pétain désavouera officiellement Darlan, Giraud et Noguès, mais, les couvrant par la bande, il se verra à son tour destitué du pouvoir exécutif au profit de Laval le 17.
Le 27 novembre enfin, jour funeste entre tous, sera marqué par deux drames : la dissolution de l'armée d'armistice et, surtout, le tragique sabordage à Toulon de la flotte placée sous les ordres de l'amiral de Laborde. Voilé par la fumée des incendies, le soleil se lève sur le spectacle cauchemardesque offert par une centaine de bâtiments calcinés, chavirés, formant un gigantesque amas de tôles tordues et un enchevêtrement indescriptible de mâts et de poutrelles baignant dans le mazout. Un bilan désastreux : 3 cuirassés, 7 croiseurs, 1 transport d'aéronefs, 29 torpilleurs et 12 sous-marins, 230 000 tonnes d'acier au total ont été englouties. Seuls 3 sous-marins, le « Glorieux », le « Marsouin » et le « Casablanca » parviendront à rallier l'Afrique du Nord et reprendront le combat.
Le sabordage de Toulon, accompli sous l'autorité de Vichy, fut néanmoins accueilli dans le monde libre comme un acte de résistance d'une portée exceptionnelle. Ce sacrifice apportait le plus cinglant démenti à Churchill et condamnait à jamais l'agression de Mers-el-Kébir. Les Alliés unanimes rendirent hommage à la marine française. L'événement eut un retentissement considérable de Moscou à Washington et des journaux américains titrèrent à la une « gloire à Toulon ! » Ainsi, l'honneur était sauf, mais à quel prix ?
**********************************
Alger, ville aux mille et un complots
L'amiral Darlan, nouveau pacha d'alger
Le 8 novembre 1942, la politique de patience douloureuse, menée en Afrique du Nord, portait enfin ses fruits. Sans doute, la France qui s'enlisait chaque jour davantage allait en souffrir plus douloureusement, mais la libération ne pouvait être qu'à ce prix.
Darlan, que l'opinion désignait en numéro deux derrière Laval au baromètre de l'impopularité, était réprouvé totalement par Churchill. Il n'en avait pas moins obtenu le ralliement aux Alliés des chefs militaires et des hauts responsables civils de l'Algérie et du Maroc. L'Afrique Occidentale Française n'allait pas tarder à se rallier à son tour sans combat. Seule la Tunisie manquait à l'appel. Le bilan n'était pas négligeable et Roosevelt, réprimant quelque peu son aversion pour l'amiral, sentiment fondé sur son passé pro-allemand, en était arrivé à le tolérer comme un pis-aller. Eisenhower, en revanche, et surtout Murphy, qui le connaissait de longue date en bien et en mal, étaient mieux disposés à son égard. Sans doute voyaient-ils juste : tandis que Giraud manifestait ouvertement son désintérêt pour la politique, Darlan s'était plongé activement dans les dossiers et sa capacité à gérer les affaires déchargeait d'autant le commandement allié.

Alger,
novembre 1942 : L'amiral François Darlan
et le
général Henri Giraud en conversation au Palais d'Eté.
L'intérêt militaire exigeait une rapide et totale réconciliation de l'ensemble du haut commandement français, « légalistes » et « conjurés » réunis. Le général Juin, commandant en chef des forces armées en Afrique du Nord depuis le rappel du généralissime Weygand, en novembre 1941, s'employa pour sa part, non sans mérite, à faire reconnaître par l'ensemble l'autorité suprême du général Giraud.
L'amiral Darlan, quant à lui, devait se charger de rallier la flotte de Toulon ; démarche à laquelle le général Clark était particulièrement attaché. Il intervint donc dès le 10 novembre et multiplia ses relances en pure perte ; l'amiral de Laborde se montra intraitable. Seul le maréchal aurait pu le fléchir alors que Laval était à Berlin, mais il n'osa pas. Cet échec devait affecter Darlan au plus haut point. De même échoua-t-il dans ses tentatives en vue de rallier l'amiral Estéva, résident général à Tunis, et l'Amiral Derrien, préfet maritime de Bizerte.
C'est le 13 novembre qu'au sein du haut commandement français à Alger fut admis solennellement le principe de la sécession provisoire de l'Afrique d'avec la métropole et celui de la coopération totale avec les Alliés. Il fut également décidé que l'amiral Darlan prenait la tête du gouvernement civil et politique avec le titre de haut-commissaire en Afrique. Le général Giraud devenait commandant en chef des forces françaises, le général Juin conservant pour sa part le commandement en chef des forces terrestres en Afrique du Nord. Les gouverneurs Châtel pour l'Algérie et Boisson, en cours de ralliement, pour l'Afrique Occidentale Française, gardaient leurs titres, de même que le résident général Noguès au Maroc. Avertis par Clark en début de matinée, le général Eisenhower et l'amiral Cunningham, représentant respectivement les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, embarquaient dans une « Forteresse volante » à Gibraltar et se posaient vers midi à Maison-Blanche. A 13 heures, ils étaient à l'hôtel Saint-George et, à 14 heures, s'ouvrait la conférence avec les Français. A 15 heures, l'affaire était bouclée ; l'accord reconnu verbalement devant être soumis, pour approbation définitive, à Franklin Roosevelt et Winston Churchill.
Les - Accords Darlan-Clark -
Séquelle d'un armistice humiliant, l'antagonisme qui opposait le camp des officiers « conjurés », Mast, Béthouart, Monsabert, Jousse, Baril, Chrétien, Beaufre, à celui des « légalistes », Darlan, Noguès, Moreau, Kœltz, Bergeret, Mendigal, Boissau, Welvert, ne pouvait s'éluder en un tournemain.
En un premier temps, l'heureuse issue de la conférence franco-alliée du 13 novembre, qui devait beaucoup à la diligente médiation de Juin en faveur de Giraud, avait une signification politique capitale puisqu'elle sanctionnait la rupture entre l'échelon d'Etat, en voie de création à Alger, et le gouvernement de Vichy, de même qu'elle scellait la rentrée en guerre de l'Empire aux côtés des Alliés. Elle allait conduire, le 22 novembre, au ralliement sans coup férir de l'Afrique Occidentale Française et à la signature d'un véritable traité d'alliance militaire connu sous le nom d'« Accords Darlan-Clark ».

Alger,
novembre 1942 : Le général Eisenhower,
l'amiral
Darlan et le général Clark.
Ce même 13 novembre, un télégramme de Vichy transmis par l'amiral Auphan, secrétaire d'Etat à la Marine, et semblant émaner du maréchal, parvient à Darlan sur le cable secret de l'Amirauté. Dans ce bref message, le chef de l'Etat dit approuver confidentiellement l'entente avec les Alliés mais doit officiellement souscrire au « diktat » de l'occupant. Voici le texte de cette dépêche « Accord intime du maréchal et du président Laval (sic) mais décision officielle soumise autorités occupantes(1) ».
____________________
(1)
Dans les heures qui suivirent le débarquement, le transfert du
maréchal Pétain de Vichy à Alger fut
sérieusement envisagé. Le colonel pilote Chassin ou
tout autre eût pu aisément l'enlever d'un coup d'aile.
Le chef de l'Etat s'y refusa en raison de son grand âge, 86
ans, et conformément à sa fameuse formule « j'ai
fait don de ma personne à la France ». La présence
du maréchal dans le camp allié eût notablement
influencé l'histoire.
Cette pièce capitale et d'une authenticité indiscutable, dite de « l'accord intime », survenait au moment le plus favorable pour l'amiral Darlan et son entourage, libérant enfin les consciences encore indécises. Ayant informé Clark, et fort du soutien de Pétain, Darlan faisait, le 15 novembre, la déclaration suivante :
« Depuis l'invasion de la zone libre, contre laquelle il a protesté autant que les circonstances le lui permettaient, le maréchal se trouve dans l'impossibilité de faire connaître sa pensée intime aux Français. Tous les moyens de transmission sont, en outre, sous le contrôle allemand.
Le maréchal m'a télégraphié le 9 novembre qu'il était satisfait de ma présence en Afrique du Nord, me renouvelant encore l'assurance de sa confiance absolue.
Le 11 novembre, me croyant privé de ma liberté, il a donné délégation de pouvoirs au général Noguès.
Le 13 novembre, le général Noguès me remettait, avec l'assentiment du maréchal, les pouvoirs qui lui avaient été dévolus.
Dans ces conditions, je déclare : les légionnaires et fonctionnaires de tous rangs, les officiers, sous-officiers et soldats des armées de terre, de mer et de l'air en Afrique du Nord qui ont prêté serment au maréchal doivent considérer qu'ils sont fidèles au maréchal en exécutant mes ordres.
Je prends pour moi seul la responsabilité de cette décision, qui n'a pour unique objet que d'assurer le bien de l'Empire et l'Unité nationale. Je désigne comme chef militaire le général Giraud, qui a toujours servi la France avec honneur.
Le 15 novembre 1942.
L'amiral de la Flotte Darlan ».
Naturellement, l'amiral était, en retour, officiellement cloué au pilori et sa proclamation se voyait totalement désavouée par Vichy, tandis que, le surlendemain 17 novembre, le maréchal Pétain était démis de son pouvoir au profit de Laval.
A peine les décisions relatives au partage des pouvoirs politiques et militaires étaient-elles prises pour l'Afrique du Nord qu'on se préoccupa du sort de l'Afrique Occidentale Française, désormais isolée et coupée de tout contact avec la métropole. Dakar, base stratégique de la plus haute importance apparaissait nécessairement liée au bloc algéro-marocain. Elle devait, sans différer, jouer son rôle d'escale aérienne entre l'Amérique et l'Afrique, et servir de bastion sur l'Atlantique dans la lutte anti-sous-marins. On savait le gouverneur général Boisson foncièrement patriote et légaliste, à la manière de Weygand dont il partageait étroitement les idées.(2) Ainsi, avait-il réussi à maintenir l'Afrique Occidentale Française hors de toute intrusion de l'Axe, hormis la brève mission du conseiller Meellhausen, alias Martin, qu'il s'attacha à berner systématiquement. Il s'était, de la même façon, opposé avec une grande fermeté au raid anglo-gaulliste du 23 septembre 1940. Désigné par Darlan, avec les encouragements de Clark, le général Bergeret s'envolait le 14 novembre pour Dakar, porteur de l'« accord intime » et de l'offre de ralliement. Il n'eut guère de difficultés à convaincre Boisson qui, dès le 15, réunissait à son tour une sorte de conseil de défense afin de définir les modalités d'accord avec les Alliés. L'amiral Collinet devait s'y montrer le plus réticent. Sa mission accomplie, Bergeret regagnait Alger le 16, suivi de près d'une délégation militaire chargée par Boisson de vérifier l'authenticité de l'« accord intime » et surtout, d'obtenir la reconnaissance absolue par les Américains de l'autorité française sur le territoire de l'Afrique Occidentale Française en contrepartie de son ralliement. Cette clause étant reconnue, les émissaires regagnaient Dakar le 20, les marins finissaient par céder le 22 et, le 23 novembre au matin, le gouverneur général Boisson annonçait le ralliement officiel de l'Afrique Occidentale Française à Darlan et aux Alliés. C'était un incontestable succès pour Darlan qui réussissait par simple négociation là où les canons de la « Navy » et l'expédition gaulliste avaient échoué.
__________________
(2)
Le gouverneur Boisson, aux côtés du général
Weygand, fut l'un des plus ardents opposants au protocole de Paris,
du 28 mai 1941, par lequel l'amiral Darlan, alors au faite de sa
politique de collaboration, comptait engager la France dans
d'inadmissibles concessions au gouvernement allemand. Il ne
s'agissait pas moins que d'autoriser l'Allemagne à utiliser la
base de Bizerte pour le ravitaillement et le renfort de l'« Afrika
Korps » en lui fournissant shipping, escorte maritime,
camions, matériel ferroviaire, voire munitions, et de lui
concéder Dakar comme escale pour ses sous-marins. Le 6 juin, à
l'issue d'un conseil des ministres élargi à la
participation de Weygand, Boisson et Estéva, le maréchal
Pétain rejetait le protocole.
En outre, le ralliement de Dakar apportait sur terre, dans les airs et principalement sur mer, un renfort considérable à la défense commune. Quelque 60 000 hommes de troupe venaient grossir les rangs de l'Armée d'Afrique. Un groupe de bombardiers « Glen-Martin », des avions de grande reconnaissance et de surveillance côtière constituaient une appréciable force d'appoint aéronavale de 90 appareils. Enfin et surtout, c'était le retour au combat d'une magnifique escadre composée du cuirassé « Richelieu », des 3 croiseurs lourds « Gloire », « Montcalm » et « Georges Leygues », des 2 croiseurs légers « Malin » et « Terrible », de 10 avisos, 12 sous-marins et du navire-atelier « Jules Verne » avec leurs équipages au complet, soit 10 000 marins.
Entre-temps, les rapports du pouvoir ayant été communément admis par Darlan, Giraud et Noguès puis entérinés par Eisenhower, il importait de constituer un organe gouvernemental dans les meilleurs délais. Le but essentiel était de remettre une force française dans la guerre aux côtés des Alliés et rien de plus. Aucune orientation politique ne devait être engagée. Hormis l'administration civile, militaire et, à un certain échelon, diplomatique, aucune action ne pouvait être entreprise, aucune décision ne devait être prise avant que la France soit entièrement libérée. Etant admis que le maréchal Pétain, otage des Allemands, n'était plus en mesure d'exercer ses pouvoirs sur un territoire libéré par les Alliés, la base légale du « gouvernement d'Alger » reposait sur un texte constitutionnel, l'article 4 quater du 10 février 1941 relatif à la suppléance et à la succession du chef de l'Etat, la fonction étant, en cas d'empêchement, transférée à l'amiral de la Flotte. C'est ainsi que l'amiral Darlan légitimait son accession au rang de haut-commissaire de France résidant en Afrique française. Le 18 novembre, il nommait le général Bergeret, de retour de Dakar, haut-commissaire adjoint. Quant aux départements, ils furent répartis, avec le titre de secrétariats, de la manière suivante :
« Affaires politiques et intérieures : Rigault, chargé du maintien de l'ordre, de l'information et de la censure, avec comme adjoint aux Renseignements et à la Sécurité militaires : Henri d'Astier de la Vigerie, véritable maître de l'ordre public.
Relations extérieures : Tarbé de Saint-Hardouin, chargé de la reconstitution d'un ministère des affaires étrangères et des négociations avec les puissances étrangères. Il prit comme adjoint provisoire M. de Mirasse, ministre plénipotentiaire.
Production et Distribution : Blonde.
Finances : Pose(3)
Commerce extérieur : commandant Bataille.
Section militaire : colonel de Saint-Didier, chargé de la liaison entre le haut-commissariat et le haut commandement.
Il y eut aussi un délégué du haut-commissariat pour les Affaires économiques et financières.
Pour assurer la liaison entre les compartiments de l'Afrique du Nord et l'Afrique Occidentale Française, ainsi que les colonies ralliées, il était créé un organisme politique dénommé Conseil Impérial, (ordonnance du 7 décembre, publiée seulement après la disparition de Darlan). Ce conseil devait se réunir périodiquement (on admettait que ce serait une fois par mois) et comprenait Qarlan, Bergeret, Noguès, Boisson et Giraud (Estéua n'était plus libre à Tunis). »
____________________
(3)
Pose, professeur de droit et économiste, était
directeur de la Banque nationale pour le Commerce et l'Industrie
(B.N.C.I.) et, en cette qualité circulait entre la zone
occupée, l'Algérie et le Maroc. Il était à
Casablanca le 8 novembre.

Le général Alphonse Juin.
Restait à résoudre la déplorable affaire des « officiers compromis ». Ainsi, des patriotes tels Mast, Monsabert, Jousse, Baril, et Béthouart, le plus menacé, ceux-là mêmes qui avaient préparé le débarquement et engagé le retour de l'armée sur le chemin de l'honneur se trouvaient aux arrêts de rigueur pour « abandon de poste ». Ces mesures d'ostracisme, dont les militaires sont hélas coutumiers, dissimulaient, sous couvert du sacro-saint règlement, des sentiments mesquins qui n'honoraient guère Darlan et tous ceux qui, avec lui, tiraient bénéfice de la situation sans s'être exposés. Le haut commandement allié se gardait d'intervenir et Giraud se dérobait. Il ne fallut pas moins d'une intervention personnelle du président Roosevelt, le 17 novembre, pour que l'amiral Darlan se résolve à la « décision d'amnistie ». Ce document insuffisant, daté du 18 novembre et notifié « secret », était enfin complété par la « décision d'absoute » du 10 décembre.
Par ailleurs, experts et juristes s'étaient mis activement à l'ouvrage. Leur travaux devaient aboutir à un texte d'accord en vingt articles qui fut signé le 22 novembre par Darlan et Clark. Ce document, matérialisant les « Accords Darlan-Clark », marquait la prééminence des Etats-Unis, les Britanniques n'étant jamais nommés en tant que tels mais seulement évoqués de manière métaphorique en tant qu'« alliés » ou « forces affiliées ». Il se bornait à définir les modalités d'une convention militaire dont seul le préambule, cité ci-après, précisait la double intention politique qui était de justifier le débarquement allié par la menace allemande, pour combattre ensuite communément les forces de l'Axe jusqu'à la victoire :
« Les forces des Etats-Unis et de leurs alliés ont débarqué en Afrique Française du Nord dans le but d'empêcher la domination de ce territoire par les forces allemandes ou italiennes et leurs alliés, afin de poursuivre la guerre par la défaite des Puissances de l'Axe.
En vertu d'un commun accord entre les personnalités officielles dirigeantes en Afrique Française du Nord, l'amiral de la Flotte François Darlan a été reconnu haut-commissaire pour l'Afrique Française.
Il a été convenu par tous les éléments français intéressés et par les autorités militaires américaines, que les forces françaises aideront et appuieront les forces des Etats-Unis et de leurs alliés pour chasser l'ennemi commun du sol de l'Afrique, libérer la France et réaliser la restauration intégrale de l'Empire français. Afin d'atteindre ce grand but et pour conclure les arrangements nécessités par la présence en Afrique du Nord de forces considérables des armées américaines et de leurs alliés, l'accord ci-après a été conclu à Alger ce 22 novembre 1942. »
Les vingt articles de l'accord fixaient les dispositions de nature à permettre la coopération des forces alliées et françaises, ces dernières étant placées sous l'autorité exclusive du commandement français. Le personnel gouvernemental français demeurait en place. Les Américains étaient autorisés à utiliser selon leur convenance les ports et aérodromes. De même pouvaient-ils user du réseau des télécommunications. Plusieurs articles traitaient des questions juridiques, financières et économiques, notamment les réquisitions et l'aide alimentaire américaine aux populations civiles. La censure était placée sous le régime de la mixité. L'important article 11 stipulait l'amnistie de toutes personnes « ayant fait l'objet de restrictions, détentions ou condamnations en raison de leurs rapports avec les Nations Unies ». Contrairement aux violentes diatribes des gaullistes et du « groupe des cinq », les « Accords Darlan-Clark » ne dénonçaient en rien les « Accords Murphy-Giraud(4)» du 2 novembre. Ils constituaient en fait un arrangement militaire temporaire déterminé par la situation du moment et destiné à tracer les bases de la coopération franco-alliée.
La figure de l'amiral Darlan n'en continuait pas moins, dans les esprits, à refléter l'image d'une longue et étroite collaboration avec l'Allemagne depuis l'armistice. De telle sorte que sa reconnaissance par Eisenhower et Clark en tant qu'interlocuteur privilégié d'abord, de haut-commissaire ensuite, tenait du paradoxe, voire de la provocation. Toutefois, les faits l'ont confirmé, l'amiral était bien le seul, dans cette situation complexe, à pouvoir contrôler rapidement et efficacement l'ensemble des forces militaires en Afrique française.
Il était, bon gré mal gré, le premier maillon d'une chaîne à laquelle devaient s'arrimer les Américains pour prendre pied avant de progresser. Malgré l'aversion de Roosevelt, l'hostilité de Churchill, la colère des « cinq » et l'exécration des gaullistes, sur un plan pragmatique, le passage par Darlan représentait un moindre mal, une sorte d'« abcès de fixation ». Il n'empêche qu'à Londres aussi bien qu'à Washington, la presse se déchaîna. On y traitait l'amiral de « stinking skung(5) » et on y lisait des mentions telles que « Pas de compromis avec Vichy », ou encore « Le premier Quisling employé par les Etats-Unis », etc. Churchill lui-même adressa une note sévère à la Maison Blanche. Si bien que, sous la pression de l'opinion, le président Roosevelt se résolut, le 17 novembre, à prononcer sa fameuse déclaration dite de l'« expédient provisoire » qui, tout en clarifiant le jeu politique américain, portait un coup très dur à l'autorité de Darlan. En voici l'extrait le plus significatif :
« J'ai accepté les arrangements politiques que le général Eisenhower a faits pour le moment en Afrique du Nord et en Afrique Occidentale. Je comprends parfaitement et j'approuve les sentiments qui ont cours aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, où l'on considère que, compte tenu des événements qui se sont déroulés pendant ces deux dernières années, aucun arrangement permanent ne peut être conclu avec l'amiral Darlan.
_________________
(4)
Sans doute les « Accords Darlan-Clark » ne
précisent-ils pas que « le gouvernement des
Etats-Unis considère la Nation française comme une
alliée et la traitera comme telle ». De même,
ne mentionnent-ils pas « l'extension de la loi Prêt-Bail
à l'Afrique française ». Ces deux articles
essentiels figuraient effectivement dans les « Accords
Giraud-Murphy ». L'intervention de Lemaigre-Dubreuil et de
Giraud auprès de Roosevelt à An(a, le 24 janvier 1943,
aboutira à la reconnaissance expresse des « Accords
Giraud-Murphy » par le président des Etats-Unis.
(5) Putois puant.
La population des Nations Unies ne voudrait pas davantage reconnaître l'autorité du gouvernement de Vichy en France ou dans tout autre territoire français. Nous sommes opposés aux Français qui ont cédé à Hitler et à l'Axe. Personne dans notre armée n'a autorité pour discuter du futur gouvernement de l'Empire français. Le futur gouvernement de la France sera choisi non par un seul individu, sur le territoire métropolitain ou dans les colonies, mais par le peuple français lui-même, lorsqu'il aura été libéré par la victoire des Nations Unies. L'accord temporaire actuel ne peut être qu'un expédient provisoire que seuls justifient les nécessités stratégiques... »

Alger,
22 décembre 1942 : Dernière sortie officielle de
Darlan ; l'amiral
reçoit les notables musulmans au
« Colisée » pour l'Aïd-el-Kebir.
Par la suite, le sobriquet d'« expédient provisoire » fut ironiquement appliqué à Darlan lui-même. Ironie qui confine au cynisme, sachant que l'amiral devait être assassiné un mois plus tard. Néanmoins, le travail de mise en ordre et de mise en marche accompli durant cette courte période est considérable.
Un climat de fièvre
L'amiral Darlan était installé depuis un mois au palais d'Eté où il exerçait ses fonctions de haut-commissaire de France résidant en Afrique Française, entouré de son « gouvernement ». S'il avait habilement distribué les rôles aux membres du « groupe des cinq », ces derniers ne lui conservaient pas moins rancune d'avoir évincé leur champion, le général Giraud, sous la main duquel ils avaient espéré disposer d'un pouvoir discrétionnaire propice à une politique selon leur goût.
Par l'Espagne refluait en Afrique du Nord une cohorte de réfugiés, pour la plupart bons français et dévoués à la cause alliée. Il s'y trouvait des pétainistes déçus, dont on ne pouvait suspecter la sincérité, et des officiers de l'armée d'armistice, animés du meilleur esprit, qui venaient à point nommé renforcer l'encadrement d'une Armée d'Afrique en plein redressement. En même temps, hélas, un ramassis hétéroclite d'individus troubles, de faux justiciers et de conspirateurs de rencontre réussissait à passer par mailles. Il était accompagné de tout un demi-monde de femmes d'intrigues et d'aventurières. L'ensemble formait une faune interlope qui vivait à l'hôtel, au café et hantait les cercles d'officiers en quête de bonnes fortunes.
Un climat de fièvre, propice à l'incubation des complots, flottait à Alger en cette fin d'automne. Les murs se couvraient de graffitis, d'appels à la révolte et de slogans meurtriers : « Darlan traître », « Darlan à la flotte », « Darlan au poteau » et aussi « Vive de Gaulle », « de Gaulle à Alger », « Un seul but, de Gaulle » avec partout le « V » de la victoire. Darlan était invariablement la cible d'une propagande ardente à travers la presse. En évoquant son nom, « La Voix Marocaine » empruntait à Paul Claudel ce terrible apophtegme « Il n'y a pas de plus grande charité que de tuer les êtres malfaisants » auquel « Combat », la feuille de René Capitant et Louis Joxe, renvoyait en écho « Il faut à la France un gouvernement... A défaut de Darlan dont les jours sont comptés, à défaut de Giraud qui se récuse, sera-ce Peyrouton, ou bien le comte de Paris retrouvant le trône de ses pères ?... Il s'agit de retrouver Clemenceau, par bonheur il existe, il s'appelle de Gaulle ». Même dans l'armée, où le Général Giraud, surnommé « Moustache », demeurait fortement contesté, soufflait un vent de sédition amplifié par l'ostracisme des officiers « réguliers » à l'encontre des « putschistes » du 8 novembre. Quant au gros de la troupe des conjurés d'Alger, les jeunes des Chantiers de Jeunesse reconvertis en Corps Francs. Ils étaient littéralement chauffés à blanc et brûlaient d'impatience de « liquider le traître ». La foule, enfin, déconcertée par les événements, égarée par la censure et portée, en bonne logique, à voir en Darlan le prolongement de Vichy, offrait un terrain favorable aux menées de la propagande. De sorte que ces provocations à répétition conduisaient à admettre, sinon à revendiquer, une solution limpide : l'assassinat.
Darlan assassiné
Les faits — Tout ira très vite, trop vite. Le 24 décembre, à 3 heures de l'après-midi, l'amiral Darlan est assassiné dans son bureau de trois balles de pistolet ; mortellement blessé, il sera conduit à l'hôpital Maillot où il succombera dans l'heure sur la table d'opération. Son meurtrier, un tout jeune homme nanti du sauf-conduit réglementaire, s'est présenté devant les grilles du Palais d'Eté qu'il a franchies sans difficulté. Introduit dans les couloirs, il a attendu sans être inquiété l'arrivée de sa victime pour l'abattre. Maîtrisé après une brève échauffourée au cours de laquelle il blesse un officier, il est conduit dans les locaux de la police. Malgré de faux papiers, d'apparence authentique, établis au nom de Morand, l'interrogatoire révèle sans difficulté sa véritable identité. Il s'appelle Fernand Bonnier de la Chapelle(6), il a vingt ans et fait partie des Corps Francs. Son père est un journaliste algérois. Questionné sur son geste, le jeune Bonnier déclare « Je considère le crime que j'ai commis comme l'expression de mes sentiments d'honnêteté. J'estimais que l'amiral, qui collaborait depuis deux ans avec l'Allemagne, n'était pas qualifié pour occuper le poste qu'il s'était attribué... Lorsque j'ai compris qu'il s'installait pour durer, j'ai décidé de le détruire. » Affirmant avoir agi seul par sentiment patriotique, ses brefs aveux, qui constituent le corps de l'accusation, suffiront à le faire condamner à mort par une cour martiale hâtivement constituée. Ce tribunal, composé de Giraud, rentré précipitamment de Tunisie en compagnie d'Eisenhower, et des principaux membres du Conseil Impérial, se réunira le 25 décembre à 18 heures. Après un bref réquisitoire, la sentence sera prononcée devant l'accusé qui l'entend sans sourciller. Le recours en grâce, dont la décision incombe à Noguès, est rejeté par celui-ci aux environs de minuit. A l'aube du 26, Fernand Bonnier de la Chapelle est conduit au polygone de tir d'Hussein-Dey et tombe sous les balles du peloton d'exécution à 7 h 30.
_______________
(6)
De la Chapelle est un emprunt de Fernand Bonnier au nom de sa mère,
d'origine italienne, qui se nommait délia Capella.
Deux heures après la conclusion entre chien et loup de cette procédure par trop expéditive, l'amiral Darlan reçoit en grande pompe l'hommage des armées alliées et l'absoute donnée en sa cathédrale par l'archevêque d'Alger, Monseigneur Leynaud. Puis, son cercueil est déposé dans une casemate de l'Amirauté. Ce même 26 décembre au soir, à l'unanimité du Conseil Impérial, le général Giraud est élu haut-commissaire. — Les suites — Vite fait, mal fait ! Contrairement aux apparences, loin d'être close, l'affaire ne fait que commencer. L'ampleur des mesures de sécurité prises par les Alliés sur l'ensemble du territoire le lendemain du meurtre, notamment la consigne générale au quartier des hommes et des gradés, semble disproportionnée à l'événement et ne laisse pas d'inquiéter.

Fernand Bonnier de la Chapelle.
Le 28 décembre, nouveau coup de tonnerre : Giraud et Murphy auraient échappé à un attentat. Une conjuration était sur le point d'éclater à Alger, qui a été déjouée, l'un de ses membres s'étant démasqué. C'est le général Bergeret, haut-commissaire adjoint, qui a pris l'affaire en mains et prévenu le coup d'Etat alors que les conjurés allaient investir le Palais d'Eté. Cette version des faits est parfois contestée. Une certitude par contre, « l'Intelligence Service » qui a été imprudemment incriminé dans l'attentat contre Darlan menace de tout « déballer » : Bonnier n'était pas seul, ses acolytes n'ont pas renoncé. Roosevelt insiste et, sous la pression des Alliés, Bergeret, qui se sent visé, relance l'enquête.

Le lieutenant abbé Pierre-Marie Cordier
On apprend que, dans la nuit du 24 décembre, Bonnier a reçu la visite de l'inspecteur Garidacci et, sur la promesse d'avoir la vie sauve, a fait une nouvelle déclaration, dans le secret de sa cellule, dont le procès-verbal a été dissimulé au tribunal. Acte abominable, la production d'une telle pièce aurait sans doute permis à l'accusé de sauver sa tête. Voici ce procès-verbal :
« Police mobile, Procès-verbal.
L'an 1942 et le 24 du mois de décembre :
Devant nous Garidacci, commissaire de la police mobile, officier de la police judiciaire, auxiliaire de M. le procureur de la République,
M. Bonnier de la Chapelle, Fernand, étudiant, 20 ans, Alger, rue Michelet, 56.
J'affirme avoir tué l'amiral Darlan, haut-commissaire en Afrique française, après en avoir référé à M. l'Abbé Cordier sous forme de confession.
C'est M. Cordier qui m'a remis le plan des bureaux du commissariat et du cabinet de l'amiral ; et c'est par lui que j'ai pu me procurer le pistolet et les cartouches qui m'ont servi à exécuter la mission que je m'étais assignée et qui était de faire disparaître l'amiral.
Lorsque je me suis engagé dans les Corps Francs, j'ai recruté de ma propre initiative, parmi les gradés et hommes de troupe, des hommes de main dont M. d'Astier aurait pu avoir besoin, mais M. d'Astier n'a jamais été au courant de mon action personnelle.
Je sais que MM. Cordier et d'Astier ont rencontré récemment le comte de Paris, au même titre qu'ils rencontrèrent des personnalités ; enfin j'ai l'impression que M. d'Astier de la Vigerie ne vit pas en d'excellents termes avec M. Rigault, dont l'action auprès de l'amiral est gênante pour ses amis.
Lu, persiste et signe ; signons :
Bonnier de la Chapelle. »
C'est un document capital. Il désigne quatre noms et suffit à révéler l'existence d'un complot royaliste. La première personnalité mise en cause est l'abbé Pierre-Marie Cordier. On le sait très actif au sein des Corps Francs, issus des Chantiers de Jeunesse, où son influence morale et psychologique est considérable. C'est donc lui qui a armé le bras du meurtrier après l'avoir entendu en confession. Le nom d'Henri d'Astier de la Vigerie est ensuite évoqué, mais pour le couvrir. Cependant, nul n'ignore que Cordier est son secrétaire particulier et loge à son domicile algérois, 2, rue Lafayette. Affecté naguère avec le grade de lieutenant au 2e Bureau d'Oran, l'abbé a servi sous les ordres du capitaine d'Astier dans le cadre de ses attributions militaires et, aux côtés du « groupe des cinq », a participé à des actions de résistance. Depuis, Henri d'Astier a gravi les échelons pour accéder au premier plan, puisqu'il occupe la fonction de secrétaire à la Police, aux Renseignements et à la Sécurité militaire dans le Haut-Commissariat. L'on imagine mal l'abbé conspirant à l'insu de son chef, ce que vient confirmer Bonnier lorsqu'il ajoute que d'Astier et Cordier ont récemment rencontré le comte de Paris. Or, ce dernier est effectivement à Alger où, depuis l'assassinat de Darlan, il fait le siège des plus hautes instances sur la recommandation d'Henri d'Astier. Accouru du Maroc, il est venu se placer au service de la France, en cette période de grand trouble, et propose son arbitrage dans les conflits. Tout juste âgé de trente-quatre ans et prétendant à la couronne, dans la branche Orléans, Henri, comte de Paris, ne brigue rien moins que la présidence du Comité Impérial. Enfin, le quatrième personnage nommé par le meurtrier dans sa déposition est Rigault, un ancien du « groupe des cinq » lui aussi. Secrétaire aux Affaires politiques et à l'Intérieur, il est considéré comme le bras droit de Darlan. En rappelant l'antagonisme qui oppose d'Astier à Rigault « dont l'action auprès de l'amiral est gênante » Bonnier le disculpe en quelque sorte. — Une parodie de justice — L'existence du complot royaliste conclu par l'assassinat de l'amiral Darlan et l'agitation politique qui s'en est suivie sont largement commentées par la presse et la radio pour complaire à une opinion trop longtemps sevrée d'information. Sur ce point, l'analogie du commentaire entre Radio-Paris et la B.B.C. est d'une tragique cocasserie : « Le traître a payé ».
Sans autre forme de procès, le comte de Paris sera simplement l'objet d'une mesure d'extradition prononcée le 27 décembre mais dont l'application n'interviendra que le 10 janvier, Henri d'Orléans étant immobilisé par un accès de paludisme doublé d'une crise de furonculose.
Le général François d'Astier de la Vigerie, frère d'Henri, fraîchement rallié à de Gaulle et présent à Alger dans la semaine de l'attentat contre l'amiral, envers lequel il s'est publiquement répandu en invectives, est poliment renvoyé à Londres.
Quatorze personnes, appartenant aux milieux gaulliste et monarchiste, à la bourgeoisie israélite algéroise ainsi qu'à la police, sont arrêtées dans la nuit du 28 au 29 décembre et internées au camp de Laghouat. On y rencontre pêle-mêle Achiary, Esquerré, Muscatelli, Aboulker père et fils, Alexandre, Moatti, etc. La plupart d'entre eux seront remis en liberté quinze jours plus tard. Dans une seconde charrette se trouvent réunis le banquier Alfred Pose et son fondé de pouvoir Marc Jacquet, Henri d'Astier, l'abbé Cordier et l'inspecteur Garidacci. Ces derniers se voient inculpés de complicité dans l'assassinat de l'amiral Darlan et sont à leur tour incarcérés le 10 janvier 1943.
Malgré l'insistance de Roosevelt, l'enquête piétine en raison du manque de conviction affiché par Giraud que l'on dit soumis à l'influence du général de Gaulle. De fait, au retour de la conférence d'Anfa, apparemment circonvenu par l'homme de Londres, il ordonne le 6 février au chef du parquet militaire de prononcer un non-lieu général. Trois mois plus tard, de Gaulle faisant son entrée à Alger, d'Astier, Cordier et Garidacci sont libérés. Dès le lendemain de cette journée prodigue en libéralités, Henri d'Astier sera décoré de la croix de guerre par le général Giraud, celui-là même qui l'avait fait emprisonner. Pour ne pas être en reste, de Gaulle y ajoutera le surlendemain la médaille de la résistance, puis il le nommera membre de l'Assemblée consultative du Comité Français de Libération Nationale. Mais Henri d'Astier préférera prendre un grade de commandant dans les Commandos de France où il aura un comportement en tout point honorable. Cordier sera également décoré de la croix de guerre et, la paix revenue, reprendra son sacerdoce. Quant à Garidacci, pour salaire de sa forfaiture, il sera simplement mis à la retraite.

Henri,
comte de Paris, deuxième
classe dans la Légion en
1940
On ne saurait clore ce pénible chapitre sans rappeler que le 21 décembre 1945, la chambre de révision de la cour d'appel d'Alger, jugeant à la demande de réhabilitation formulée en faveur de Fernand Bonnier de la Chapelle par sa famille, rendait un arrêt de cassation de la condamnation à mort pour les motifs suivants :
« Attendu que, d'après différentes lettres se trouvant au dossier..., enfin la dernière lettre de F. Bonnier de la Chapelle écrite quelques instants avant son exécution..., et enfin d'après les documents qu'on a découverts depuis la libération de la France, il apparaît certain que l'amiral Darlan agissait contre les intérêts de la France, et que, par suite, l'acte ayant entraîné la condamnation de F. Bonnier de la Chapelle a bien été accompli dans l'intérêt de la libération de la France.
Pour ces motifs...
Annule le jugement du tribunal permanent d'Alger, siégeant en cour martiale le 25 décembre 1942, qui a prononcé la peine de mort contre F. Bonnier de la Chapelle... »
La réhabilitation du malheureux faisait disparaître le crime et annulait du même coup toutes les complicités. — L'amiral face à son destin — Dans les jours qui précédèrent l'attentat, Darlan, qui ne méconnaissait en rien les menaces dont il était l'objet, refusait toute protection, feignait l'indifférence et négligeait les règles de prudence les plus élémentaires. Confiant en son étoile, ou fataliste ? L'amiral donnait à son entourage l'image d'un homme surmené, accablé par ses charges et les soucis que lui donnait la terrible maladie d'Alain, son fils.
Le 23 décembre, veille de l'assassinat, il avait convié à déjeuner les plus hautes personnalités civiles et militaires alliées. L'humeur n'était plus aux affaires mais à la détente lorsque Clark, évoquant le mal d'Alain Darlan et la possibilité de son transfert à l'hôpital spécialisé de Warm Springs aux Etats-Unis, dans le but d'entraîner l'amiral par ce biais loin de la scène politique, s'entendait répondre à la cantonade par celui-ci « J'aimerais passer la main au général Giraud... » mais en aparté « Vous savez qu'il se trame actuellement quatre complots visant à m'assassiner ?... Supposez que l'un d'eux réussisse, que ferez-vous alors ? » A l'issue du déjeuner, attirant Clark visiblement inquiet à son bureau, il lui montra la liste de ses éventuels successeurs : Flandin, Herriot, Reynaud... Giraud n'y était pas mentionné, de Gaulle, par contre, y figurait, et Darlan d'ajouter « Pour lui, ce serait prématuré, il vous attirerait des ennuis... au printemps 1943, peut-être »(7). Ensuite, il examina avec son hôte de nombreux documents ; ce fut là son ultime négociation secrète.
_____________
(7)
Général Clark dans ses souvenirs
Duquel des quatre côtés envisagés par Darlan sont parties les balles qui vinrent l'abattre ? Services spéciaux allemands, ultra-collaborationnistes de Vichy, Intelligence Service ? Quel est le quatrième ?
— Place à l'histoire — La justice est une chose, l'histoire en est une autre. Trop de zones d'ombre subsistaient dans cette affaire dont le caractère tragique hante encore les mémoires. Il appartenait donc aux historiens de poursuivre l'enquête. Après cinquante années de traque, malgré les pesanteurs de la politique et la prolongation de quarante ans du délai de prescription des Archives nationales, la nuit se dissipe peu à peu et l'aurore qui point nous dévoile enfin la vérité.
L'armistice, qui en juin 1940 met fin au « Blitzkrieg » et préserve l'Empire, débouche en Afrique du Nord sur une stratégie offensive des Alliés et une stratégie d'accueil des Français dans une perspective de reprise des combats. Si le plan, d'une logique indiscutable, est correctement mené à bien dans sa réalisation matérielle, reste à accorder les hommes aux événements, ce qui est affaire de politique. Pour la France, de l'armistice au 8 novembre 1942, deux pôles se sont opposés, Londres et Vichy. A partir du débarquement, la rupture de l'outremer avec la métropole, engagée à Londres par de Gaulle le 18 juin 1940, est non seulement consommée le 13 novembre 1942 par les « accords Darlan-Clark », mais, qui plus est, à Alger, en terre française. Tandis que Vichy sombre avec Laval dans les abîmes de la collaboration, la France en guerre se voit dès lors partagée en deux camps : Londres, toujours, où le général de Gaulle, porté par les Anglais, se pare de la légitimité insurrectionnelle, et Alger où Darlan, avec les Américains, se réfère à la légitimité constitutionnelle. Fortuite ou voulue, la présence de Darlan à Alger ébranle à la fois l'option gaulliste et déjoue le plan Giraud monté par le « groupe des cinq ».
Il est des coïncidences troublantes. Ainsi, le 15 novembre 1942, l'amiral Darlan, dans une proclamation radiophonique, informe les civils et l'armée de sa prise de pouvoir. Le lendemain 16, Marc Jacquet, qui est dans la mouvance du « groupe des cinq », écrit à Henri d'Astier de la Vigerie. Cette correspondance, saisie chez son destinataire au cours de la perquisition qui suivit les aveux extorqués à Bonnier de la Chapelle par Garidacci, permettra d'inculper, outre Marc Jacquet son auteur, Alfred Pose, Henri d'Astier, ainsi que l'abbé Cordier, comme instigateurs d'un coup d'Etat royaliste, suivi après son échec de l'élimination de l'amiral Darlan. La lettre révèle, en effet, qu'à la faveur des préparatifs du débarquement allié, le « groupe des cinq » conspirait à la restauration du comte de Paris. Ainsi, les jeunes patriotes d'Alger étaient-ils, à leur insu, les instruments d'un putsch monarchiste. Darlan, par sa présence inopinée, ayant fait échouer l'entreprise, il devait être éliminé. Une seconde opération étant donc nécessaire, le comte de Paris intervenait après coup pour proposer son arbitrage et dénouer la crise.
Voici le texte de la lettre adressée par Jacquet à d'Astier(10):
Alger, le 16 novembre 1942.
Cher Monsieur,
Des événements de la semaine passée et de notre échec il nous faut maintenant tirer les enseignements.
Deux conclusions indiscutables : la carence une nouvelle fois affirmée, et clairement, des militaires sur le plan politique, l'absence presque totale d'énergies efficientes. De cette aventure, deux noms seuls doivent être retenus dans l'espoir d'une action future efficace : le vôtre et celui du préfet Temple.
Trois constatations :
— Votre coup d'État s'est fait, en somme, un peu contre des moulins — presque coup d'Etat pour un autre Etat — nous n'avions devant nous aucun Etat, mais simplement des échelons administratifs d'un Etat absent. Notre coup d'Etat aura eu cependant comme premier résultat la constitution d'un échelon d'Etat (Darlan) ayant une action politique autonome s'appliquant aux différents échelons administratifs précités. — Le fait gaulliste subsiste en son entier puisque nous nous trouvons du côté de la dissidence, devant deux échelons d'Etats distincts : Gaulle et Darlan, et que cette situation ne saurait se prolonger.
— L'accentuation, dans les premiers jours de l'occupation, de l'influence anglo-saxonne sur le plan intérieur français.
De tout ceci découlent plusieurs vérités d'évidence dont la négation conduirait aux pires erreurs :
— la nécessité d'un pouvoir civil s'imposant aux militaires est absolue ;
— la conciliation du point de vue gaulliste et nord-africain est urgente : tout au long de cette crise douloureuse, une notion juridique, celle d'arbitrage, s'est imposée de bout en bout. Je persiste à croire qu'aujourd'hui encore c'est autour de cette notion que doit être cherchée la solution de vérité ;
— Tout putsch nouveau, soit de rue comme celui de dimanche, soit par révolution de Palais, ne saurait être fait qu'avec le consentement des Anglo-Saxons et leur concours matériel.
Ceci admis, quelques réflexions et précisions s'imposent. D'abord quand au but : il faut affirmer et dire — c'esf en ce sens d'ailleurs que le général Giraud semble parfaitement comprendre actuellement ce que signifie précisément la mobilisation en cours — que l'action actuelle en Afrique du Nord, comme l'action gaulliste dans les territoires « dissidents » ne vise qu'un seul but, la libération de la métropole. Il faut affirmer bien haut ce principe à la face des Américains, des Anglais et des Nord-Africains. C'est cette considération qui doit nous faire étudier attentivement — nous qui n'étions pas gaullistes — la signification et la portée exacte du mouvement gaulliste. Il faut que nous nous disions que la métropole vit aujourd'hui et depuis deux ans de l'espérance gaulliste ; qu'en zone occupée, les organisations gaullistes représentent incontestablement la seule force véritable existante et capable d'agir, que la propagande gaulliste a sur l'opinion française de zone occupée, une influence capitale, à laquelle il serait bien difficile de se substituer immédiatement. Restons donc dans le concret, et en vertu de cette notion d'arbitrage, proposons la conciliation par l'instauration d'un pouvoir civil neuf (s'affirmant comme un gouvernement unique de la France impériale dissident des deux pouvoirs militaires actuellement existants : Gaulle et Darlan). Vous connaissez bien mes sentiments. Ma position est d'ailleurs purement rationnelle, je ne suis pas un monarchiste de tradition, mais je pense aujourd'hui qu'il faut mettre le prince devant ses responsabilités et lui imposer de prendre dès maintenant position, je dis dès maintenant car je ne pense pas que par opportunisme il faille se dérober aux conséquences plus ou moins imprévisibles pour la restauration de la monarchie, de l'imbroglio actuel.
______________________________
(10)
Cité par Pierre Ordioni dans son livre « Le secret
de Darlan », paru aux Editions Albatros, Paris, 1986.
Pierre Ordioni était chef de cabinet du préfet d'Alger
à l'époque où se situent ces événements.
(11)
Emmanuel Temple, ancien député de PAveyron et préfet
d'Alger sous Vichy, était l'ami personnel de Pierre Laval qui
en avait fait son représentant politique. Sa participation au
complot demeure obscure alors que son « efficacité »
est reconnue par Jacquet. S'agissait-il d'une ramification encore
inconnue de la conspiration contre Darlan ?

Le général Goislard de Monsabert
Je pense qu'il faut, en face des Américains, constituer dès maintenant un gouvernement capable d'être celui de demain qui négociera la paix à côté des Anglo-Saxons. (Le Prince, de toute façon, ne saurait vous opposer le principe de légalité puisque dans tous les cas la restauration de la monarchie sera un acte illégal !)
Il faut qu'au départ de cette croisade, qui doit redonner la France aux Français, le Prince, s'il veut être monarque, se présente comme le conciliateur des différentes dissidences françaises et comme le libérateur à la tête des armées françaises qui reprendront le territoire aux côtés des forces anglo-saxonnes.
Il vous faut donc, cher Monsieur, décider le Prince à cette action, mais comme il ne faut point l'y lancer à la légère, il vous faut obtenir l'agrément de Gaulle, qui reste tout de même reconnu des Anglais et des Américains, à la solution projetée. Il vous faut également éliminer le facteur Darlan — nous savez ce que j'entends par là — mais avec la plus grande prudence et en choisissant exactement l'heure (ne mettre aucun cadavre entre vous et le Prince).
Il vous faut encore obtenir l'adhésion des Anglo-Saxons et leur faire imposer le Prince.
Les jours que nous vivons, et qui passent, affirment une unité française en Afrique du Nord. Le pouvoir civil, comme je l'entendais plus haut, est créé. La solution projetée me parait au fond plus facile qu'elle n'était il y a huit jours, mais il faut le vouloir, et vous-même sans doute le pouvez. »
Tel se présentait le plan proposé par Jacquet qui, dans sa conclusion, demandait à d'Astier d'obtenir l'assentiment gaulliste et le soutien allié afin de permettre au « Prince » de « rassembler les dissidences » ; l'objectif étant de réunir Londres et Alger en un « pouvoir civil neuf ». Cet « échelon d'Etat », à valeur de gouvernement provisoire, devait ensuite être capable de négocier la paix aux côtés des Alliés, le moment venu. Or il existait déjà, c'était le Conseil Impérial créé par Darlan. Il convenait alors d'installer à sa présidence le Comte de Paris, flanqué du général de Gaulle, investi du pouvoir civil et politique, et du général Giraud, détenteur du commandement militaire. Pour arriver, à ses fins, Jacquet s'exprimait on ne peut plus clairement « Il vous faut également éliminier le facteur Darlan, vous savez ce que j'entends par là.»
Troisième temps fort de cette chronologie serrée : le 21 novembre 1942, le général d'aviation François d'Astier de la Vigerie(12), frère d'Henri, embarque en France à bord d'un « Lysander » (avion très maniable spécialisé dans les missions clandestines) et se pose à Londres. Ralliement quelque peu tardif, quoiqu'apprécié par de Gaulle qui fait en quelques jours du nouveau partenaire son adjoint. Ainsi, François d'Astier se voit bientôt chargé, par le chef de la France libre, d'une importante mission à Alger. Après une escale de quelques jours à Gibraltar, au cours de laquelle il prend des contacts, il poursuit sa route dans un avion britannique et atterrit à Maison-Blanche le 19 décembre. De là, il se rend directement chez son frère Henri qui, depuis quelques jours, héberge le comte de Paris (Celui-ci a été pris en charge à Oujda et ramené du Maroc, sous la protection de l'abbé Cordier, dans une auto fournie par le colonel Van Hecke). François d'Astier, le soir même de son arrivée, est introduit auprès du « Prince » avec lequel il s'entretient longuement seul à seul. Dans le salon voisin se tiennent Henri d'Astier et son épouse, Cordier, Pose et Jacquet. Le surlendemain 21 décembre, le comte de Paris réunit Henri d'Astier et Cordier auxquels il « donne l'ordre d'éliminer Darlan par tous les moyens »(13). Sur ces paroles et se tournant vers Cordier, d'Astier lui dit « Eh bien l'abbé, à vous de jouer ! » On connaît la suite : Cordier recrute Bonnier de la Chapelle et n'a aucune peine à convaincre ce membre des Chantiers de Jeunesse qu'il a lui-même endoctrinés.

Le
général d'aviation
François d'Astier de la
Vigerie.
Il lui procure l'arme, lui fournit les facilités nécessaires et, après lui avoir administré l'ultime viatique de la confession, l'abandonne à sa terrible mission. Darlan tombe le 24 décembre à 15 heures, la messe est dite. — Qui a décidé du meurtre ? — Si, depuis la suspension de l'enquête juridique et le non-lieu prononcés le 6 février 1943 pour raison politique, les historiens ont réussi à percer les principaux mystères entourant l'affaire Darlan, l'ambiguïté demeure sur le véritable instigateur du meurtre. La thèse du simple complot monarchiste ne tient plus. Il s'agit en effet d'une conspiration bicéphale, née d'un intérêt partagé et aboutissant à une solution commune. A la manière d'un cours d'eau issu de la confluence de deux bras d'importance semblable et dont la source serait indéterminée, une incertitude demeure sur la prépondérance de l'une ou l'autre des implications gaulliste et royaliste dans la décision de tuer.
_____________________________
(12)
Emmanuel, le troisième des frères d'Astier de la
Vigerie, a également rejoint le général de
Gaulle. Connu pour ses idées progressistes, il s'attachera à
rapprocher les communistes de la « mystique »
gaulliste dans le but d'unifier la résistance. Il se verra
confier le portefeuille de l'Intérieur au Comité
Français de la Libération Nationale, le 30 mai 1943 à
Alger.
(13) D'après Jean-Bernard d'Astier de la Vigerie,
fils de François d'Astier, qui vient de publier « Qui
a tué Darlan ? » aux Editions de
l'Atlanthrope, Versailles. Cet ouvrage constitue un témoignage
capital.

Henri
d'Astier de la Vigerie en tenue
de commandant du Commando de
France.
Le lendemain du meurtre, le président des Etats-Unis, Franklin Roosevelt, laisse éclater son indignation et déclare publiquement « Le lâche assassinat de l'amiral Darlan est un crime abominable. Tous les chefs des Nations-Unies seront d'accord sur ce point ; seuls les tenants du nazisme, du fascisme et du despotisme militaire peuvent penser différemment. J'espère que prompte justice sera faite à l'assassin ou aux assassins ». Puis il prendra la décision, lourde en présomption, d'annuler la visite annoncée du général de Gaulle à Washington.
Pour sa part, Jean-Bernard d'Astier de la Vigerie, témoin privilégié s'il en est, se montre catégorique. Selon lui, son père Henri d'Astier, le comte de Paris et les autres membres du complot royaliste avaient pour seul but l'élimination politique de Darlan. C'est son oncle le général François d'Astier, affirme-t-il, qui est arrivé à Alger le 19 novembre 1942, venant de Londres, avec l'ordre de supprimer physiquement l'amiral. A preuve, outre sa présence suspecte à Alger coïncidant avec celle du « Prince » qu'il rencontre en aparté, les propos vengeurs qu'il n'a cessé de répandre durant son bref séjour, notamment auprès du président du conseil général d'Oran, Saurin, auquel il a prédit la mort prochaine de l'amiral. Enfin, l'émissaire de la France Libre n'était-il pas porteur d'une somme de 40 000 dollars, dont 38 000 ont été retrouvés chez son frère Henri d'Astier et 2 000 sur le jeune Bonnier, destinés à faciliter sa fuite ?
Deux autres thèses, solidement étayées, quoique plus nuancées, n'en méritent pas moins d'être citées :
Selon Alfred Fabre-Luce(12), il est évident que pour de Gaulle, l'élimination de Darlan est d'un intérêt primordial : elle lui permet d'aborder Alger. Mais celui-ci « ne pourrait approuver le principe de l'assassinat individuel... Il s'agit d'ailleurs d'une affaire complexe à laquelle ont été mêlés plusieurs clans, où plusieurs intrigues se sont entrecroisées... Les Américains n'en attribueront pas moins au seul gaullisme la responsabilité d'un meurtre que Roosevelt considérait comme étant de droit commun ».
________________
(14)
Alfred Fabre-Luce : « Le plus illustre des
Français », Editions René Julliard, Paris,
1960.
Selon Pierre Ordioni, de Gaulle fut bien informé du complot royaliste ; sa réponse affirmative à un télégramme de Catroux sur le sujet, intercepté par les services secrets allemands, en fait foi. De plus, Marc Jacquet, dans sa lettre du 16 novembre, n'avait-il pas demandé à Henri d'Astier de mettre Londres dans le secret, en vue d'obtenir son soutien ? N'étant pas homme à se compromettre personnellement, il est raisonnable d'admettre que le général se soit servi du clan royaliste comme « Cheval de Troie », par l'entremise des frères d'Astier, dans une entreprise qui ne pouvait que combler ses vœux. Quant à attribuer à tel ou tel la décision du meurtre politique de Darlan, il semble qu'il y ait là un pas qui ne puisse encore être franchi dans l'état actuel des recherches. — Crime ou châtiment ? — Jean-Bernard d'Astier considère le meurtre de Darlan non comme un assassinat mais comme une « exécution ». Opinion fondée sur des convictions patriotiques indiscutables se référant aux antécédents collaborationnistes de l'amiral à Vichy. Mais à Alger, un mois et demi après le débarquement allié, dans un contexte de coopération, de ralliements et de nouveaux services à rendre en vue du réarmement de nos troupes, cette « exécution » s'imposait-elle encore ?
« A l'hôpital Maillot, devant le corps de l'amiral — écrit Robert Murphy — Clark et moi tombâmes d'accord : plus qu'aucun autre Français, Darlan avait contribué au succès d'une aventure militaire et diplomatique terriblement alléatoire. Rapidement, les chefs alliés se rangèrent à cette opinion ; on était loin de l'expédient provisoire ». A l'heure actuelle, la majorité des historiens et politologues désapprouve le meurtre de Darlan, qualifié diversement d'acte précipité, d'erreur politique, de tache indélébile, etc. Pour Albert Kammerer(15), ancien ambassadeur. « On doit déplorer cette exécution. Il fallait remettre à plus tard, après la libération, l'examen du cas Darlan ».
Périls du double jeu ? L'amiral Darlan au moment de sa mort cristallisait les ressentiments, aussi bien de Vichy et de Berlin que de Londres et d'Alger. A croire que les quatre complots qu'il redoutait n'en faisaient qu'un ? — La dernière énigme — Le 29 avril 1964, l'escorteur d'escadre « Maillé-Brézé » accoste à Mers-el-Kébir. La passerelle jetée, huit marins hissent sur leurs épaules un lourd cercueil drapé aux couleurs nationales. Le commandant du navire, son état-major et l'équipage rendent les honneurs militaires à la dépouille de l'amiral Darlan dont les cendres reposaient depuis le 26 décembre 1942 à Alger, dans une casemate de l'Amirauté.
Dans le cimetière marin de Mers-el-Kébir, le cercueil, au pas lent des porteurs, passe en revue une dernière fois les tombes des 47 officiers et des 1 250 mariniers et marins tués lors des agressions anglaises de juillet 1940, avant de rejoindre sa place parmi elles.
____________________
(15)
Albert Kammerer : « Du débarquement africain au meurtre
de Darlan », Flammarion Editeur, Paris, 1949.
Sur la dalle de marbre gris est scellée une plaque où sont gravées en or sur fond noir une croix, la médaille militaire et deux ancres croisées, marque de l'amiral de la Flotte, chef d'état-major général et commandant en chef les escadres du Ponant et du Levant. Au-dessous, une inscription :
François
DARLAN
Amiral de la Flotte
Mort pour la France
Nérac
7 août 1881
Alger 24 décembre 1942
Alain Darlan, sa femme, ainsi que l'amiral Hourcade et le consul de France à Oran assistent à la cérémonie. Seul le fils de l'amiral Darlan et son épouse savent que le cercueil, vidé de son corps, a été lesté de sable. En effet, à la proclamation de l'indépendance algérienne, la Marine Nationale s'apprêtant à quitter l'Amirauté, on devait s'apercevoir que la porte de la casemate avait été forcée et le cercueil ouvert, laissant à penser que les cendres du défunt avaient été dispersées dans les flots, suivant l'antique tradition marine.

29
avril 1964 : Le cercueil de l'amiral Darlan
est transféré
de l'Amirauté d'Alger
au cimetière marin de
Mers-el-Kébir.
La situation à Tunis
L'organisation politique de la Régence de Tunis ne diffère guère de celle du Maroc. Placé sous le régime du protectorat, le pays est gouverné par le bey Moncef Pacha aux côtés duquel l'amiral Estéva, résident général, représente la puissance protectrice.
Les pouvoirs militaires sont entre les mains du général Barré, commandant supérieur des troupes de Tunisie. L'amiral Derrien, préfet maritime de
Bizerte, relève de l'amiral Darlan, en tant que commandant de la marine, et du général Barré, en tant que commandant des défenses côtières. Le général Barré, pour tout son commandement, relève du général Juin.
L'importance du dispositif de défense tunisien est très inférieure à ceux du Maroc et de l'Algérie. Les Allemands se sont préoccupés de limiter le potentiel militaire français dans le dos de Rommel. L'armée de terre dispose de l'effectif d'une division, 13 000 hommes, disséminé sur l'ensemble du territoire. L'aviation rassemble à El-Aouina un petit nombre d'appareils sous les ordres du colonel Gérardot. La marine, basée à Bizerte, comprend une division de 3 torpilleurs de 600 tonnes, 2 avisos, 12 sous-marins désarmés et une section de dragueurs.

Les
jeunes d'Algérie répondent avec
empressement à
l'ordre de la mobilisation.
L'Axe, pour sa part, en dehors des commissions d'armistice, n'entretient en Tunisie qu'une représentation militaire symbolique. Mais le commandement allemand a réuni à portée une aviation considérable, dotée de bases valablement équipées et ravitaillées dans l'Italie méridionale, la Sicile et la Tripolitaine. Cet important dispositif garantit momentanément aux Allemands la suprématie dans les airs, le contrôle efficace du détroit de Sicile pour des interventions offensives contre les convois alliés, de même que pour la protection de son propre trafic maritime, et la possibilité de transports urgents par voie aérienne. Telle est la situation à Tunis lorsque le consul des Etats-Unis, Doolittle, à l'aube du 8 novembre, s'en vient avertir l'amiral Estéva du débarquement allié et lui remettre une missive du président Roosevelt.
Indécision des Alliés, promptitude des Allemands, faiblesse des Français
Du 8 au 14 novembre, alors que les troupes alliées prennent position sur le territoire algéro-marocain, l'état-major allemand n'a pas tardé à réagir en lançant une opération aéronavale sur la Tunisie qui va aboutir à l'occupation de Tunis et Bizerte. Cette intervention aussi prompte qu'audacieuse, facilitée par la passivité du commandement français local, pouvait paraître hasardeuse en raison de la modestie des moyens engagés comparativement à la force anglo-américaine. Elle n'en répondait pas moins à une stratégie aussi réaliste qu'opportune fondée sur les insuffisances du plan allié et les distances qu'il avait mises entre ses bases et Tunis.
Force est d'admettre que, malgré ses mérites, l'opération « Torch » pêche lourdement par deux points : Absence de tout débarquement à l'est du méridien d'Alger et insuffisance des moyens débarqués. Le plan allié, s'il a privilégié la surprise, semble avoir manqué d'ampleur et d'audace. Il a laissé la Tunisie à découvert et dilué ses forces sur un terrain trop vaste. Paradoxalement, le plus gros des effectifs débarquera à Casablanca et Oran, situées respectivement à 1 800 et 1 000 kilomètres de Tunis ; Alger, pour sa part, en étant éloignée de 600. Il faudra attendre le 12 novembre pour voir les Anglo-Saxons prendre pied à Bône. Et rien sur Tunis, ni sur Bizerte, pas même un avion sur El-Aouina. Eisenhower, dans son ouvrage « Crusade in Europe » invoquera pour excuse la résistance opposée à ses troupes par les Français à Casablanca et Oran. Médiocre échappatoire quand on sait que l'état-major américain et la marine britannique s'étaient opposés, d'un commun accord, à engager des convois dans le détroit de Sicile par crainte de la « Luftwaffe ».
Tout autre sera l'attitude du grand état-major allemand. Dès l'annonce d'un débarquement anglo-américain limité à l'Algérie et au Maroc, le Maréchal Kesselring, commandant les troupes allemandes du théâtre méditerranéen, téléphone à Berlin et obtient d'Hitler en personne l'autorisation d'intervenir en Tunisie. Ainsi couvert, dès le 9 novembre au matin, il donne l'ordre au IIe Corps aérien d'occuper le terrain d'El-Aouina par un groupe de chasse, constitué de « Messerschmitt 109 », et un groupe de transport, composé de « Junkers 52 » à bord duquel a pris place une compagnie de défense des terrains. En fin de matinée, 5 avions se sont posés ; ils seront 25 à 15 heures, 60 à 16 heures et une centaine à la tombée de la nuit. L'O.K.W. a obtenu de Laval un accord de pure forme pour utiliser les aérodromes tunisiens, première étape d'une véritable occupation militaire . Malgré ses répugnances, Estéva se soumet. Le lendemain 10 novembre, le manège se poursuit et les jours qui suivent, un pont aérien s'établit, auquel, malgré les promesses de l'Axe, les Italiens viennent se joindre.
La journée du 11 est fertile en rebondissements dans le camp français où ordres et contre-ordres se télescopent. Estéva et Derrien tergiversent tandis que Barré entame son jeu secret et téléphone au général Juin pour se placer sous son autorité. Un débarquement germano-italien semble imminent, il se produira le lendemain. A partir de l'après-midi du 12, les troupes allemandes commencent à débarquer à Tunis et surtout à Bizerte où 2 cargos et 5 torpilleurs pénètrent sans opposition, précédés de vedettes rapides ; les épaves jonchant la passe ont été drossées le long des berges sans réussir à constituer l'obstacle escompté. Le 13, pendant que l'arrivée des renforts allemands s'intensifie, l'état-major français tient conférence et adopte la formule « durer sans tirer » dans l'attente d'un secours allié à l'ouest. Le 14 novembre, Tunis et Bizerte sont occupées par l'Axe dont les troupes représentent encore un effectif modeste n'excédant pas 8 000 hommes. Une dernière tentative de Darlan et Juin pour rallier Derrien échouera et la petite flotille de Bizerte ne connaîtra même pas l'honneur du sabordage ; torpilleurs et avisos seront remorqués dans un port italien. Circonstances atténuantes pour le résident général et le préfet maritime : ils ont cru pouvoir éviter une effusion de sang et ont cédé au chantage du général Nehring, commandant les forces de l'Axe en Tunisie, qui leur a prédit une « polonisation » de la France en cas de passage à la dissidence (en fait, ils avaient légalement le droit de s'affranchir, les Allemands ayant d'eux-mêmes rompu les conventions d'armistice en envahissant la zone sud dès le 11 novembre). D'autre part, l'amiral Estéva aura le mérite de s'opposer aux directives de l'amiral Platon, dépêché de Vichy par Laval le 15 novembre, en libérant les internés politiques pour leur permettre d'échapper aux Allemands et en protégeant l'évasion du personnel officiel américain. Enfin, il s'efforcera de faire évacuer vers l'Algérie, par voie routière et ferroviaire, le maximum de matériel militaire.

Novembre
1942 : Spectacle anachronique
d'un régiment de
tirailleurs, hommes, mulets,
armement, en route pour le front
tunisien.
Le Général Juin bat le rappel
Grâce à l'extrême rapidité de leur réaction, les Allemands ont pu se rendre maîtres de la Tunisie orientale et de ses ports, ce qui renforce singulièrement leur position au centre de la Méditerranée et leur permet d'étrangler le trafic allié vers l'Egypte, tout en couvrant le leur vers la Tripolitaine. Ils ont, du même coup, mis provisoirement à l'abri les arrières de Rommel battant en retraite devant Montgomery. Kesselring contrecarre ainsi le jeu des Alliés en faisant obstacle à l'objectif second de l'opération « Torch » : foncer vers l'est de manière à prendre l'« Afrika Korps » en tenaille avec la VIIIe Armée britannique.
Si, pour l'Axe, les lignes de communication avec la Tunisie sont courtes et encore sûres, malgré les chasseurs britanniques basés à Malte, pour les Alliés, les voies d'accès sont longues et précaires. Quant aux forces françaises de Tunisie, elles ne préoccupent guère l'ennemi. Elles sont réduites à 9 bataillons et 3 groupes d'artillerie de 75. Et encore, ce maigre effectif est-il dépourvu d'armement moderne et de moyens de transport automobile. Les troupes sont réparties dans des garnisons côtières sur plus de 500 kilomètres et se déplacent le plus souvent à pied, à cheval ou à dos de mulet.
A aucun moment le maréchal Kesselring n'a envisagé qu'une poignée de « poilus » en capotes et en bandes molletières pourrait entraver la progression de ses « panzer ». Presse de déclencher une offensive de rupture et persuadé de la neutralité militaire française, le haut commandement allemand a décidé de pousser le plus loin possible vers l'ouest au-devant des colonnes alliées qui, logiquement, ne sauraient tarder à se manifester.
Mais les Anglo-Américains lambinent et n'interviendront pas avant le 25 novembre en n'engageant qu'une division légère. Aussi, ce seront les Français qui ne tarderont pas à créer la surprise en refusant non seulement le droit de passage aux Allemands, mais en acceptant la bataille dans des conditions d'infériorité incroyables.

Front
tunisien, automne 1942 : Artillerie de montagne
à dos
de mulet. Le soldat au premier plan est armé d'un
pistolet-mitrailleur allemand de récupération.
En donnant l'ordre d'engager le combat malgré un handicap apparemment insurmontable, Juin, qui connaît admirablement le terrain, compte sur les reliefs tourmentés de l'arrière-pays pour mettre en difficulté les lourdes unités mécanisées de l'ennemi.
Sur le plan géographique, la Tunisie est un pays montagneux de bas relief dont les cultures, les villes et les ports sont concentrés au nord-est, le long d'une bande côtière où débouchent le couloir de la Médjerda et de nombreux oueds. A l'intérieur se dressent deux chaînes articulées au nord autour du pivot du Djebel Zaghouan : l'une orientée vers le sud en direction de Gabès, la Dorsale orientale, et l'autre vers le sud-ouest, la Dorsale occidentale ou Grande Dorsale, qui commande la vallée de la Médjerda et les voies de communication avec l'Algérie. La stratégie développée par le général Juin consistait à prendre position sur les deux branches de la Dorsale tunisienne ; celle de l'ouest commandant l'accès de l'Algérie, afin de permettre le passage des troupes alliées et celle de l'est commandant l'accès de la Tripolitaine, afin d'interdire la jonction des forces tunisiennes de l'Axe avec l'« Afrika Korps ». Ce plan, élaboré depuis le 9 mai 1942, était parfaitement assimilé par le commandement français en Tunisie.
Dans leur état de dispersion et d'impuissance face aux chars et aux avions ennemis, les troupes françaises de Tunisie étaient incapables de s'engager dans une bataille « conventionnelle »- Elles ne pourraient résister que concentrées sur une position organisée, derrière une faille ou dans les reliefs de la Dorsale. En attendant les renforts d'Algérie, des lieux de replis appelés « points vitaux » où, disait Juin « un bataillon peut suffire à arrêter une armée » avaient été méthodiquement choisis. Ainsi, la garnison de Tunis devait s'installer face à l'est, sur les hauteurs d'Oued-Zerga, couvrant une sorte de champ clos constitué par la haute vallée de la Médjerda. C'était le fameux « quadrilatère » gardé sur trois faces par les montagnes et sur la quatrième, face à l'est, par la position de couverture qui constituait la seule « place d'armes » possible, à portée de Tunis, pour des forces arrivant d'Algérie. Quant aux petites garnisons du Sud, elles se replieraient sur la trouée de Tébessa pour verrouiller l'accès méridional de l'Algérie. Restait le plus difficile : passer aux actes.
Le 11 novembre à 18 heures, au P.C. du général Barré à Souk-el-Arba, la sonnerie du téléphone retentit, le général décroche le récepteur :
— « Juin
à l'appareil »
— « A vos
ordres, mon général ».
— « Les
Allemands sont à Bizerte, que font-ils ? »
—
« Ils cherchent à gagner de l'espace et à se
répandre vers l'ouest ».
— « Dans
ce cas, mon ordre est formel : appliquez le plan prévu et
s'ils essaient de déboucher, ouvrez le feu ! »
Le Général Barré passe à l'action
Immédiatement, le général Barré commandant les troupes de Tunisie passe à l'action sur les bases tactiques du plan de défense du 9 mai 1942.
Toutes les garnisons littorales doivent être repliées dans la montagne. Le décrochage de Tunis s'effectue par surprise dans la nuit du 11 au 12 novembre. L'ensemble des unités est dirigé sans accrochage sur la position d'Oued-Zerga. Un « bouclier d'arrière-garde » comprenant des chasseurs du 4e R.C.A., des coloniaux du 43e, des artilleurs et des gardes républicains, en tout un millier d'hommes, aux ordres du colonel Le Coulteux, s'établissent en hérisson autour de Medjez-el-Bab, la « porte » qu'il faut à tout prix maintenir fermée, car elle ouvre la route d'Alger. Simultanément, arrivant d'Algérie à marche forcée, le détachement de couverture de l'est, aux ordres du général Kceltz, a reçu du général Juin la double mission de « maintenir le contact avec l'ennemi et retarder sa progression vers l'Algérie afin de permettre aux Alliés la concentration de leurs forces en cours de débarquement » ainsi que de « tenir le nœud de communication de Tébessa et de se renseigner sur les intentions de l'ennemi en direction de Gafsa, des Chotts et de Gabès ». Dès le 14 novembre, un détachement motorisé contrôle l'axe Tébessa-Gabès. Le 15, les patrouilles de pointe de la division de Constantine, aux ordres du général Welvert, font leur entrée à Gafsa ; le 16, la ville est occupée. Le 17 au matin, l'unité de reconnaissance commandée par le lieutenant Argoud ouvre pour la première fois le feu contre l'ennemi sur le sol tunisien. Tirant de toutes ses armes, elle empêche un groupe de 15 avions de transport allemands de se poser sur le terrain de Gabès. Le 18, avec le concours des cheminots, un pont de chemin de fer est détruit au nord de Gabès ; les premiers prisonniers allemands sont capturés. Dans la soirée, l'escadron d'Estrées attaque un train à Maharès, une centaine de soldats de l'Axe sont tués.

Mitrailleuse Hotchkiss - en position dans la grande dorsale
Medjez, c'est l'Armée d'Afrique qui entre en lice
Entre-temps, le général Nehring, nouveau commandant des troupes de l'Axe, lance un ultimatum au général Barré « Evacuez la Tunisie ou collaborez avec nous ». Barré répond « Aucune de ces deux solutions ne me convient. Vos conditions sont inexécutables ». Nehring insiste et délègue à Medjez-el-bab le docteur Mcellhausen, conseiller d'ambassade, accompagné du colonel Fiedler, afin de rencontrer le général Barré et de tenter une dernière fois de le convaincre au soir du 18 novembre. Vaine démarche. Mcellhausen remet alors à Barré un ultimatum expirant le 19 novembre à 7 heures du matin.
Le 19 au petit jour, sur la position de Medjez-el-Bab, un cri s'élève « Les Américains sont là ! ». Hélàs ! si la nouvelle est exacte le renfort de la grande armée alliée est symbolique : 2 pièces antichar de 37, 2 canons « Howitzer » de 75 et un « Bofors » antiaérien de 40 avec leurs servants. Qu'importe, la jonction est faite et les « Yankees » sont acclamés.
A 8 heures, des avions à croix gammée survolent la position et les américains font parler la poudre. Vers 11 heures, 23 « Junkers 87 » approchent dans leur ronronnement modulé si caractéristique. Les « Stukas » arrivent à l'aplomb du village qu'ils attaquent en piqué. Dans la fumée des éclatements, un « stick » de parachutistes est lâché, tandis que l'artillerie et les blindés entrent en action. Trois attaques lancées par l'infanterie allemande sont repoussées. Les vagues se succéderont jusqu'à la nuit, inlassablement brisées par les coloniaux du 43e R.I.C. qui termineront sur une charge menée en chantant, baïonnette au canon. Deux artilleurs américains avaient été tués à leur pièce par un obus de 77. Leurs corps seront ensevelis dans les plis du drapeau français, symbole de l'alliance franco-américaine retrouvée.
Les faits sont modestes comparés aux vastes affrontements du front russe. Mais ce premier face-à-face à surpris l'Allemand qui marquera un temps d'arrêt. Au delà de l'action elle-même, à Medjez-el-Bab, c'est l'Armée d'Afrique qui entre en lice.
(A suivre)
Georges BOSC
************************************

« Une
poignée de poilus en capotes et bandes molletières» ,
qui ramène ses premiers prisonniers allemands »
Yves PLEVEN
LA
MOBILISATION DES CHANTIERS DE JEUNESSE
On ne reviendra pas ici sur les circonstances du débarquement des Alliés au Maroc et en Algérie le dimanche huit novembre 1912. La - bissectrice de la guerre -, comme on a pu l'appeler, devait avoir sur les populations d'A.F.N., un impact dont on peut aujourd'hui encore, mesurer les conséquences. Les jeunes gens qui s'y trouvèrent mêlés, à des titres divers, ont toujours présent à la mémoire ces événements qui tenaient du prodige. Cette flotte d'où se déversaient des troupes aux uniformes inconnus, ces matériels flambant neuf, ces armes à profusion ; ces batteries d'artillerie anti-aérienne installées sur le Front de Mer d'Alger, ce ciel de la baie piqueté de ballons, ces obus stockés à nu le long de nos routes... Puis, bientôt, de jeunes soldats à l'anglais peu compréhensible paraissaient, offrant des douceurs, des cigarettes, portant des gants pour les manutentions, avec un air d'enthousiasme déjà victorieux, et sans attendre, des alertes aériennes, des bombes, des destructions, des victimes, le rappel sous les drapeaux...
Ce choc reste pour tous un commencement devenu légendaire. Nous avions vingt ans.
Chantiers de Jeunesse et Nordafs
Que sont les Chantiers de Jeunesse, que sont les CJJ*. ? Les conditions d'armistice supprimant le service militaire, ils sont créés par le ministère de la Famille et de la Jeunesse en août 1940. C'est un service civique de huit mois auquel sont astreints les jeunes gens arrivés à leur majorité. Travaux agricoles, forestage, carbonisation sont à l'honneur en métropole. La doctrine participe de la pratique du scoutisme et des principes de lu Révolution Nationale. Vilipendés par l'opinion à la Libération, certains groupes C.J.F. ayant été requis au S.T.O. par l'occupant, ils trouvent cependant un défenseur, François Mauriac. Ce dernier estime que si l'on avait dû conserver une seule création du gouvernement de Vichy, c'était bien les CJJF.
En Afrique du Nord, si les travaux d'intérêt général sont exaltés, on insiste surtout sur la préparation physique et morale. Si la devise - Travail, Famille, Patrie - et les paroles du Maréchal sont commentées, il n'est pas interdit d'y comprendre ce qu'inspirent les remarques, l'activité et quelquefois l'exemple des supérieurs. Reprendre la lutte un jour paraît dans l'ordre des choses. Le chant - Les Africains - comporte des couplets sans nuance à ce sujet. Les exercices, souvent répétés, l'endurance qu'ils confèrent, ne préparent pas seulement à la vie aux champs.
Ce sont donc vingt mille de ces jeunes gens qui vont faire l'objet d'un rappel sous les drapeaux sans doute unique dans notre histoire.
Comment et pourquoi ces jeunes gens d'Afrique du Nord ont-ils été rappelés si hâtivement ? Où ces mesures précipitées les ont-elles conduits ? Le commissaire régional des CJJ ?., Alphonse Van Hecke qui a sous sa responsabilité les sept groupements d'A.F.N., est très clair. Dans son ouvrage - Les Chantiers de la Jeunesse au secours de la France, 1940-45, Souvenirs d'un soldat -, (Nouvelles Editions Latines, 1970), il rappelle la devise qu'il avait donnée en août 1940 à cette nouvelle formation :
- Par nous la France renaîtra. Qui est Van Hecke ? Il a atteint la cinquantaine au moment des événements. Ancien de la Légion étrangère au Maroc, en A.O.F., en Indochine, il s'est distingué pendant la Grande Guerre comme jeune lieutenant sur le front français. Officier de la Légion d'honneur depuis 1931, c'est un vrai chef de guerre à l'accent néerlandais, furieusement hostile à tout ce qui est allemand. Ses imprudences verbales sont célèbres et inquiètent les autorités. Sa réputation de fonceur le rend très populaire auprès de ses lieutenants, de ses jeunes. En marche, au travail, on entend cette boutade lancée en guise d'encouragement - Tu fonces, Alphonse ! - Nous verrons comment le projei de Van Hecke, de lever un corps d'armée dont il aurait été le chef, reçut un commencement d'exécution où se heurtèrent aspirations, énergies et personnalités dans un tohu-bohu politique inévitable. Nous verrons aussi, ce rêve de - garde prétorienne - une fois brisé, le sort de ces jeunes qui furent les premiers mobilisés de l'Armée d'Afrique en 1942.
Dans ses - Souvenirs - (op. cit. p. 244), le chef Van Hecke précise qu'il demande à l'amiral Darlan, Haut Commissaire en Afrique, dès le 12 novembre, soit quatre jours après l'intervention alliée en A.F.N. la militarisation des C.J.F. Après une âpre discussion, l'Amiral signe le décret. Présentés avec fermeté, les arguments du chef Van Hecke ont porté. Cette mobilisation procurerait 1 700 officiers et 38 000 jeunes gens qui ne demandent qu'à se battre pour la Patrie. L'Armée d'Afrique bénéficiera ainsi d'un renfort de 40 000 hommes, soit 30% de son effectif.
Avis de rappel.
Ils commencent à paraître dans la presse et leurs libellés vont refléter l'évolution politique à Alger.
La - Dépêche Algérienne - du 15 novembre contient un article en première page où il est fait appel aux - hommes dont la Patrie a besoin pour écraser le - boche - et son brillant second - .On reconnaît le style de Van Hecke qui signera désormais - Commissaire en Chef des C.J.F. -. Le terme de - jeune de France - a disparu. On ne l'entendra plus...
Le 16 novembre, le Haut Commissaire de France en Afrique, l'amiral Darlan, signe l'ordre N°1 au nom de Philippe Pétain, Chef de l'Etat Français, habilitant le gouverneur général de l'Algérie à prendre les mesures qui s'imposent
Le 17, le public est informé que l'organisation des rappels par demi-contingent est en cours et que l'on en fixera les modalités sous peu. Ces modalités paraissent le lendemain 18. Les - Anciens -, on ne dira pas réservistes, nés entre le 1er janvier 1920 et le 14 août 1922 sont rappelés au service (Art. 1). Dans un Art. 2, il est précisé que les sursis médicaux et pour raison d'examen sont maintenus. L'Art. 3 indique que les Juifs européens et indigènes selon la loi du 2 juillet 1941 ne sont pas visés(16).
Les convocations s'échelonnent sur onze départs entre le 20 novembre et le 4 décembre 1942. Cest donc par quart de classe que les anciens rejoindront les camps et dans l'enthousiasme : environ 14 000 hommes, auxquels s'ajoutent quelque 5 000 de la classe 42 appelés le 14 novembre et ceux du contingent libérable qui seront maintenus en activité.
Un des derniers avis parus dans la presse du 20 novembre, doublé comme les précédents d'un appel à la radio, est caractéristique : il faut absolument mettre un frein à cet afflux de rappelés qui anticipent la date fixée. Dans son style reconnaissable, le commissaire en chef, après avoir rappelé les recommandations au sujet de l'équipement et des vivres dont chacun doit se munir et qu'on lui remboursera, insiste sur le respect absolu des dates de convocation.
- Il convient de rejoindre aux dates fixées et non avant sous peine de créer des embouteillages préjudiciables à tous... Je compte sur les - anciens - des Chantiers pour donner l'exemple... Tout en les félicitant pour leur enthousiasme qu'il partage, apprécie et constate avec fierté, il leur demande de se rendre compte de l'absolue nécessité qu'il y a à ce que ce rassemblement s'opère dans l'ordre et avec méthode... -
Tel est le brillant résultat de l'endoctrinement dispensé aux jeunes Nordafs des Chantiers de Jeunesse et obtenu par le travail préparatoire des A.D.A.C en vue d'une mobilisation éventuelle. Il faut remonter loin dans l'histoire de France pour trouver pareille flamme patriotique. Il s'y ajoute la fierté unique, pour des Français venus d'Outre-Mer, d'aller à la délivrance de la mère patrie.
C'est une première...
A toutes les sauces
Que vont devenir ces premiers mobilisés ?
Avant de Suivre le gros de cette troupe dans ses cantonnements de fortune, il convient de citer le sort particulier des jeunes du groupement 106, de Sbeïtla, dans le Sud Tunisien. La Luftwaffe occupe l'aéroport d'El Aouina, près de Tunis le 9 novembre. Sans tarder, les troupes allemandes s'avancent vers le sud où elles rencontrent la division du général Barré, commandant des troupes françaises en Tunisie, renforcée bientôt par la division de Constantine du général Welvert. Appuyés sur la dorsale tunisienne, les Français retardent l'avance allemande qui menace Tébessa en Algérie, (nov./déc. 1942). Pas de mobilisation possible pour le groupement 105 de Tabarka, pris dans l'avance allemande. En revanche les jeunes du gt 106, bien encadrés, décrochent en bon ordre et rejoignent les lignes françaises. Le groupement devient le 106e bataillon de travailleurs tunisiens et participera aux tâches multiples d'une armée en campagne dans la zone de front. (- le groupement 106 de Sbeïtla. Tunisie -, par Gilbert Martin. Bulletin National Officiel de l'Association Nationale des Anciens des CJF, de juin 1986).
_______________
(16)
Les Israélites européens et indigènes - feront
l'objet d'un ordre de convocation sous les drapeaux le 23 novembre
1942.
D'autres vont connaître le feu sans plus attendre. Le 6 novembre, des appelés du contingent se présentent à la citadelle de Djidjelli, centre du groupement 104. Ils répondent au dernier appel de la classe 42. Le dimanche suivant, le 8 dans l'après-midi, les chefs les informent du débarquement allié à l'ouest de l'Algérie. Vingt-deux volontaires sont levés - pour la défense de la Patrie -. Seule exigence, être - costaud -. Cette équipe sera dirigée sur Kasserine en Tunisie où elle assurera sous le feu, l'assistance de base au groupe sanitaire mobile léger — transport de blessés, inhumations — avant d'être incorporée en mars 1943 au 7e Tirailleurs Algériens de Sétif et enfin dotée d'un uniforme (témoignage du col. Gonzales, archives privées). L'urgence des besoins en main d'oeuvre créée par le débarquement du train d'une armée moderne, trouve une solution inespérée. Beaucoup des appelés de novembre, sont affectés au montage des matériels de guerre, à Bône, à Alger sur le Champ de Manœuvre. La traduction des manuels techniques est confiée aux ex-étudiants. Ces personnels qualifiés de - available auxiliaires - (traduction libre : - à toutes les sauces -) seront remerciés par le général Eisenhower, commandant suprême des forces américaines, dans son communiqué de mars 1943, une fois le travail accompli. Ce sont donc quelques milliers de jeunes gens qui vont faire, sans délai, œuvre utile. Les autres, 15 000 environ, vont poser des problèmes qui ne seront jamais résolus. A commencer par l'intendance. Ces - anciens - ne retourneront pas dans leurs groupes d'origines. On y reçoit les appelés de novembre 42. Les libérables y sont maintenus. Le commissaire en chef Van Hecke est d'ailleurs dans l'obligation de faire évacuer ces camps, pour y recevoir et former en quatre mois trois contingents successifs qui seront levés jusqu'en fin 1943. On a compté avec raison sur les - Anciens -, pour endurer de rudes conditions d'existence. Ils seront cantonnés dans les fermes de la Mitidja, des Hauts Plateaux sous le commandement de chefs CJF. Cest dans l'enthousiasme qu'ils s'y rendent
Pourquoi ce rappel hâtif ?
Pourquoi cette hâte qui jette, sur un simple avis paru dans la presse, près de 15 000 jeunes gens sur les routes ? Et d'abord comment expliquer pareil enthousiasme ? C'est clair. Les ports d'Alger et de Bône sont fréquemment bombardés. La chasse aérienne, la marine, la défense contre avions des Alliés font brillamment leur devoir sous les yeux des populations. La Tunisie toute proche est envahie par les forces de l'Axe. L'Afrika Korps de Rommel venu de Libye, fait sa jonction avec la division Von Anilin débarquée d'Italie, pans le département de Constantine, Tébessa est menacée. La morne existence faite aux habitants d'Afrique du Nord où les restrictions sont sévères, surtout en ville, — transport à gazogène, réglementation omni-présente, marché noir, incertitude —, est soudain balayée par l'ouragan de la guerre mondiale. Il est facile de faire participer des jeunes gens à cette fête, avec au bout, et personne n'en doute, un débarquement des troupes françaises en métropole et la gloire pour tous. - Les guerres sont les vacances de la vie - disait un philosophe local dont la maxime se lisait sur les murs de Naples à Sienne...
Le démantèlement
Le commissaire Van Hecke connaît bien la situation. Ce retournement politique qu'il a contribué à préparer (n'était-il pas du fameux - groupe des cinq -), va lui donner l'occasion attendue dans la fièvre depuis 1940 d'en découdre avec les Allemands. C'est son métier de baroudeur. Il se voit à la tête d'une petite armée, - en marge de la régulière -, qu'il conduira à la Libération de la mère patrie et à la Victoire... (- Les C.J.F. au secours de la France - op. cit. page 247). Par nous la France renaîtra !... Le 6 décembre, après l'avoir félicité pour cette mobilisation où ses services ont joué un rôle essentiel, l'amiral Darlan lui signifie que ses effectifs seront absorbés par divers corps de l'Armée d'Afrique, lui laissant - le personnel nécessaire pour la création d'une brigade blindée dont vous prendrez le commandement - (Les C.J.F au secours de la France op.cit. p. 249) C'est le début du démantèlement. L'Amiral fait prendre au général Giraud les dispositions pour que le commissaire en chef puisse accéder au grade de général. Hélas, deux jours après, le Général lui rafle sa brigade, ne laissant - au commissaire régional des Chantiers de la Jeunesse que la disponibilité des effectifs qui pourraient subsister pour la mise sur pied de groupes francs - (Cf. op. cit. p. 249). Après avoir protesté contre cette - spoliation -, le Commissaire conserve l'organisation des C.J.F. où il assurera l'incorporation des appelés de la classe 43 dès le 15 janvier dans les camps existants. Il demeure autorisé à prélever mille hommes encadrés pour former une unité d'élite du type bataillon moderne d'infanterie motorisée. C'est la naissance du 7e Chasseurs, unité prestigieuse où les Nordafs compteront pour les trois quarts de l'effectif et qui va se couvrir de gloire dans les campagnes d'Italie et de France. Pour les affectations diverses auxquelles se rendirent ces 35 000 hommes environ, les renseignements sont imprécis. Voici quelques chiffres approximatifs : Armée de l'Air 5 000 - Corps Franc d'Afrique : 4 500. - engagés en Tunisie comme on l'a vu plus haut : 4 000 environ. Dans une véritable foire aux effectifs, 20 000 seront versés à l'aveuglette dans divers corps de troupe, Tirailleurs, Génie, Artillerie, etc. La Marine nationale recevra les C.J.F. Marine, environ 4 500 (Bulletin National des Anciens des C.J.F N° 18NS de juillet 1989 et Campagne de Tunisie, publications du Service Historique de l'Armée. Vincennes 1985, MM. Spivak & Léoni). Le commissaire Van Hecke s'estime - roulé - et par l'Amiral et par le Général. N'a-t-il pas pourtant facilité l'arrivée de ce dernier en Afrique du Nord ? C'est un rôle très actif et fort hasardeux qu'il a joué parmi les organisateurs français de l'intervention alliée. Il était l'un des interlocuteurs du général Clark, émissaire de l'Etat-Major des troupes américaines, lors de l'entrevue de Cherchell, préalable au débarquement, en octobre 1942. - La satisfaction des arrières pensées fait les bons accords - a dit à peu près Paul Valéry.
Les raisons purement militaires qui s'opposèrent à ce projet de corps d'armée issu des C.J.F. sont de toujours. Dès l'année précédente, on se préoccupait déjà d'une telle éventualité. Dans ses archives inédites, le général Penette rapporte un entretien qu'il eut l'occasion d'avoir en 1941 avec le général Weygand, alors Délégué général du gouvernement en Afrique Française. Deux obstacles majeurs apparaissent :
1. Etant donné la pénurie de Français instruits et moralement préparés existant dans notre armée, ce serait une erreur que de former une légion de combattants d'élite, vite engagée, vite décimée.
2. Quelle que soit l'efficacité de l'instruction donnée aux Chantiers — et tout le monde la jugeait excellente au point de vue national et morale privée —, on ne saurait exposer cette jeunesse aux vicissitudes et destructions du champ de bataille moderne, sans une spécialisation poussée. Celle-ci nécessitait des cadres et des moyens... Force était de se séparer nettement des aspirations du commissaire Van Hecke, au moins sur deux points :
a) au lieu de constituer une phalange prétorienne sous son commandement, les C.J.F. devraient être répartis entre toutes les unités de l'Afrique du Nord.
b) - Leur intégration dans l'armée ne pourrait être que très progressive et réglée avec un soin extrême, de crainte de voir cette bouillante jeunesse s'accomoder mal des situations de flou et de désordre qu'engendrent les états de crise inhérents aux convulsions politiques et perdre par là même ce moral magnifique qui constituait son plus brillant atout -. (La Résistance fondamentale, F. Dessaigne, Annexe XXXVI, p. 348 Ed. Confrérie Castille, 22080 Plougrescant déc. 1991)
Les faits ont donné raison à ces conceptions qui étaient celles du général Weygand dès 1941. Mais il n'était plus là pour de sa haute voix les faire valoir et les faire appliquer. L'amalgame s'imposait, celui des soldats de l'An II.
Yves PLEVEN
**********************************
SOUVENIRS D'UN RAPPELE DE NOVEMBRE 1942
Nous sommes rappelés par des avis parus quotidiennement dans la presse algérienne depuis le 16 novembre. Les - anciens - que nous sommes ont entre vingt et vingt deux ans. Nous avons tous fait notre temps de service obligatoire dans les C.J.F. - huit mois - et sommes libérés depuis peu.
C'est le 30 novembre que je rejoins avec Guy IL, un camarade. Il s'est marié le 21, et bénéficie d'un sursis. Convoqués à la gare de l'Agha, pour 16 h 00, le train ne part qu'à 20 h 00 à cause d'une alerte sur le port. Ma mère m'a accompagné. Dans les wagons de IIIe classe, nous sommes quelques 500 à chanter les - Africains -. Ce n'est que passé minuit que nous arrivons à la Halle aux Tabacs de Blida, centre d'accueil du groupement 103 des CIE. Rien à manger. Il faut dire qu'on s'y attendait, nous avons tiré nos casse-croûtes de nos sacs. Le lendemain, je me retrouve dans une section affectée à Marengo, plus de trente kilomètres à faire à pied... La Mitldja est très belle sous son ciel bleu où passent des cumulus de beau temps. Les - zarzars - (étourneaux) fondent en tornade serrée sur les oliveraies dont la récolte s'annonce. Les orangers font une frise à l'Atlas Tellien... Bou-Roumi... Mouzaïaville... El Affroun... On arrive en début d'après-midi à Marengo. Grâce à nos chaussures de marche, Paul C. et moi sommes les premiers. Le reste du détachement arrive au compte-goutte, il n'est plus qu'une suite de petits groupes s'échelonnant sur vingt-cinq kilomètres. Certains, bons fils, bons frères ont laissé leurs chaussures à la famille. Ils portent des souliers bas, des espadrilles, ou même vont pieds nus. Cette troupe mendie son transport aux camionneurs... A destination, un assistant nous reçoit fort aimablement, et une fois regroupés, nous fait diriger vers le Monument aux Morts de Marengo. Il fait nuit noire. Harangue... Mère Patrie... commandos... libération... entraînement sévère mais sort prestigieux qui nous attend... Citant le chef de groupement Camus, commandant le 103, - Vous partirez mille, vous reviendrez un - nous dit-il en terminant. Puis en route pour le cantonnement à la ferme D. On ne nous attendait pas aussi nombreux. Le haut des cuves à vin recouvert d'un centimètre de paille peut accommoder une vingtaine d'hommes. Nos quatre équipes y ont leurs quartiers, deux fois plus. On se serre, on n'aura pas froid. Il n'y a pas de cuisine roulante. Elle serait inutile d'ailleurs il n'y a rien à faire cuire. Il me reste quatre boîtes de conserves qu'il faudra faire durer. Et puis, le colon ne peut plus évacuer sa récolte de vin, il ne dira rien si on en chaparde quelques bidons pour l'échanger auprès d'un G.I. contre du corned-beef. Les boys viennent de découvrir le - vino - !... Notre régime est de plus en plus frugal, du pain et des mandarines, je me souviens qu'un matin étant de corvée de ravitaillement, on se retrouve devant une demi-poitrine de mulet a partager entre soixante affamés... on en vient aux coups. Quelle fureur plus tard quand on apprend que notre - ravito - quotidien était absorbé par le marché noir... On nous occupe à faire l'exercice sans armes sur la route nationale déjà ravinée par les convois US montant vers la Tunisie et que dépassent quelquefois les - arabas - et les mulets des Tirailleurs que l'on commence à surnommer la - Royal Brel Force - Il pleuvra à verse tout le mois de décembre — - De l'or qui tombe -, commente Monsieur D. Ces démonstrations de classe à pied — nous sommes des - anciens - après tout..., — nous paraissent en réalité destinées à prouver aux Alliés que la participation de la France à l'effort de guerre est réelle. Le soir des lueurs à l'horizon du côté d'Alger, où pour la plupart nous avons nos parents, indiquent des alertes aériennes. Disperser les effectifs dans le bled pour les mettre à l'abri : sans doute la meilleure idée des C.J.F. ces temps-ci. Des murmures commencent à se faire entendre sur les rangs. - Vive l'Armée - serait-il un cri séditieux dans la cour de la ferme ? Il exprime seulement l'opinion générale - Que fait-on ici ? Commando de pelles et pioches, vivement quelque chose de sérieux. -

La mobilisation des Chantiers de Jeunesse
Vers le 20 décembre, on part sous une pluie éternelle, toujours en civil, souliers bas ou espadrilles, vers Ameur el Aïn, Oued cl Alleug. Nos équipes s'installent dans un petit hangar d'aviation de la ferme B., où dort le - Luciole - de la jeune fille de la maison. C'est charmant De la paille en abondance. Les chefs ont disparu sans nous faire leurs adieux. Paul C. fort avancé dans ses études, est appelé à l'Ecole d'officiers de Cherchell dont on apprend ainsi la création récente. Nous ne sommes plus commandés que par un chef d'atelier. Il est de Metz et fait une mine d'enterrement.
A la ferme B. les dames repliées d'Alger nous ont préparé un petit festin pour Noël. Au retour de la messe de minuit c'est complet, arbre décoré, méchoui de trois moutons, dattes fourrées, de vrais couverts, de vraies assiettes... La fête!...
Le lendemain, une - Dépêche Algérienne - au format très réduit nous apprend sur manchette l'assassinat de l'amiral Darlan. Ce n'est que plus tard que nous saurons que c'est de la main d'un -ancien - du 103.
Le 30 décembre, par le chemin de ferme, sortent péniblement du brouillard deux vieux autobus repeints du gris militaire. Ils stoppent devant le hangar. Rassemblement avec paquetage. Le chef d'atelier messin commande : - Première et deuxième équipe, première voiture ! Le reste, deuxième voiture !... - Je suis du reste. On est parti tout de suite. Les camarades de la première voiture nous ne les avons jamais revus. On a dit plus tard qu'ils étaient versés dans l'Artillerie. La deuxième voiture s'arrête devant la Halle aux Tabacs de Blida. Un civil nous fait entrer par une petite porte. Il prend nos noms et demande si nous sommes volontaires pour être parachutistes. - Non. Mais où est-on ? - — - Vous êtes dans l'Armée de l'Air ! - — Cest le grand coup d'éteignoir final sur l'enthousiasme. On n'allait jamais voir un avion français... On sait qu'il faut près d'un an de formation pour devenir navigant... D'ici là... On allait moisir sur un aérodrome à regarder passer les avions alliés... De toutes façons, on est privé de débarquement en France. Les rêves de gloire s'écroulent. Les uniformes de drap bleu louise sortis de la naphtaline de l'Armée de l'Armistice dont nous sommes dotés ne nous consolent pas.
Cette aventure de quelques semaines, vécue par environ 30 000 jeunes gens d'A.F.N., ne peut que prouver la ferveur patriotique qui devait conduire certains à participer à la libération de la Métropole.
Yves PLEVEN
******************************
Jean FLORENTIN Tunisie 1942-1943
POURQUOI les Américains,bénéficiant de la surprise, n'ont-ils pas, dès le 8 Novembre, occupé Bizerte et Tunis ? Sans doute manquaient-ils d'effectifs ou étaient-ils mal préparés. La campagne de Tunisie fut la lourde conséquence de cette grave lacune.
Les Allemands arrivèrent à l'aérodrome d'EI-Aouina dès le 9 novembre. Le général Barré, commandant supérieur des Troupes de Tunisie ne pouvant plus contrôler les ports de Bizerte et Tunis, ni même la route Tunis-Gabès-Tripoli retira ses troupes vers l'intérieur montagneux, en verrouillant tous les passages vers l'Algérie ; c'était d'ailleurs la mission qu'il avait reçue du général Juin, commandant en chef des forces terrestres et aériennes française d'A.F.N.
Pendant ce temps les Américains s'installaient méthodiquement en Algérie. Les Britanniques comprirent vite combien l'« oubli » d'occuper Bizerte et Tunis était regrettable. Du 25 novembre au 10 décembre, ils attaquèrent d'une part vers Bizerte par les monts de Kroumirie, d'autre part vers Tunis par la vallée de la Medjerda. Ce fut un double échec.
Jusqu'à la fin janvier 1943, l'Armée d'Afrique avec ses faibles moyens, dans le froid et sous une pluie continuelle, engageant 75 000 combattants, réussit à contenir l'ennemi à tous les passages vers l'Algérie, Medjez el Bab, Pont du Fahs, Kasserine, col du Faïd.
Au moment du débarquement, j'étais lieutenant au 4e régiment de tirailleurs tunisiens à Gabès. Nous fûmes immédiatement mis en alerte, avec pour mission de nous installer défensivement sur les plages voisines du port. Nous étions à l'affût de toutes les nouvelles, de tous les bobards. On nous apprit même que l'amiral Darlan, alors à Alger, était devenu notre chef au nom du Maréchal ! Incroyable, mais vrai ! Bientôt, nous reçûmes l'ordre de nous replier sur Gafsa, puis sur Tébessa avec notre vieux matériel fatigué et nos vêtements élimés qui nous protégeaient mal de cet hiver rigoureux dans les montagnes de la frontière algéro-tunisienne. Nous avions dû abandonner nos familles à Gabès, à la merci de l'ennemi. Elles furent bombardées quasi journellement pendant six mois par l'aviation alliée. En position dans les montagnes, nous pouvions compter les « Forteresses volantes » et les bombardiers « Halifax », passant au dessus de nos têtes, allant déverser leur cargaison de mort avec tous les risques que cela comportait pour ceux que nous aimions. Pour nous, c'était le dénuement total. Dans certaines campagnes, des tirailleurs tunisiens désertèrent, démoralisés et travaillés par la propagande pro-germanique du bey Moncef. Le 19 janvier 1943, si mon souvenir est fidèle, à l'ouest de Pichon ma compagnie vint relever celle commandée par mon ami Sapin-Lignières. Il s'était magnifiquement battu sur cette position. La pluie avait cessé, et cette nuit-là, très calme, une grosse lune ronde éclairait les plantations d'oliviers. Quelques jours plus tard, les Allemands lançaient sur nos arrières, une grande attaque de blindés. Nous étions anxieux, abrités dans les rochers du djebel Ousselat, alors que les chars « Tigre » croisaient dans la plaine d'Ousseltia derrière nous : impression d'impuissance mêlée d'angoisse.
Nos soldats ont lutté jusqu'au bout en attendant que les Américains et les Britanniques de la VIIIe armée déclenchent leur puissante offensive de printemps. Ils y participèrent dans la plus dure des montagnes. Le 12 mai, le drapeau français était planté au sommet du djebel Zaghouan pendant que le général Giraud passait en revue nos troupes dans Tunis libérée.
Cette campagne de six mois fut pour nous la plus pénible de toutes celles que nous allions vivre face à un ennemi puissant, auprès de nos alliés nantis, nous étions démunis, soumis à des conditions physiques, psychologiques et politiques éprouvantes. Mais nous avions foi dans la victoire et l'avenir devait nous donner raison.
Jean Florentin
___________________
N.B. :
A l'issue de la campagne de Tunisie, nous devions déplorer
10 000 hommes hors de combat, dont 4 500 tués sur un
effectif engagé de 75 000 hommes. Les Américains
dénombrèrent dans leurs rangs 2 715 morts et les
Britanniques environ 9 000.
Dans son numéro 38 de juin
1987, « l'Algérianiste » a publié,
sous le double titre de « La renaissance de l'Armée
d'Afrique — Témoignage d'un combattant », un
article dans lequel le colonel Jean Florentin a relaté la
contribution du 4e régiment de tirailleurs tunisiens aux
combats de la Libération.
**********************
Maurice AUBERTIER
LE DÉBARQUEMENT ALLIÉ DE SIDI-REHAN (10 novembre 1942)
Ce récit raconte l'arrivée d'un détachement précurseur de l'armée britannique à Sidi-Rehan, lieu-dit tirant son nom du tombeau d'un saint marabout, situé en bordure de mer, sur le territoire de la commune mixte de l'Oued-Marsa, à 25 km à l'est de Bougie dont le port sera ouvert au gros des troupes de débarquement quelques jours plus tard.
En juin 1940, nous étions quelques officiers restés à Constantine sans nous battre. Nous acceptions difficilement la défaite et avions envisagé d'organiser la résistance en Algérie, mais les moyens dont nous pouvions disposer ne nous auraient pas permis de résister longtemps.
Démobilisé en septembre, j'ai regagné mon exploitation agricole des environs de Bougie, tâchant de faire face, tant bien que mal, aux difficultés du moment. En janvier 1941, m'étant rendu à Constantine pour assister à une réunion de nos associations agricoles, j'y rencontrai un ancien camarade du 3e chasseurs d'Afrique. Officier d'active, il appartenait à l'état-major de la division. Au cours du déjeuner, il me demanda si j'étais toujours dans le même état d'esprit qu'en juin 40. Sur ma réponse affirmative, il me déclara tout de go :
— « Dans quelque temps, je reprendrai contact avec toi. Tu pourras sûrement nous aider ».
Effectivement, au printemps suivant, il m'adressa un message et je me rendis à Constantine pour le rencontrer. A ma première question :
— « Pour qui allons-nous travailler ?
— Pour la France, me répondit-il, mais ne m'en demande pas plus. Nous sommes entre officiers. Fais-moi confiance ».
Puis il ajouta : « — Ta mission est le renseignement. Tu dois être très discret. Je serai ton seul contact et, pour ta sécurité, personne ne doit savoir ce que tu fais, pas même ton épouse. Ne garde jamais un document sur toi ni chez toi ».
Dès lors, ma mission consista à renseigner mon ami du 3e chasseurs sur l'état d'esprit des habitants de ma région, les mouvements des navires italiens qui chargeaient du minerai de fer à Bougie, le comportement des commissions d'armistice... Conduit à indiquer le point de la côte le plus propice à un débarquement militaire, je choisis Sidi-Rehan.
Je me suis acquitté de ma mission dans toute la mesure de mes moyens et, je pense pouvoir le dire, le plus honnêtement possible.
L'annonce du débarquement allié le 8 novembre 1942, au Maroc, puis à Alger, ne laissait pas de m'inquiéter, d'autant que je n'arrivais plus à joindre mon contact constantinois. Le 10 novembre, m'étant rendu, au lever du jour, sur un plateau dominant la ferme, je découvris une armada de vaisseaux de guerre se dirigeant vers la plage qui longeait mon exploitation. J'avais signalé ce lieu de débarquement abrité des vues et des interventions possibles à partir de Bougie par l'écran du Cap Aokas. Je regagnais rapidement la ferme et donnais congé de la journée à tout le personnel, au grand étonnement de mon gérant qui ne comprenait rien ! Je dus alors le mettre au courant de l'affaire. Dès que les premiers détachements eurent pris pied sur la plage, je suis allé me présenter à eux. Je suis tombé sur des Anglais qui m'ont conduit, baïonnette dans le dos, à leur commandement. Je fus reçu par un capitaine parlant couramment le français :
— « Etes-vous le lieutenant Aubertier ? »
Sur ma réponse affirmative, il poursuivit :
— « Nous savons qui vous êtes et que nous pouvons vous faire confiance. D'ailleurs nous avons dans nos services de renseignement un capitaine Thomas qui vous a connu très jeune »(17).

___________________
(17)
Je n'appris que plus tard, lors d'une permission, qui était ce
capitaine Thomas qui « m'avait connu très jeune ».
Quelque temps après le débarquement, il s'était
présenté à la ferme alors que j'étais à
mon tour mobile. Il avait été reçu par mon père,
auquel il avait déclaré : « Je vous
connais bien, Monsieur Aubertier. Vous étiez un ami de mon
père, directeur de la mine des Béni-Felkaï. Vous
veniez souvent aux Falaises et nous allions chez vous, à la
ferme, où ma sœur et moi jouions avec vos enfants. »
La mine de fer des Béni-Felkaï était exploitée,
avant la guerre, par une société anglaise qui avait
installé au lieu-dit les Falaises ses bureaux et un wharf pour
le chargement des cargos minéraliers.
Quant au service de renseignement, auquel j'ai apporté ma modeste collaboration, il avait été mis en place par l'état major du général Weygand.
Nous fîmes une pause à la ferme, pendant que le régiment débarquait puis se rassemblait pour faire route vers Bougie. Le colonel qui commandait le détachement m'interrogea sur la région et l'attitude de la population locale. Rassuré par mes propos, il me demanda de me mettre en tenue militaire et de le conduire à Bougie avec ma voiture, car les Britanniques n'avaient pas débarqué de matériel de transport. Puis il me délivra un laissez-passer pour me permettre de circuler librement au milieu des troupes de débarquement. A sept kilomètres de Bougie, nous rencontrâmes une unité de l'armée française conduite par un officier que je connaissais bien. Il vint à moi et nous nous serrâmes la main chaleureusement. J'ignorais qu'il fût dans le coup. Tout était prévu pour que le régiment britannique entre dans Bougie sans rencontrer de résistance et puisse occuper le port afin que les navires viennent débarquer hommes et matériel. Vers 16 heures les premiers avions allemands commencèrent à bombarder la rade. Quant à moi, n'ayant reçu aucune mission officielle, je pris congé du colonel pour rejoindre ma famille demeurée à la ferme. Je me trouvais sur la route en corniche d'Aokas, lorsque j'aperçus un avion anglais qui paraissait en difficulté et qui finit par se poser dans un champ de vigne voisin de ma propriété. Arrivé chez moi, je me rendis au point de chute, où je trouvais un homme souriant qui, calmement, fumait sa pipe. C'était un aviateur canadien fancophone, heureux de rencontrer un officier français. Je l'emmenai à mon domicile où il allait passer la soirée et la nuit. Le lendemain matin je le conduisis à Djidjelli, où était déjà installée sa base. Nous fûmes fêtés par ses camarades et j'eus bien du mal à prendre le chemin du retour.
Maurice AUBERTIER

***************************
Robert FOUICH
L'ECOLE DES ÉLÈVES OFFICIERS DE CHERCHELL
Dès le 28 novembre 1942, la décision avait été prise de créer à Cherchell une école d'élèves aspirants qui devint un Saint-Cyr africain.
Cherchell, ancien et redoutable centre de piraterie barbaresque, était alors le centre administratif et commercial d'une riche région provinciale agricole française. La petite ville et son port avaient été choisis en raison de leur site et de leur environnement en terrains de manœuvres (notamment, le plateau qui dominait Cherchell et d'où l'on découvrait les horizons marins).
Désigné pour Cherchell le 26 mai 1943, j'y suis arrivé seulement le 4 juin, après avoir transité par Mouzaïaville, puis Hussein-Dey, aux côtés de la musique régionale et, enfin, Alger, à la caserne d'Orléans. L'école des E.O.R. avait été aménagée vaille que vaille dans le quartier Dubourdier, libéré par un bataillon du 1er R.T.A. parti pour la Tunisie combattre l'Afrika Korps allemand. Ces locaux s'étant avérés insuffisants, quelques unités avaient dû être cantonnées dans l'ancien parc à fourrage : ce fut le cas de ma compagnie. Le commandement n'ignorait pas que les pertes au combat allaient être considérables parmi les chefs de section et de peloton. Entre décembre 1942 et mai 1945, nous fûmes 5 000 à avoir été formés à Cherchell. Selon le général d'armée J. Cailles qui, alors colonel, commanda l'école du 20 février 1942 au 2 mai 1943, les anciens de Cherchell peuvent se targuer « d'avoir été le fer de lance de l'Armée française pendant les dures campagnes d'Italie, de France et d'Allemagne, d'abord, puis d'Indochine, ensuite. » Les trois quarts des élèves, environ, furent des Français d'Afrique(19) presque tous réservistes. Parmi les autres, venant de métropole, beaucoup s'étaient évadés en passant par l'Espagne. Les mentalités n'étaient pas identiques et quelques dissensions opposèrent certains élèves d'origines différentes... La 1e promotion, la promotion « Weygand » avait été libérée le 30 avril. Elle avait comporté 1101 élèves. La nôtre fut baptisée « Tunisie ».
Elle compta 826 élèves commandés par le lieutenant-colonel Guillebaud (4e R.T.T.), le commandant Larroque (R.T.S.) et le commandant de Roquigny (3e R.T.S.) Il y eut ensuite les promotions « Libération », « Marche au Rhin », puis « Rhin Français » (lieutenant-colonel Huguet). Nous fûmes tous placés dans le même creuset d'une instruction inter-armes et soumis au dur entraînement de l'infanterie : école du soldat, armement, instruction du tir, organisation du terrain, combats, sports, observation et topographie, conduite automobile (20). Notre tenue fut française, en drap de toile avec bandes molletières, capote d'infanterie, casque, harnachement de cuir... Notre allure était des plus martiales lorsque nous défilions en ville ! (21). Beaucoup moins lorsque nous « crapahutions » (22) dans un djebel au relief tourmenté. Qu'il était dur, aussi, au cours de longues marches, de coller à la compagnie qui suivait à pied le cheval du capitaine du Lattay (4e R.T.T) ! Notre file s'étirait et des coups d'accordéon obligeaient les trainards à de gros efforts. Et le soleil africain de cet été 1943 fut torride ! Quelle joie lorsque nous pouvions nous plonger dans l'eau claire des immenses plages de sable fin !... Notre compagnie comportait quatre sections. La première était commandée par un lieutenant (lieutenant Luquay, du 29e R.T.A.) la seconde par un sous-lieutenant (sous-lieutenant Faure, du même régiment), la troisième par un adjudant-chef (l'adjudant-chef Désiré, du Ie' R.T.A. la dernière, la mienne, par l'adjudant Menjès, du 13e R.T.S.
_______________
(19)
On ne disait pas encore « Pieds-Noirs »
(20)
Le nombre de jeunes sachant conduire était, alors, extrêmement
restreint.
J'eus la grande déception de ne pas être nommé aspirant mais seulement sergent breveté chef de section. Ce brevet consolateur ne me fut d'ailleurs jamais officiellement notifié. Je ne dispose pas davantage de la liste des lauréats. Mais je suis à peu près certain que la proportion des nominations « d'aspi » dans chacune des 4 sections fut inversement proportionnelle au grade de son chef.
Notre compagnie ne fut pas non plus privilégiée par l'origine de ses élèves (les chantiers de jeunesse pour la plupart). Et notre promotion bénéficia seulement de 45 % de nominations au grade d'aspirant alors que ce pourcentage s'éleva, pour les autres, jusqu'à 85 %. Nous pûmes choisir notre affectation, en fonction de notre rang de classement. On nous précisa les unités en instance de départ au front et celles qui partiraient plus tard. Je choisis le 7e R.T.A de Sétif, qui devait aller se battre, de préférence au 1er, de Blida, dont le départ devait être ultérieur.
J'avais bien mérité une permission de 10 jours !... Bien entendu, je l'ai passée dans ma famille, à Blida. Elle me permit d'avoir quelques informations sur l'évolution des événements politiques et la progression des combats. Mais il me semble que je ne me posais pas tellement de questions, me pliant sans effort aux circonstances, subissant mon destin avec discipline. Et l'époque n'était pas à la surinformation. On ne disposait ni de transistors, ni de la télé...
La campagne de Tunisie s'était terminée à notre avantage. Sur 70 000 soldats français, fort mal équipés, 16 000 avaient été tués, blessés ou portés disparus. Le 8 septembre 1943, Américains et Anglais avaient débarqué au pied de la botte italienne, à Tarente et à Salerne. En Afrique du Nord, l'équipement des troupes françaises était retardé par des difficultés de transport et de délicats problèmes techniques. La froideur entre les forces Françaises Libres et l'Armée d'Afrique subsistait. Le général Juin avait reçu le commandement du futur corps expéditionnaire Français en Italie et l'entraînait à sa mission sur le littoral oranais, entre Arzew et Mostaganem. A Blida, le ravitaillement des civils s'était un peu amélioré, beaucoup à cause des Américains et du marché noir. Les cigarettes blondes avaient fait leur apparition. Les indigènes revendaient le lait condensé qu'on fournissait aux enfants.
Cette permission fut la dernière avant la perte de mon intégrité physique. En ce Noël 1991, je n'en ai conservé aucun souvenir. Un billet signé le 30 septembre 1943 par ordre du major de l'école d'E.O.A. d'A.F.N. en est la seule trace. Il précise que, nommé au grade de sergent à compter du 1er octobre, je dois rejoindre le 7e RTA, mon corps d'affectation à l'expiration de ma permission.
Robert FOUICH
___________________
(21)
Je me souviens de ma naïve fierté le jour où j'ai
commandé la compagnie sous les yeux admiratifs des populations
de Cherchell !...
(22) Après vérification, ce
verbe est bien français. Il ne peut pas mieux être
employé puisqu'il signifie « marcher longuement en
terrain difficile » et qu'il provient de l'argot de
Saint-Cyr.
***********************
Pierre AUMERAN
TEMOIGNAGES
En 1941-1942 : Intervention aux Etats-Unis du colonel Adolphe Aumeran
Après une visite au maréchal Pétain à Vichy le 2 avril 1941 le général Aumeran, alors colonel de réserve est confirmé dans son opinion de libérer la France du joug allemand le plus vite possible.
Il pense que les Etats-Unis doivent être entraînés dans l'action, car ils ont une possibilité de puissance déterminante. Il faut partir pour les U.S.A. se rendre compte et agir. Mon père le fera à titre privé et contre l'avis de l'amiral Abrial. Obtenir un visa n'est pas facile, il y parvient par surprise. Embarqué sur un navire portugais à Casablanca, il arrive à New-York le 9 août 1941, le 27 il est à Washington. Le 23 septembre sous un faux état-civil, aidé de René Pleven, représentant de la France Libre il part pour Londres. Accueilli par Passy et Diethelm il prend contact avec le général de Gaulle qui le prie de rester à Londres.
Cependant trois semaines plus tard, il retourne aux Etats-Unis où il poursuit avec une volonté et une persévérance qui ne se relâchera jamais, le but qu'il s'est assigné. Il prend d'innombrables contacts, les renseignements qu'il donne, les prédictions qu'il fait, les jugements qu'il porte sur ce que les Américains peuvent attendre de tel ou tel personnage français d'Afrique du Nord se révèlent toujours tellement exacts que les portes s'ouvrent de plus en plus. Il faut circuler, voir les usines de fabrication d'armes, jauger le potentiel américain. Dans ces investigations mon père est beaucoup aidé par Jean Monnet, le futur commissaire au plan alors chargé du service des achats en matériel de guerre pour l'Angleterre. Il trouve aussi la plus grande audience auprès du chef du Service Secret « le colonel Donovan » qu'il avait connu en France, auprès de William Bulitt, Sumner, Welles, Robert Lovett.
L'attaque de Pearl Harbour le 7 décembre 1941 facilite ses efforts qui aboutissent le 11 janvier 1942 à son entrée à l'Ecole de guerre à Washington. A titre consultatif se tient la première réunion de l'état major pour le débarquement en Afrique du Nord. Seul Français présent, il déconseille la formule commandos qui était prévue et indique que seules des forces considérables feront avorter toute tentative de résistance. Ainsi en sera-t-il décidé.
Le 29 juillet 1969 le général Aumeran rencontre à Bruxelles le représentant des U.S.A. à l'O.T.A.N. le colonel Eisenhower (le fils du président) qui lui déclare : mon père(23) comme le général Giraud, était partisan d'un débarquement direct en France alors que vous préconisiez un débarquement massif sur tout le littoral nord africain, mon père() avait tort, c'est vous qui aviez raison.
________________
(23)
Mon père, feu le général A. Aumeran, ingénieur
agronome, fondateur de la Revue Agricole l'Afrique du Nord et de
l'Africain, commandeur de la Légion d'honneur, général
de réserve, croix de guerrel4, palmes et étoiles,
silver star, député d'Alger.
************************
René BÉRARD
TEMOIGNAGES
Pour le spectateur anonyme de quinze ans qui n'est pas dans les secrets des grands et qui découvre la guerre de sa fenêtre, il y a plus à dire sur les jours qui suivirent le 8 novembre que sur le jour lui-même.
Le samedi 7 novembre, un fait inhabituel avait retenu l'attention des adultes sans cependant leur faire prévoir l'événement. Le « Ville d'Oran » assurant la liaison Alger-Marseille et devant lever l'ancre vers 11 h ou midi, était resté au quai de la Transat.Ce retard pouvait avoir de multiples causes, avaries, passage de convois alliés et présence au large de sous-marins allemands et italiens qui constituaient un danger, ou tout simplement prévision de tempête, avec en mémoire le naufrage du « Lamoricière »..., et il n'avait pas éveillé outre mesure les soupçons du vulgum pecus que nous étions, sinon qu'il constituait une anomalie, une de plus ! En ce temps-là les anomalies ne se comptaient plus et on ne cherchait pas à se les expliquer.Tout le monde en savait l'origine qu'on résumait par trois mots : « C'est la guerre ! »... Tout allait de travers et ceci justifiait cela.
On ne s'étonnait plus de voir la camionnette de la teinturerie Reig tirée par deux chevaux, faute d'essence, elle faisait partie du décor des rues vides, ou de manger de la sardine matin et soir, frite, grillée, en escabèche ou en soupe, pendant près de deux semaines, parce que la pêche des chalutiers avait été miraculeuse et qu'à défaut d'autres choses on devait se contenter de ça sur le marché...
Dans ces conditions d'engourdissement, le réveil en fanfare du dimanche 8 novembre, vers 2 h du matin fut une réelle secousse. Les volets ouverts, on ne voyait rien dans la nuit, mais on entendait des coups de canon au-dessus de nos têtes. Ils venaient du fort des Arcades, au sommet de la forêt du Jardin d'Essai, ainsi que du cap Matifou...
Tout à coup apparut dans l'obscurité du port, exactement dans le bassin de Mustapha, un bateau de guerre, sirènes hurlantes, déployant à son arrière un grand drapeau américain éclairé par des projecteurs pour mieux se faire identifier.On le sut plus tard, il avait nom « HMS Broke » et malgré les apparences il était britannique. L'Amérique arrivait sur un vaisseau anglais !
Les tirs se concentrèrent sur lui, plus précisément vers la centrale électrique de la S.A.E.F. au bord de laquelle il avait accosté pour se protéger et il disparaissait ainsi à nos regards, nous faisant regretter de ne pas habiter plus haut pour continuer à voir.
Avec le lever du jour on restait dans l'attente et ce matin-là le succédané de café Nizière avait un goût d'inquiétude... les tirs devenus plus sporadiques incitèrent à sortir pour « aller voir »... Il était environ 9 h. On n'alla pas plus loin que le marché de Belcourt assez terne ce jour-là. Plus de monde aux fenêtres et aux balcons que dans la rue : on ne traînait pas, on se hâtait de rentrer chez soi, certains avec un sourire entendu, mais pas rassurés pour autant...
C'est entre le cinéma Alcazar et la place du marché, en plein milieu de la rue de l'Union, qu'on vit, remontant du port par le passage sous la voie ferrée de la Halte des Ateliers et la place Jeanne d'Arc, des gendarmes maritimes, casqués, revêtus de vestes de cuir et armés de mitraillettes. L'un d'entre eux était blessé (légèrement) et ils nous demandèrent le commissariat du 7e arrondissement, situé plus haut rue Adolphe Cayron, où devaient se trouver un poste de secours et peut-être le téléphone... Ils confirmèrent : c'étaient bien les Américains!...
Ce furent les seuls combattants qu'on vit le 8 novembre, avec le destroyer qui était entré en force dans le port.Les crépitements d'armes automatiques qu'on percevait sur les quais ne poussèrent pas notre curiosité plus avant.
Dans les rues, les quelques passants s'interrogeaient et se demandaient quand les Américains seraient là...
L'après-midi s'écoula dans l'attente, ponctuée de temps à autre par des rafales d'armes automatiques.il se passait quelque chose sur le port mais on en ignorait la tournure.
Les cinémas n'avaient pas ouvert, les matchs de football s'étaient annulés d'eux-mêmes et les cafés étaient déserts ou fermés.
La nuit venue, vers 18 h ou 19 h, une forte déflagration nous remit en émoi.On ne sut jamais s'il s'agissait d'un tir d'obus ou d'une bombe d'avion... Puis plus rien... La nuit fut calme. Le lendemain matin, il n'y avait plus de combats à Alger et comme Fabrice à Waterloo, on en conclut que c'était fini. La guerre commençait.
1492-1942, n'était l'ordre des chiffres, 450 années après Colomb nous découvrions l'Amérique ! ce lundi 9 novembre... Sans nous déplacer, elle venait à nous.
Le lycée était fermé, probablement déjà retenu par la réquisition. Il allait héberger plus d'un an des soldats américains.C'est dans la rue Michelet, nos cartables sous le bras, que nous rencontrâmes nos premiers Américains. Ce fut comme une révélation... D'abord des motos, et pas n'importe lesquelles, des Harley Davidson ! (En matière de motos nous n'avions que le souvenir des Terrot, Monet-Goyon et des tristes « pétrolettes » au bruit épouvantable qui faisaient pâle figure à côté de ces monstres).
Puis, découverte sensationnelle autant que technique, les Jeeps ! On crut tout de suite que les Américains avaient perdu le sens de l'aérodynamisme avec leur aspect carré, mais quand on les vit manoeuvrer, on revint vite de notre erreur... Enfin, les GMC et les Dodges, rapides, maniables et puissants... Il y avait fort longtemps qu'on n'avait vu autant d'autos d'un seul coup.
Parfois des Jeeps s'arrêtaient sur le trottoir, des officiers en casquettes bordées de cuir et imperméables verdâtres en sautaient, comme pour se dégourdir les jambes... Ils nous regardaient, on les admirait... Aucune allure suspecte, aucune attitude hostile de la part de ces grands bonhommes, au contraire de courtes phrases échangées, sorties du charabia de notre anglais approximatif, des sourires et des mots amicaux... Certains, parodiant la France de l'époque, auraient pu nous traiter de « collabos »... On ne les appelait pas encore « Johnny » ou « Amerloques », mais ça n'allait pas tarder...
Et devant le spectacle du port peuplé de navires pendant la nuit, et la rade pleine de bateaux en attente, tous surmontés à leur mat de la fameuse « saucisse » qui dissuadait des attaques en piqué, nos yeux n'en finissaient pas de s'étonner. C'était bien l'Armada du XXe siècle qui mouillait devant Alger. Plus tard, ajoutant une note de poésie aux souvenirs, nous nous demandions ce qu'en aurait pensé l'ombre du grand Cervantes toujours accrochée aux collines de Belcourt, lui qui attendait, caché là après son évasion des prisons d'Alger, l'arrivée d'une flotte espagnole qui l'aurait délivré des barbaresques...
Ceux qui avaient assisté à la mobilisation de 1939 avec sa pagaille, son peu d'enthousiasme, ses lentes processions « d'arabas » tirées par des mulets, les réquisitions de voitures particulières pour « partir en guerre », ceux-là n'en revenaient pas devant ces véhicules « tout terrain » et ces jeunes hommes, équipés et pourvus.La guerre était devenue un sport de riches... Et encore ne voyions-nous que le superficiel, l'essentiel de la force réelle était sur le port.
On comprit alors qu'on avait subi la défaite et la vieillesse, à l'image de celui qui l'incarnait en France. On découvrit la vraie jeunesse, celle de la guerre certes dont beaucoup iraient mourir, mais aussi celle qui se trémoussait au rythme du swing et de Glen Miller avec « In the mood »..., et nous essayions d'en prendre de la graine, histoire de rattraper le temps perdu...
Les Britanniques suivirent tout de suite après dans leurs Bedfords et leurs Hillmans ou leurs hautes ambulances aux parois de carton. Ils étaient pressés de gagner Bougie, Bône, voire même Tunis...
Les tommies étaient plus stricts, plus éprouvés, souvent plus vieux..., des européens pour tout dire. A pieds, toujours par deux au minimum, en camions ou en trams, allant ou venant du centre ville et des YMCA(24), ils sillonnaient la rue de Lyon au son de leurs godillots pour regagner leurs cantonnements de l'école Chazot ou du Jardin d'Essai... On allait leur rendre visite, croyant affermir nos premiers rudiments d'anglais, et nous n'apprenions que les insultes, eux derrière les grilles du Jardin, comme au zoo, et nous sur le trottoir...
______________
(24)
YMCA : Young Men Christian Association : Association
chrétienne de jeunes gens.
Commencèrent alors les bombardements aériens et avec eux les deuils.Les alertes étaient toujours nocturnes.On connut les descentes précipitées à la cave. Ceux dont l'immeuble n'avait pas de cave s'en allaient, quand ils le pouvaient dès 18h, « avant l'alerte », chez des parents ou des voisins ayant un abri...
Le port toujours visé, rarement touché.La ville, elle, vu sa configuration et son étalement autour du port, n'échappa point aux bombes... Moins que Bône, mais elle eut suffisamment de malheurs pour qu'ils lui vaillent, la paix revenue, une croix de guerre collective.
René Bérard
*****************************

Troupes alliées débarquant à Alger
Jean MAZEL
TEMOIGNAGES
Les faits débutent en novembre 1942 à Alger. Depuis la rentrée scolaire d'octobre, mes études secondaires se poursuivaient, sans trop d'ardeur, au petit lycée de Mustapha. J'étais beaucoup plus attiré à seize ans et demi par les filles de mon âge et les performances sportives que par les versions latines ou les questions de cours de mathématiques. Les événements extérieurs et la guerre qui bouleversaient le monde ne me laissaient pas indifférent et je faisais partie d'un petit groupe de jeunes gaullistes totalement hostiles à l'esprit de défaite qui sévissait alors. Mon père était certainement un des rares Français d'Algérie qui avait entendu à la radio l'appel du général de Gaulle du 18 juin 1940 et son patriotisme, son esprit de résistance m'avaient terriblement influencé. Jusqu'en octobre 1942, la seule action efficace de notre petit groupe avait consisté à coller des affiches et papillons sur les murs et à tracer des croix de Lorraine.
Nous avions, au cours de l'été, crevé les pneus et mis du sucre dans le réservoir d'essence de la magnifique Fiat d'un des membres de la commission italienne d'armistice, le comte Ciano, qui avait pris l'habitude de venir se baigner, en galante compagnie, dans un établissement de plage de Sidi-Ferruch. En vérité, c'était beaucoup plus par jalousie de sa magnifique prestance dans son uniforme chamaré d'aviateur et de ses nombreuses conquêtes féminines, que nous avions choisi notre victime. Nous ne pouvions supporter, jeunes coqs gaulois, qu'un étranger vienne chasser sur nos terres. Il n'y avait, à ce moment là, il faut le reconnaître que fort peu de gaullistes à Alger.
Notre unique ambition était de rejoindre le plus tôt possible la France combattante. Nous nous réunissions, le plus souvent possible, autour de Mario Faivre qui habitait Hydra comme moi, pour comploter et refaire le monde. Je recevais également consignes et directives de Pierre Padovani, jeune fonctionnaire du gouvernement général de qui je dépendais directement dans notre réseau confidentiel.
Sous le sceau du secret le plus absolu, nous avions entendu parler du fameux rendez-vous de Cherchell au cours duquel des généraux américains débarqués d'un sous-marin et les chefs de la résistance algéroise avaient mis au point les détails d'un prochain débarquement américain en Afrique du Nord et nous savions que 7 à 8 volontaires devaient se préparer à une action mystérieuse contre les Allemands, sans autre précision. Des circonstances, dont je ne me souviens pas, avaient fait de moi le responsable d'un groupe de jeunes que je devais convoquer pour le jour J.
Dans la matinée du 7 novembre, un samedi, Pierre Padovani me fit savoir que le grand moment était arrivé et que je devais me trouver impérativement avec mon équipe au cinéma Majestic à Bab-el-Oued (de l'autre côté de la ville) à neuf heures du soir. Je passais ma journée à convoquer mes amis Jean Snyers, les deux frères Hartwig, Jean et Roland Faugère, pour nous retrouver à l'heure précise au rendez-vous devant le cinéma où, circonstance curieuse, le film du jour était « Premier rendez-vous » avec Danielle Darrieux.
Nous étions là, devant la porte, trente à quarante personnes de tous âges parmi lesquelles je reconnus de nombreux amis et connaissances. On me fit savoir qu'il fallait nous retrouver à la sortie du film dans un grand garage situé derrière le cinéma. A minuit nous étions tous réunis dans le garage, rideau baissé. Celui qui avait revêtu son uniforme de lieutenant, André Cohen, expliqua qu'il était notre chef et que notre mission consistait à occuper les bureaux de la place et le central téléphonique de l'Amirauté. D'autres groupes, répartis dans tout Alger, devaient neutraliser la grande poste, la préfecture, la radio, les commissariats et le palais d'été et ce afin de tenter d'empêcher toute résistance au débarquement des troupes alliées. On nous distribua d'énormes fusils, des lebels 1916, couverts de graisse et on nous demanda d'accrocher à notre manche un brassard blanc sur lequel était peint V.P. (volontaire de la place), brassards qui allaient nous ouvrir les portes de la ville;
Nous sommes partis en rang par trois, curieuse troupe disparate, accomplir cette fameuse mission. Dans la nuit tiède et humide nos chaussures martelaient inégalement le pavé gras des rues mais nous ne rencontrâmes personne. Arrivés aux grilles d'accès de l'Amirauté, les deux sentinelles qui se trouvaient en faction nous laissèrent passer sur présentation d'un ordre de mission qui semblait en règle. Après avoir réuni, manu militari, les plantons et autres personnels de service, dans une pièce sous bonne garde, nous prîmes possession des lieux en occupant locaux et bureaux et surtout le central téléphonique de la Marine nationale. Tout était calme. Vers deux heures du matin le silence fût soudainement troublé par des sirènes qui se mirent à hurler dans toute la ville et par le bruit d'une violente canonnade dont le départ semblait provenir de tout près.
Le débarquement tant attendu était commencé. Quatre officiers de la commission d'armistice italienne et un général français très en colère, venus aux nouvelles, furent regroupés dans la pièce affectée aux « prisonniers ». Aux premières lueurs de l'aube, un guetteur placé sur le toit nous signala, à notre grande joie et soulagement que quatre bateaux à fond plat et un bateau de guerre se trouvaient au large et se dirigeaient vers le port. L'échec du débarquement de Dieppe était dans toutes les mémoires et en dehors de quelques explosions, tirs de mitrailleuses intermittents, nous n'avions aucune nouvelle de l'extérieur. Le jour s'était complètement levé lorsque l'affaire prit une mauvaise tournure. Des marins et des soldats sénégalais, sortis de l'Amirauté en grand nombre, nous firent brutalement prisonniers, baïonnette au canon. Bousculés, fouillés, battus, nous fûmes conduits mains sur la tête, pointes de baïonnettes dans les fesses, à travers le dédale de souterrains des vieux bâtiments du fort et enfermés tous ensemble dans un sombre cachot de quelques mètres de large — bien au-dessous du niveau de la mer. Il s'agissait d'une ancienne prison d'esclaves construite dans l'îlot du Peñon. Complètement isolés, nous étions abasourdis par ce brutal revirement de situation. Les sentinelles qui se succédaient devant la cellule nous avisaient que nous allions être fusillés comme francs-tireurs. Sombre dimanche sans nourriture, sans eau et sans nouvelles. Un vague petit soupirail dans le plafond très haut donnait une faible lumière.
La nuit arriva, terrible, froide, humide. Les murs du cachot suintaient. Il suffisait de les toucher à peine du doigt pour que de la paroi spongieuse, s'écoule un filet d'eau nauséabond. Le sol était détrempé et, compte tenu de la faible dimension de la pièce, nous ne pouvions que rester debout où, à la rigueur, accroupis.
Le lundi matin, 9 novembre, nous fûmes conduits un par un dans une pièce voisine pour être interrogés d'une façon brutale par des personnages en civil, sans doute des officiers du 2ème bureau. Pendant mon interrogatoire je dus m'asseoir sur un banc sur lequel étaient allongés deux cadavres de soldats américains tués la veille, le visage tout barbouillé de noir de camouflage. Qui est votre chef ? De qui dépendez-vous ? Nous avions tous convenu d'une même réponse soutenant avoir été requis à la sortie du cinéma.
Le moral s'était amélioré après la distribution d'un morceau de pain avec de l'eau, car nous n'avions rien mangé depuis 48 heures. J'avais été surpris de constater la faculté étonnante de certains hommes à réagir par un esprit gouailleur devant l'adversité.
Le soir venu, nous fûmes appelés à sortir dix par dix, puis prévenus que nous allions être fusillés. Je décidais, pour en finir vite, d'être dans les dix premiers.
Heureusement ce n'était qu'un simulacre. Après avoir pu respirer de l'air pur — mais sous les voûtes ce qui nous empêchait de voir l'extérieur — nous fûmes reconduits à nouveau très brutalement dans notre ignoble cachot ou l'atmosphère devenait insoutenable.
Une deuxième nuit s'écoula, tantôt debout, tantôt assis sur le sol recouvert de boue visqueuse. Un terrible doute nous envahissait. Nous ne comprenions plus rien dans notre trou, apparemment oubliés du monde. Nous n'entendions rien, nous ne savions rien, ni sur les suites du débarquement, sur le sort qui nous était réservé. Le seul événement notable le lendemain matin fut la distribution de deux grands bacs de confiture, du pain et de l'eau. L'état sanitaire du cachot était devenu insupportable. Trente cinq personnes enfermées sans hygiène dans vingt mètres carrés.
Dans la soirée, changement de local et d'attitudes. On nous fait remonter des entrailles de l'Amirauté pour nous placer dans un ancien réfectoire désaffecté. Un repas militaire nous fût servi avec distribution de papier à lettres, crayons et cigarettes. Un officier très galonné vint nous prévenir que nous allions être fusillés comme francs-tireurs, mais que nous avions la possibilité d'écrire une dernière lettre à nos familles, puis plus rien. Enfin, le mercredi matin, après avoir dormi dans le réfectoire, nous eûmes droit à un appel très minutieux avant d'être rendus à la liberté. Je contemplais le ciel avec délice et en remontant les rampes de l'Amirauté, nous vîmes avec joie et étonnement le port rempli de bateaux alliés, de drapeaux alliés et de soldats américains et britanniques qui s'agitaient de tous côtés.
La suite nous apprit que nous avions servi d'otages pendant les pourparlers entre Darlan et les généraux américains. Après un ultimatum impératif adressé à la Marine française par les forces alliées notre libération avait été obtenue. Nous étions devenus, sans le savoir, les premiers F.F.I. d'Algérie.
L'Algérie était libérée,nous reprenions le combat contre les Allemands auprès des Alliés.
Jean MAZEL
***************************
La Résistance Fondamentale
ou L'esprit de revanche de l'Armée d'Afrique — 1940-1942
Francine Dessaigne
Préface du général d'armée J. Allard (CR)
Il s'agit là d'un épisode mal connu de notre histoire. L'auteur ne se contente pas d'affirmations mais apporte de nombreux documents inédits. Nous y voyons sous quelles formes s'est manifesté l'esprit de revanche des officiers de l'Armée d'Afrique — l'armée d'armistice — entre la signature de l'armistice, le 25 juin 1940 et le débarquement en Afrique du Nord le 8 novembre 1942. La conviction que le combat reprendrait sur leur sol contre l'occupant de la métropole, a donné à certains l'idée de le préparer et les a conduits à une forme particulière de résistance aux prétentions de l'ennemi. Après un rapide survol historique de l'époque pour replacer le sujet dans son contexte, l'auteur évoque en détail comment se manifesta cette résistance, grâce à des entretiens et des témoignages de militaires et de civils qui se sont associés à ce combat mené dans le plus grand secret : camouflage d'armes et d'hommes, préparation clandestine de la mobilisation, écoutes téléphoniques des consulats ennemis et des commissions d'armistice... Des témoins se souviennent de leur rôle et l'expliquent.
(Editions Confrérie-Castille — B.P. n°24 — 94141 Alfortville Cedex — Prix 420 F)